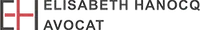Les faits
À la suite de travaux de réhabilitation, des désordres sont constatés sur un bardage. L’assureur dommages-ouvrage indemnise le maître d’ouvrage. L’entreprise responsable et son assureur se retournent contre le fournisseur des matériaux et son assureur, en invoquant la garantie des vices cachés.
La Cour d’appel de Rouen (24 mai 2023) juge l’action prescrite, considérant que le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du Code civil a débuté dès la découverte du vice, soit le 25 juillet 2017.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et adopte une approche différente : dans une action récursoire, le délai de prescription commence au moment où le constructeur est lui-même assigné ou a exécuté sa dette de réparation.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729 ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305) et repose sur la finalité de l’action récursoire : transférer la charge de la réparation au fournisseur réellement responsable.
En pratique
-
Pour les constructeurs et leurs assureurs : ils disposent de plus de temps pour agir contre un fournisseur, même si la découverte du vice est ancienne.
-
Pour les fournisseurs : le risque d’être assigné subsiste longtemps après la découverte du désordre, d’où l’importance d’une gestion rigoureuse des dossiers.
-
Le point de départ du délai de prescription d’une action récursoire en matière de garantie des vices cachés ne coïncide pas avec la découverte du vice, mais avec l’assignation ou la condamnation du constructeur.
Cette décision sécurise les recours dans la chaîne contractuelle et assure une répartition équitable des responsabilités.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier