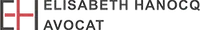Actualités

Droits de succession : pas d'exonération pour le frère / soeur pacsé - Avocat Avignon
En matière de succession, l’exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est prévue pour certains frères et sœurs (CGI, art. 796-0 ter). Cette exonération suppose notamment que l’héritier soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. Il doit avoir vécu avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès (avec, en plus, une condition d’âge > 50 ans ou d’inaptitude). Cependant, concernant les droits de succession : pas d'exonération pour le frère ou la sœur pacsé.
Dans l’affaire jugée le 28 mai 2025, un légataire universel soutenait être exonéré au titre de ce texte. Il prétendait cela au motif qu’il avait cohabité avec sa sœur défunte et remplissait d'autres conditions. En matière de droits de succession : pas d'exonération pour le frère ou la sœur pacsé.
L’administration a refusé : l’héritier avait conclu un PACS, ce qui excluait, selon elle, la qualité de « célibataire ». Ainsi, dans le contexte des droits de succession : pas d'exonération pour le frère ou la sœur pacsé.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : en se fondant sur l’article 515-4 du Code civil (engagement à une vie commune), elle juge qu’un partenaire pacsé ne vit plus dans le célibat.
La notion de « célibataire » de l’article 796-0 ter CGI ne se réduit donc pas à « non marié » : être pacsé suffit à faire obstacle à l’exonération.
À retenir : cette décision concerne l’exonération spécifique entre frère/sœur. Elle ne doit pas être confondue avec le régime successoral propre au partenaire pacsé vis-à-vis de son partenaire. Ainsi, en termes de droits de succession : pas d'exonération pour le frère ou la sœur pacsé.
Référence : Cass. com., 28 mai 2025, n° 21-16.632 (texte intégral)
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Fausse déclaration intentionnelle de l’assuré victime d’un accident de la circulation - Avocat AVIGNON
Dans un arrêt du 23 septembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme une solution désormais stabilisée : la nullité du contrat d’assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle sur l’identité du conducteur habituel (C. assur., art. L.113-8) est inopposable au passager victime. Cela s'applique y compris lorsque celui-ci est aussi le preneur d’assurance (et propriétaire du véhicule), sauf abus de droit.
En l’espèce, la victime était passagère lors de l’accident. Le conducteur, poursuivi pénalement, conduisait en état d’ivresse. L’assureur invoquait la nullité du contrat, fondée sur la fausse déclaration initiale relative au conducteur habituel. Ceci pour échapper à son obligation d’indemnisation.
La Cour rappelle que, conformément aux exigences du droit de l’Union (directive « assurance RC auto »), l’assureur ne peut opposer une telle nullité au tiers lésé. Car cela limiterait de façon disproportionnée le droit à réparation. Cela priverait la réglementation européenne de son effet utile (CJUE, Matmut, 19 sept. 2024, C-236/23).
L’unique limite est l’abus de droit. Cela suppose des circonstances objectives (détournement de l'objectif de protection) et un élément subjectif. Ce dernier est la volonté d’obtenir artificiellement un avantage tiré du droit de l’Union.
Ici, aucun abus n’est caractérisé : la victime, passagère au moment des faits, agit bien en qualité de tiers victime. Ainsi, l’objectif de protection des victimes d’accidents de la circulation est donc pleinement atteint.
Portée pratique : même en cas de fausse déclaration intentionnelle sur le conducteur habituel, l’assureur demeure tenu d’indemniser le passager victime. La discussion se déplace, le cas échéant, vers des recours/actions distincts. Mais cela ne se fait pas au détriment de l’indemnisation de la victime.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances
Lire la suite
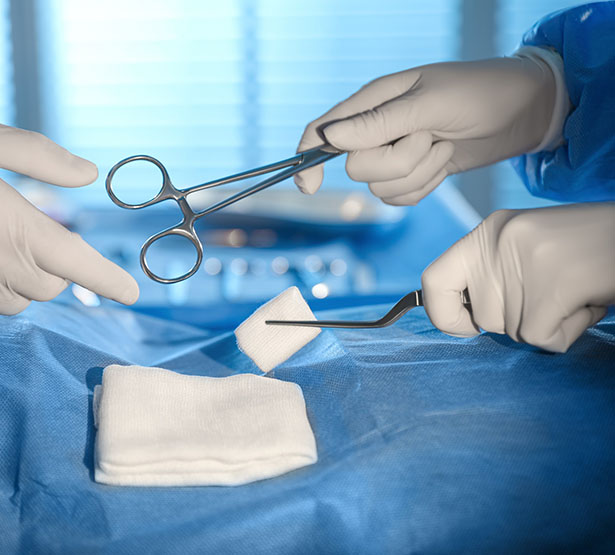
Responsabilité du chirurgien pour compresse oubliée : faute médicale et obligation de contrôle - Avocat AVIGNON
L’oubli d’un corps étranger dans l’organisme d’un patient constitue, selon une jurisprudence constante, une faute médicale. Cela engage la responsabilité du praticien. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 10 septembre 2025, réaffirme ce principe à propos d’une compresse oubliée lors d’une intervention orthopédique à l’épaule. Cet incident met en lumière la responsabilité du chirurgien pour compresse oubliée : faute médicale et obligation de contrôle.
Avant toute opération, et avant la fermeture de l’incision, l’infirmière de bloc opératoire – salariée de l’établissement de santé – procède au comptage et décomptage des compresses utilisées. Si cette vérification incombe formellement au personnel paramédical, le chirurgien demeure tenu de s’assurer de l’exécution effective et exhaustive de ce contrôle. Cela se fait notamment en interrogeant l’équipe mise à sa disposition. En l’espèce, le praticien ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé aux vérifications nécessaires.
La présence d’une compresse oubliée dans le corps de la patiente caractérise un manquement grave à l’obligation de diligence, de prudence et de conscience. Cette obligation pèse sur tout chirurgien. Cette négligence a directement contribué au dommage subi par la victime, justifiant l’engagement de la responsabilité du praticien.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence exigeante quant au contrôle du matériel opératoire. Cela est considéré comme une obligation fondamentale de sécurité au bénéfice du patient.
CA Rouen, 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24/00008
Lire la suite
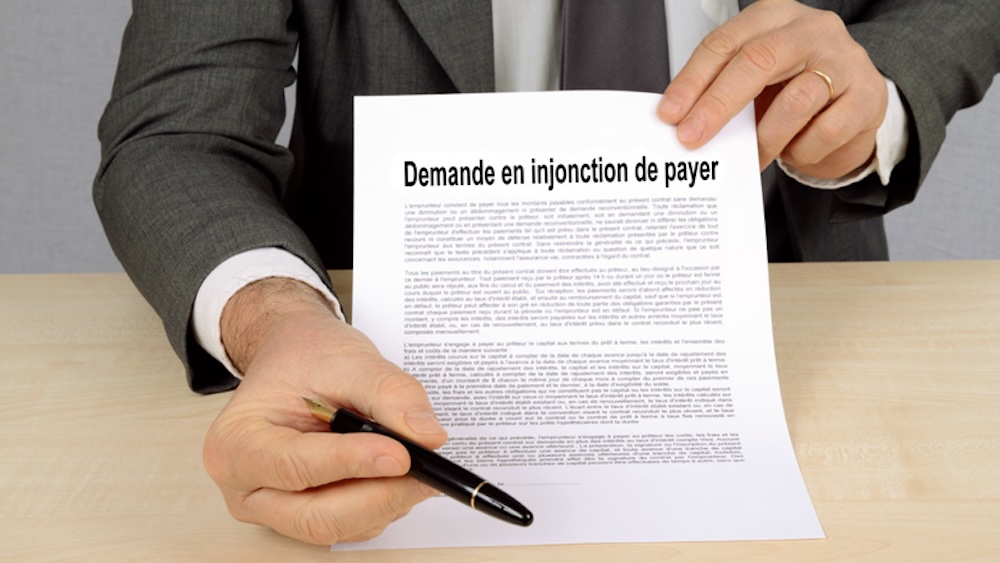
Injonction de payer et charges de copropriété : absence d’obligation de conciliation préalable
Injonction de payer et charges de copropriété : absence d’obligation de conciliation préalable
Par un avis du 25 septembre 2025 (Cass. 2e civ., avis n° 25-70.013) la Cour de cassation a tranché une incertitude persistante. La procédure d’injonction de payer n’est soumise à aucune obligation de tentative préalable de conciliation. Cela s'applique dans ses deux phases, non contradictoire puis contradictoire. En matière de charges de copropriété, l'absence d'obligation de conciliation préalable s'applique également. Cela est particulièrement pertinent pour les injonctions de payer et charges de copropriété. Il s'agit de l'absence d’obligation de conciliation préalable, qui a été au cœur des débats juridiques récents.
Cette clarification met fin aux divergences nées de l’article 750-1 du Code de procédure civile (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038810698). Cet article impose un recours préalable à un mode amiable pour les demandes inférieures à 5 000 €. Plusieurs juridictions avaient considéré que cette exigence conditionnait la recevabilité de l’injonction de payer. Cela compromettait ainsi un outil essentiel du recouvrement des petites créances.
La Haute juridiction souligne que l’injonction de payer constitue une procédure dérogatoire et accélérée. Cette nature est incompatible avec l’exigence de conciliation :
phase initiale non contradictoire, rendant impossible tout MARD préalable ;
phase d’opposition, certes contradictoire, mais dont aucun texte n’organise l’application de l’article 750-1.
Cet avis redonne pleinement son efficacité à l’injonction de payer, particulièrement précieuse pour le recouvrement des charges de copropriété, en permettant au syndicat d’obtenir rapidement un titre exécutoire facilitant notamment la saisie des revenus du copropriétaire défaillant.
L’intérêt pratique est renforcé par les délais très longs de mise en place des conciliations. Ces délais ont été allongés depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Toutefois, le syndic restera avisé de démontrer les démarches amiables entreprises. Le juge peut désormais enjoindre, y compris en cours d’instance, une tentative de médiation. Cette médiation est sous peine d’amende civile pouvant atteindre 10 000 €.
Cet avis, en sécurisant le recours à l’injonction de payer, devrait favoriser un report du contentieux des petites créances vers cette voie rapide. Cela se fera en complément de la saisie conservatoire des provisions désormais permise par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Responsabilité du notaire : défaut d’information lors d’une vente de terrain à bâtir - Avocat AVIGNON
Responsabilité notariale : manquement au devoir d’information et de conseil lors d’une vente de terrain à bâtir
La Cour de cassation rappelle avec rigueur l’étendue du devoir d’information et de conseil pesant sur le notaire lors d’une vente immobilière. Cela est particulièrement crucial lorsqu’un élément d’urbanisme est susceptible d’affecter la consistance ou la valeur du bien.
En l’espèce, des acquéreurs avaient acquis, par acte authentique du 19 février 2015, un terrain à bâtir. Postérieurement à la vente, ils apprennent la délivrance, le 20 septembre 2016, d’un permis de construire. Celui-ci permet l’édification de logements sociaux à proximité immédiate de leur parcelle. Après l’échec du recours dirigé contre ce permis, ils agissent en responsabilité contre les notaires instrumentaires pour manquement à leur obligation d’information et de conseil.
Par un arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel de Nîmes accueille leur demande indemnitaire. Les notaires se pourvoient, soutenant avoir communiqué aux acquéreurs un certificat d’urbanisme. Celui-ci mentionnait une note de renseignements d’urbanisme délivrée le 10 juillet 2014.
La Haute juridiction confirme le rejet du pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir constaté :
l’absence totale de mention, dans le compromis du 30 juin 2014, de tout projet d’édification de logements sociaux à proximité de la parcelle ;
l’absence d’annexion au projet d’acte de la note de renseignements d’urbanisme, pourtant détenue par les notaires ;
l’absence d’explication claire et circonstanciée sur la teneur et les conséquences de cette note, les notaires s’étant bornés à un simple renvoi à une pièce annexée, sans commentaire concret.
Ces éléments caractérisent une information « tardive, lacunaire et insuffisante ». Cela exclut l’accomplissement du devoir d’information et de conseil, lequel implique une communication intelligible et complète des données d’urbanisme susceptibles d’influer sur la décision d’acquérir.
Ainsi, la responsabilité des notaires est confirmée.
Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-20.489, F-D ; JurisData n° 2025-015363
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Résiliation judiciaire du bail d’habitation pour troubles de jouissance : pas de mise en demeure préalable exigée - Avocat Avignon
Résiliation judiciaire du bail d’habitation pour troubles de jouissance : pas de mise en demeure préalable exigée
Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (n° 23/07577), la Cour d’appel de Paris a confirmé la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation aux motifs de graves troubles de jouissance. Ceux-ci étaient imputables au fils de la locataire, qui avait commis des actes de trafic de stupéfiants dans le logement et les parties communes.
La locataire soutenait que l’action en résiliation était irrecevable, faute de mise en demeure préalable au sens de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article impose au bailleur, après mise en demeure dûment motivée, d’agir pour faire cesser les troubles de voisinage.
La Cour rejette cet argument : elle rappelle que, lorsqu’il s’agit d’une action en résiliation judiciaire fondée sur un manquement suffisamment grave du preneur à ses obligations (articles 1728 et 1729 du code civil et article 7 b de la loi de 1989), aucune mise en demeure préalable n’est exigée pour rendre la demande recevable. L’assignation suffit à valoir mise en demeure.
Par ailleurs, la Cour précise que l’article 6-1 de la loi de 1989 ne régit pas les actions en résiliation de bail exercées par le bailleur à l’encontre du locataire. Ce texte organise uniquement la responsabilité du bailleur vis-à-vis des tiers victimes de troubles de voisinage. Ce n'est pas une condition de recevabilité d’une action en résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, les faits de trafic avaient fait l’objet de condamnation pénale. Le fils majeur résidait dans les lieux, et le trouble persistant caractérisait une inexécution suffisamment grave du contrat de location. La Cour en conclut que la résiliation du bail était justifiée.
Cette décision rappelle donc aux bailleurs que, face à des troubles de jouissance graves, l’assignation seule permet d’engager l’action en résiliation judiciaire du bail. Il n'est pas nécessaire d’adresser au préalable une mise en demeure au locataire. En l’inverse, les locataires ne peuvent plus s’opposer à la résiliation sur ce seul motif. L’argument de l’absence de mise en demeure ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’action.Enfin, la Cour souligne que même si des délais peuvent être accordés pour l’expulsion. Le juge n’est pas tenu d’accorder des délais supplémentaires lorsque la gravité des faits le justifie. Cela s'applique aussi lorsque la situation de relogement du locataire n’est pas établie de façon convaincante.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Garantie décennale : la reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas le délai de forclusion - Avocat AVIGNON
Dans un arrêt du 9 octobre 2025 (n° 23-20.446), la Cour de cassation apporte une précision majeure en matière de garantie décennale : la reconnaissance de responsabilité par le constructeur. Même intervenue après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n’interrompt pas le délai de forclusion décennale.
En l’espèce, des travaux avaient été réceptionnés en juin 2005. La partie défaillante s’était vue assigner en 2020 après l’effondrement d’un mur en mars 2018. La cour d’appel avait jugé l’action prescrite en considérant que le délai de dix ans avait couru depuis la réception initiale sans qu’il y ait interruption.
La Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle rappelle d’abord que, avant la réforme de 2008, le délai de garantie décennale était qualifié de prescription et pouvait être interrompu par reconnaissance de dette.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2008, « le délai de dix ans pour agir » figurant aux articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion. Ce n'est donc plus un simple délai de prescription ; de ce fait, il ne peut être interrompu par la reconnaissance de responsabilité du débiteur.
La Cour rappelle que les dispositions transitoires de l’article 26 de la loi de 2008 ne visent que les changements de durée des délais de prescription. Elles ne concernent pas les causes d’interruption ou de suspension. Selon l’article 2 du Code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations non définitivement réalisées.
Ainsi, même si le délai avait commencé avant le 17 juin 2008, une reconnaissance de responsabilité intervenue après cette date ne produit pas d’effet interruptif.
En revanche, sur le second moyen de cassation, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel pour avoir, à rebours de l’article L. 114-1 du Code des assurances et des articles 2241 et 2242 du Code civil, considéré automatiquement irrecevable l’action dirigée contre l’assureur en raison de l’irrecevabilité de celle contre le constructeur ; la Cour rappelle que l’action d’assurance bénéficie d’un délai biennal pouvant être interrompu par assignation en référé-expertise.
Cette décision clarifie que, dans le cadre de la responsabilité décennale, le caractère de forclusion du délai emporte la conséquence qu’aucune reconnaissance unique ne peut rouvrir le délai. Cela incite à une vigilance accrue des maîtres d’ouvrage et assureurs quant aux calendriers d’action.
En résumé, lorsque la loi s’applique et que le délai court, aucune interruption du délai de forclusion ne peut être produite par reconnaissance postérieure au 17 juin 2008 ; seule l’assignation ou acte interruptif prévu par les textes le permet.
Pour les professionnels du bâtiment et de l’assurance, cette clarification met en exergue l’importance de contrôler rigoureusement l’échéance du délai de dix ans et de ne pas supposer qu’une reconnaissance suffit à prolonger le droit d’action.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Bail d'habitation : la situation patrimoniale du bailleur qui délivre congé pour reprise est sans incidence - Me HANOCQ AVOCAT AVIGNON
Par un arrêt du 3 juillet 2025 (Cass. 3e civ., n° 24-11.504, Cour de cassation), la Haute juridiction confirme que la situation financière ou patrimoniale du bailleur est indifférente à la légitimité d’un congé pour reprise.
En vertu de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit justifier d’un motif réel et sérieux. Cependant, le juge ne peut exercer qu’un contrôle de réalité, non d’opportunité.
En l’espèce, un bailleur, sur le point de partir à la retraite, avait donné congé à sa locataire pour occuper le logement. Il invoquait une baisse prévisible de ses revenus. La locataire soutenait que ce congé était abusif, le bailleur disposant déjà d’un patrimoine important et d’un logement HLM à faible loyer.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (21 juin 2023) avait validé le congé, estimant légitime la volonté d’anticiper la diminution de revenus. La Cour de cassation confirme : la volonté du bailleur de reprendre ne dépend pas de sa richesse.
Ainsi, la Haute juridiction refuse tout contrôle d’opportunité. Elle consacre la liberté du propriétaire d’occuper personnellement son bien, quelle que soit l’ampleur de son patrimoine.
Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante (CA Nîmes, 19 mai 2022, n° 20/00507), rappelant que seul le caractère réel et sérieux du motif est exigé pour valider un congé pour habiter.
Lire la suite
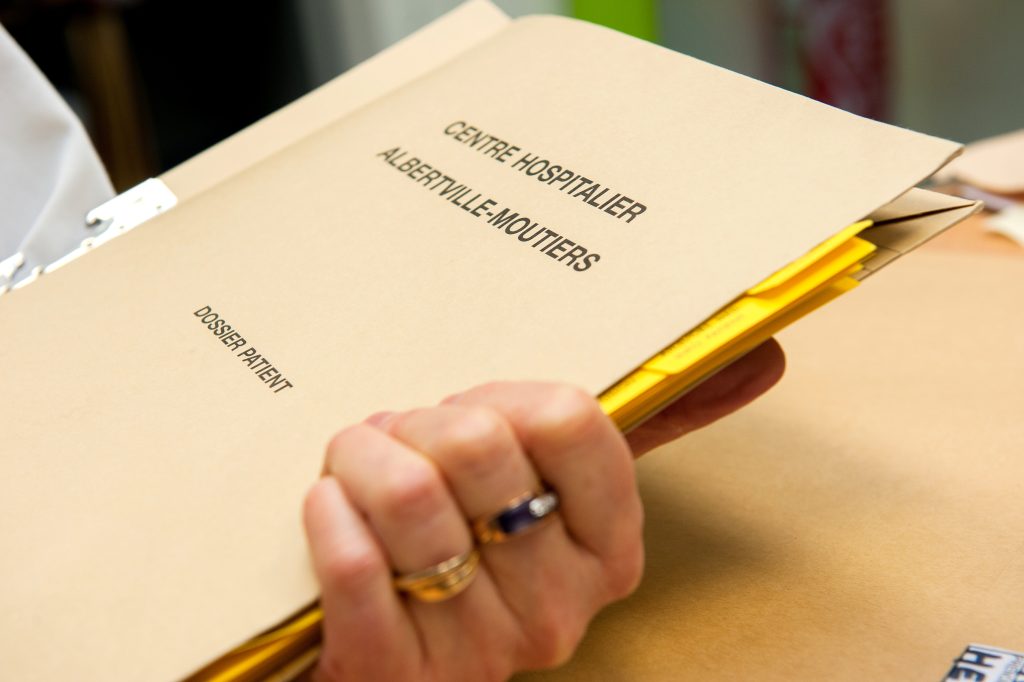
Secret médical : l’assureur peut-il produire un rapport d'expertise malgré l’opposition de la victime ?
Lorsqu’une personne est victime d’un accident de la circulation, l’assureur du responsable mandate souvent un médecin pour réaliser une expertise médicale amiable. Ce rapport sert de base à l’offre d’indemnisation.
Mais que se passe-t-il si la victime refuse que ce rapport ou son dossier médical soient produits devant le juge ?
La Cour de cassation, dans un avis rendu le 3 juillet 2025, a apporté des précisions importantes.
Le rapport d’expertise médicale amiable contient des informations couvertes par le secret médical, qui protège la vie privée du patient.
Cependant, la Cour admet que l’assureur peut produire ce rapport en justice même sans l’accord de la victime, si deux conditions strictes sont réunies :
Cette production est indispensable pour que l’assureur puisse exercer son droit à la preuve.
L’atteinte au secret médical est strictement proportionnée au but recherché.
Autrement dit, le secret médical ne peut pas être utilisé pour bloquer totalement la défense de l’autre partie, mais sa levée ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire.
L’expert ne peut pas exiger la communication de l’entier dossier médical.
Si la victime s’oppose à transmettre tout son dossier médical, ni l’expert missionné par l’assureur, ni l’expert judiciaire désigné par le tribunal ne peuvent l’y contraindre.
L’expert doit se limiter aux documents que la victime accepte de communiquer.
C’est alors au juge de vérifier si ce refus repose sur un intérêt légitime (par exemple, préserver la confidentialité de maladies sans rapport avec l’accident) et d’en tirer les conséquences sur l’indemnisation.
La Cour de cassation souligne l’importance d’un équilibre :
D’un côté, le secret médical protège la vie privée de la victime.
De l’autre, le droit à la preuve permet à l’assureur de se défendre.
L’objectif est donc de garantir un procès loyal et proportionné.
Le juge reste le gardien de cet équilibre.
Pour les victimes, cette décision rappelle qu’il est possible de refuser la communication de certaines pièces médicales, mais ce refus doit être justifié.
Une opposition abusive pourrait affaiblir la crédibilité de leurs demandes d’indemnisation.
Pour les assureurs, elle confirme la possibilité de produire un rapport d’expertise amiable lorsque cela est nécessaire à la défense de leurs droits, sous le contrôle du juge.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 25-70.007
Lire la suite