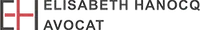Actualités

Successions internationales – Avocat AVIGNON
Comprendre la succession internationale : règles et enjeux
Une succession est qualifiée d’internationale lorsqu’elle comporte un élément d’extranéité, c’est-à-dire :
lorsque le défunt résidait ou est décédé dans un pays différent de celui de sa nationalité ;
ou lorsqu’il laisse des biens dans un ou plusieurs pays autres que celui de sa nationalité ou de sa résidence principale.
Exemple concret : Un Français résidant au Portugal et possédant des biens en France et au Portugal laisse, à son décès, une succession internationale.
Quels héritiers en cas de succession internationale ?
Au sein de l’Union européenne, (hors Danemark et Irlande), une règle commune s’applique pour déterminer qui hérite : la loi du pays de la dernière résidence habituelle du défunt prévaut.
Cependant, une dérogation est possible. Une personne peut choisir que sa succession soit régie par la loi de sa nationalité. Cette décision, appelée option pour la loi nationale, doit être exprimée dans un testament, qu’il soit authentique ou olographe.
Exemple pratique : Si un Français vivant au Portugal décède en laissant des biens en France et au Portugal, la loi portugaise définira les héritiers et leurs droits sur l’ensemble de ses biens. Toutefois, par testament, ce Français peut décider de soumettre sa succession à la loi française. Dans ce cas, la loi française s’appliquera sur l’ensemble de son patrimoine, qu’il soit situé en France ou au Portugal.
Attention : Ces règles concernent uniquement le droit civil applicable à la succession. Elles ne régissent pas la fiscalité, qui reste soumise aux lois fiscales des pays concernés.
La protection des enfants dans un contexte international
Certains systèmes juridiques étrangers ne reconnaissent pas la notion de réserve héréditaire, c’est-à-dire la part minimale de l’héritage revenant obligatoirement aux enfants ou, à défaut, au conjoint survivant. Un mécanisme de prélèvement compensatoire peut s’appliquer pour éviter qu’un enfant soit désavantagé par une loi étrangère.
Ce dispositif, en vigueur pour les successions ouvertes depuis le 1ᵉʳ novembre 2021, permet aux enfants lésés par une loi étrangère de récupérer l’équivalent de leur réserve héréditaire sur les biens situés en France.
Pour bénéficier de ce prélèvement compensatoire, il y a trois conditions :
Le défunt, ou l’un de ses enfants, était, au moment du décès, ressortissant ou résident d’un État membre de l’Union européenne ;
La loi étrangère applicable à la succession n’accorde pas de mécanisme de protection des enfants ;
La succession inclut des biens, meubles ou immeubles, situés en France.
Le certificat successoral européen : un outil pratique
Pour faciliter la gestion des successions internationales, le certificat successoral européen (CSE) permet aux héritiers de justifier leur qualité d’héritier et d’exercer leurs droits dans différents pays de l’Union européenne. Cet instrument simplifie les démarches et évite de devoir prouver ces droits dans chaque pays concerné.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite
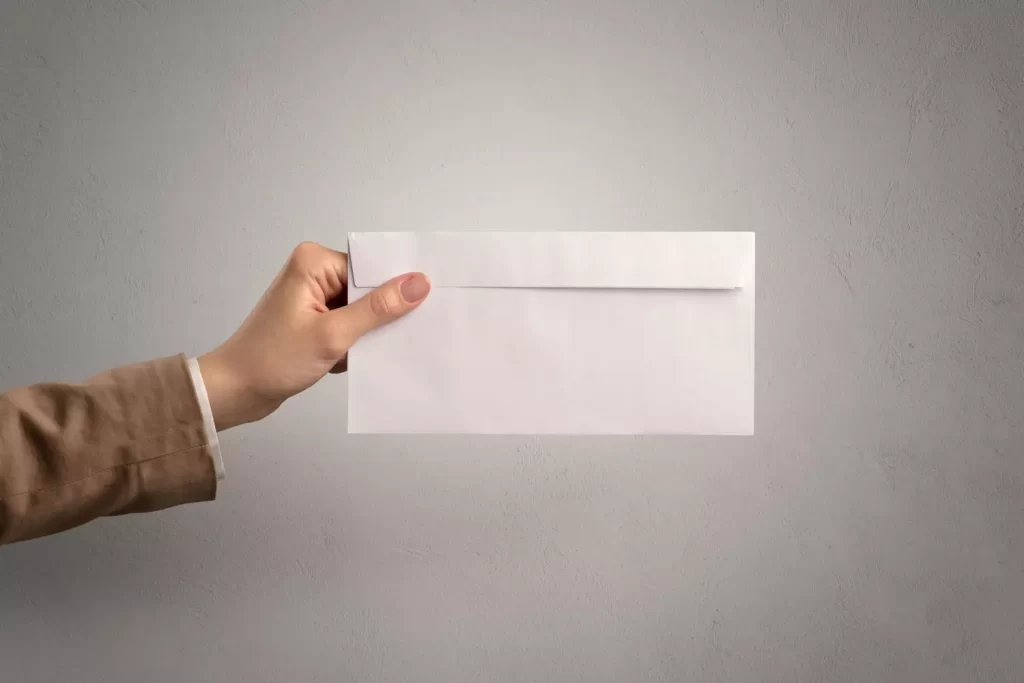
Bail d’habitation et congé pour vendre : attention à la rédaction – Avocat AVIGNON
Le congé pour vendre, délivré par un propriétaire à son locataire, doit être rédigé avec suffisamment de précision. En effet, une rédaction imprécise peut ouvrir la porte à des contestations de la part du locataire, pouvant entraîner la nullité du congé.
Dans une affaire récente, une propriétaire souhaitait vendre un studio loué. Elle avait délivré à la locataire un congé pour vendre comprenant une offre de vente. La locataire a contesté la validité du congé en invoquant un manque de précision, notamment l’absence d’indication du numéro de lot de copropriété.
Cependant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette contestation. Elle a jugé que la locataire disposait d’une connaissance suffisante de la localisation et de l’identification du bien, notamment grâce aux informations contenues dans le bail. Par conséquent, le congé a été validé malgré l’absence de certains détails tels que le numéro de lot.
Ce qu’il faut retenir
Un congé pour vendre reste valide même s’il ne mentionne pas en détail les lots de copropriété ou d’autres éléments spécifiques, à condition que le locataire puisse clairement identifier le bien concerné. Cette identification peut s’appuyer sur les informations contenues dans le bail initial.
Cette décision rappelle qu’il est essentiel de rédiger avec soin le congé pour vendre tout en veillant à ce qu’il fournisse des informations suffisantes.
Référence jurisprudentielle :
CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch. réunies, 14 septembre 2023, n° 22/06805, JurisData n° 2023-015757
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Bail d’habitation : le congé pour habiter soumis à l’exigence de sérieux et de réalité – Avocat AVIGNON
Bail d’habitation : le congé pour habiter soumis à l’exigence de sérieux et de réalité
En matière de bail d’habitation, la validité d’un congé pour habiter repose sur l’appréciation de la réalité et du sérieux de la reprise au moment de sa notification. Cette exigence, renforcée par la loi Alur du 24 mars 2014, impose que le congé soit motivé afin de permettre au juge d’en évaluer la légitimité.
Un principe clair : la situation au jour de la notification prime
L’appréciation du sérieux d’un congé se fait à la date précise de sa notification. Cela signifie que les événements postérieurs, tels qu’une maladie ou même le décès du bénéficiaire de la reprise, n’invalident pas automatiquement le congé s’ils surviennent après cette date.
Mais qu’en est-il si la raison justifiant la reprise disparaît juste avant la notification ? Une récente affaire a apporté des éclaircissements.
Le cas d’espèce : une reprise avortée par un événement imprévu
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Nîmes, un bailleur avait décidé de délivrer un congé pour habiter afin que sa mère puisse occuper le logement et se rapprocher de sa propre mère, âgée et en mauvaise santé. La démarche avait été initiée avec sérieux : un commissaire de justice avait été mandaté pour notifier le congé.
Cependant, trois jours avant la signification, la mère du bailleur est décédée. Malgré la sincérité de l’intention initiale, les juges ont estimé que le motif justifiant la reprise avait disparu avant la notification du congé. Dès lors, ils ont annulé le congé, considérant que, au moment où il a été notifié, la raison d’habiter n’existait plus.
Une jurisprudence qui impose une vigilance accrue
Cette décision rappelle que la réalité et le sérieux d’un congé pour habiter doivent être appréciés avec rigueur au jour de la notification. Si le motif disparaît avant cette date, même dans des circonstances indépendantes de la volonté du bailleur, le congé peut être annulé.
Pour éviter ce type de situation, il est recommandé de bien anticiper les démarches et de réagir rapidement en cas d’évolution des circonstances justifiant la reprise.
Référence jurisprudentielle :
CA Nîmes, 2e ch., sect. A, 14 septembre 2023, n° 22/00679, JurisData n° 2023-017595
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Le vélo à assistance électrique : quelle qualification juridique ? Avocat AVIGNON
La question de la qualification juridique du vélo à assistance électrique a récemment été tranchée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a estimé que ce type de vélo ne relève pas de l’obligation d’assurance applicable aux véhicules automoteurs, car il n’est pas propulsé exclusivement par une force mécanique.
Le contexte du litige
L’affaire concernait un accident survenu en Belgique. Un cycliste roulant sur un vélo à assistance électrique a été mortellement percuté par une voiture. Lors de la procédure judiciaire, une question clé s’est posée : le vélo à assistance électrique doit-il être considéré comme un « véhicule à moteur » ? Cette qualification aurait des conséquences directes sur le droit à indemnisation de la victime, conformément à la législation belge.
En Belgique, la notion de « véhicule » en matière de responsabilité civile est alignée sur la définition de la directive européenne 2009/103/CE, relative à l’assurance des véhicules automoteurs. Pour clarifier l’interprétation de cette notion, la Cour de cassation belge a saisi la CJUE.
La décision de la CJUE
Dans son arrêt du 12 octobre 2023, la CJUE a jugé que les vélos à assistance électrique ne peuvent être assimilés à des véhicules automoteurs, car :
Ils ne fonctionnent pas exclusivement grâce à une force mécanique.
Leur fonctionnement nécessite une action humaine, comme le pédalage.
Leur vitesse est limitée à 20 km/h lorsqu’ils sont assistés, bien inférieure à celle de véhicules tels que les motos ou voitures, susceptibles de causer des dommages plus importants.
En conséquence, les vélos à assistance électrique échappent à la qualification de « véhicule » au sens de la directive européenne.
Implications pratiques
Cette décision confirme que les vélos à assistance électrique n’ont pas à être couverts par l’assurance obligatoire des véhicules à moteur. Pour les cyclistes et les victimes d’accidents impliquant ce type de véhicule, cela peut avoir des conséquences sur les régimes d’indemnisation applicables, qui varient selon les pays membres de l’Union européenne.
Référence jurisprudentielle :
CJUE, 12 octobre 2023, aff. C‑286/22, KBC
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités
Lire la suite

Successions et ambiguïté du testament authentique – Avocat AVIGNON
Successions : l’ambiguïté d’un testament authentique – Avocat à Avignon
Dans une affaire récente, un testament authentique a suscité des débats en raison d’une clause ambiguë qui a opposé les héritiers légaux et la compagne du défunt.
Le contexte du litige
Un homme avait rédigé un testament dans lequel il consentait un legs particulier à sa compagne, accompagné d’une clause précise :
« En outre, j’informe mes enfants que depuis janvier 2009, étant totalement dépendant, j’ai décidé d’attribuer au profit de Mme X. la somme de huit cents euros (800,00 €) par mois au titre de l’assistance et des soins qu’elle m’accorde jour et nuit ainsi que pour le logis et le couvert […] si l’un de mes enfants venait à contester ces versements, il serait privé de ses droits dans la quotité disponible de ma succession, lesquels droits reviendraient alors à Mme X., ma compagne. »
Les héritiers légaux ont contesté cette clause, estimant qu’elle manquait de clarté. La question centrale était de savoir si cette clause constituait un legs à exécuter postérieurement au décès, ou si les versements mentionnés avaient déjà été effectués du vivant du testateur.
La procédure judiciaire
La compagne du défunt a obtenu gain de cause en appel. La Cour d’appel a également condamné les héritiers réservataires à des dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que leur contestation était infondée.
Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a jugé que l’ambiguïté du testament rendait légitime la défense des héritiers, excluant tout abus dans l’exercice de leurs droits.
Les enseignements de l’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’interprétation du testament, laissant cette question à l’appréciation souveraine des juges du fond. En revanche, elle a souligné que :
Lorsqu’un testament peut donner lieu à plusieurs interprétations raisonnables, il est légitime pour les héritiers d’en défendre l’une ou l’autre sans que cela constitue un abus de droit.
Une ambiguïté dans la rédaction d’un testament ne peut, à elle seule, justifier une condamnation pour résistance abusive.
Cette affaire met en lumière l’importance de rédiger un testament de manière claire et non équivoque. Les clauses ambiguës peuvent non seulement entraîner des conflits familiaux, mais également des procédures judiciaires longues et complexes. Faire appel à un avocat spécialisé en droit des successions est essentiel pour éviter de telles situations et protéger les volontés du testateur.
Référence jurisprudentielle :
Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 21-24.292 F-D
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Droit immobilier : la Loi « anti-squat » - Avocat Avignon
Loi anti-squat : renforcement de la protection des propriétaires – Avocat à votre écoute
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, publiée le 31 juillet 2023, marque un tournant dans la lutte contre les occupations illicites de logements. Ce texte vise à offrir une meilleure protection aux propriétaires face aux squatteurs, tout en durcissant les sanctions et en introduisant de nouvelles mesures pour encadrer les situations d’impayés de loyers.
Des sanctions alourdies pour le squat
Les sanctions pour les squatteurs sont considérablement renforcées :
Article 315-1 du Code pénal : toute introduction illégale dans un local (habitation, commerce, exploitation agricole ou professionnelle), accompagnée de manœuvres, menaces, violences ou contraintes, ainsi que le maintien dans les lieux, est désormais punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Article 315-2 du Code pénal : le maintien dans un logement après une décision de justice définitive ordonnant l’expulsion (avec commandement de quitter les lieux depuis plus de deux mois) est sanctionné par une amende de 7 500 €, sauf exceptions (trêve hivernale, suspension de l’expulsion, logement d’un bailleur social ou d’une personne morale de droit public).
Nouveaux délits et mesures spécifiques
La loi introduit plusieurs dispositions pour mieux répondre aux problématiques liées aux squats et impayés :
Les juges ne pourront plus accorder de délais aux squatteurs après une décision d’expulsion.
Les instigateurs de squats, notamment ceux se faisant passer pour propriétaires des logements pour inciter à l’occupation illégale, risquent désormais trois ans de prison et 45 000 € d’amende.
Une amende de 3 750 € est prévue pour toute forme de publicité ou de promotion de méthodes facilitant ou incitant au squat.
Clause de résiliation automatique en cas d’impayés
Les contrats de location doivent désormais inclure une clause de résiliation automatique en cas d’impayés. Les conditions de suspension de cette clause par le juge sont également modifiées :
Le juge pourra suspendre la clause si le locataire a commencé à régulariser sa dette locative et a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
La suspension prendra fin dès le premier nouvel impayé, ou retard dans le paiement des sommes fixées par le juge.
Procédures accélérées contre les locataires de mauvaise foi
Le texte prévoit une réduction de certains délais dans les procédures contentieuses liées aux impayés, en particulier pour les locataires de mauvaise foi. Cela permettra un traitement plus rapide et plus efficace des situations critiques pour les propriétaires.
Renforcement de la prévention des expulsions
La loi met également l’accent sur la prévention des expulsions locatives. Elle précise les missions des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) afin de mieux accompagner les locataires en difficulté et de prévenir les conflits.
Une loi en faveur des propriétaires
Avec cette réforme, les propriétaires disposent désormais d’outils renforcés pour faire face aux situations d’occupation illicite ou d’impayés. Toutefois, pour une application optimale des nouvelles dispositions, l’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit immobilier est essentiel.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Saisie immobilière : que devient le bail consenti par le débiteur saisi – Avocat AVIGNON
Saisie immobilière : que devient le bail consenti par le débiteur saisi ? – Avocat à Avignon
Lorsqu’un bien immobilier fait l’objet d’une saisie suivie d’une vente aux enchères, le sort du bail conclu par le débiteur saisi soulève souvent des questions juridiques complexes. Une affaire récente a permis d’éclaircir certains points à ce sujet.
Le contexte du litige
Un bien immobilier saisi a été vendu aux enchères, mais un locataire, se prévalant d’un bail signé avant l’audience d’adjudication, a continué à occuper les lieux. Après la vente, la nouvelle propriétaire (l’adjudicataire) a conclu avec ce locataire un document qualifié « d’avenant » au bail d’habitation, dans lequel le locataire s’engageait à quitter les lieux dans un certain délai.
Par la suite :
Le locataire a contesté cet avenant, demandant sa nullité et le remboursement des loyers versés.
La nouvelle propriétaire a répliqué en saisissant le tribunal, demandant à ce que le locataire soit reconnu comme occupant sans droit ni titre et sollicitant son expulsion.
La décision du tribunal
Le Tribunal de Libourne a annulé l’avenant au motif qu’il contrevenait aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, qui encadre strictement les baux d’habitation.
L’adjudicataire a alors fait appel, faisant valoir que les baux consentis par le débiteur après la saisie immobilière sont inopposables aux créanciers et à l’acquéreur. Ils jugent également que le bail en question, signé en avril 2016, avait été conclu postérieurement au commandement aux fins de saisie immobilière, notifié dès 2014.
L’analyse des juges d’appel
La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé que l’adjudicataire aurait pu, dès l’adjudication, faire expulser le débiteur saisi et les occupants en raison de l’inopposabilité du bail. Cependant, elle a relevé que :
En concluant un avenant avec le locataire, puis en lui délivrant un congé, la nouvelle propriétaire avait reconnu implicitement la validité du bail.
Cette attitude révélait une renonciation tacite à se prévaloir de l’inopposabilité du bail, renonciation qui, bien que rarement admise par les juges, était ici dénuée d’ambiguïté.
Points clés à retenir
Les baux postérieurs à une saisie immobilière : En principe, les baux conclus après un commandement aux fins de saisie sont inopposables aux créanciers et à l’adjudicataire.
Renonciation tacite : Une renonciation implicite à invoquer cette inopposabilité peut être reconnue si l’attitude de l’acquéreur est claire et sans équivoque, comme en l’espèce.
Dispositions d’ordre public : Toute modification ou avenant à un bail d’habitation doit respecter les règles d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
Cette affaire illustre l’importance, pour les adjudicataires, de clarifier dès l’adjudication leur position quant aux baux existants ou postérieurs. La prudence et un accompagnement juridique adapté sont essentiels pour éviter des litiges liés aux droits des occupants.
Référence jurisprudentielle :
CA Bordeaux, 1re ch., 29 juin 2023, n° 21/05194, JurisData n° 2023-011837
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Adjudications - saisies immobilières
Lire la suite

Le divorce accepté – Avocat AVIGNON
Procédure de divorce : précisions sur le recours au divorce accepté après l’audience d’orientation
En réponse à une question écrite d’un sénateur, le Gouvernement a récemment clarifié les conditions dans lesquelles un époux peut choisir le divorce accepté après l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires. Selon cette réponse, il est impératif, dans ce cas, de commencer par une procédure de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, avant de recourir à la passerelle prévue à l’article 247-1 du Code civil pour parvenir à un divorce accepté.
Le ministère de la Justice, dans une réponse datée du 3 août, a apporté ces précisions concernant l’interprétation des articles 1123 du Code de procédure civile (CPC) et 247-1 du Code civil. Ces dispositions prévoient que, à tout moment d’une procédure initialement engagée pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, les époux peuvent, d’un commun accord, demander au juge de prononcer leur divorce sur le fondement d’une demande acceptée.
Il est également possible dès l’assignation de préciser que la cause du divorce sera définie ultérieurement, notamment dans les premières conclusions. Cependant, conformément à l’article 1123 du CPC, un divorce pour demande acceptée nécessite la signature d’un procès-verbal d’accord lors de l’audience sur les mesures provisoires, en présence des époux et de leurs avocats.
Lorsque cette formalité n’a pas été accomplie, certains magistrats estiment qu’il n’est plus possible, après l’audience d’orientation, de demander directement un divorce accepté. Dans ce cas, les parties doivent d’abord engager une procédure sur un autre fondement – faute ou altération définitive du lien conjugal – avant d’utiliser la passerelle de l’article 247-1 pour revenir à un divorce accepté, conformément à l’article 233 du Code civil.
Le sénateur à l’origine de la question a néanmoins souligné que la rédaction actuelle de l’article 233, issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, pourrait permettre un recours direct au divorce accepté au cours de l’instance, sans passer par l’article 247-1. Il a demandé au ministère de clarifier cette interprétation et a suggéré une éventuelle réforme législative si le droit positif impose effectivement ce détour procédural.
Dans sa réponse, le ministère a confirmé la nécessité de passer par l’article 247-1 après l’audience d’orientation pour accéder au divorce accepté. Il a justifié cette démarche par un objectif de pacification et de facilitation des accords entre époux. Le ministère n’a toutefois pas laissé entendre qu’une modification des textes serait envisagée.
Référence : Réponse ministérielle n° 06417, JO Sénat, 3 août 2023.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce
Lire la suite

Indemnisation des accidents de la circulation – Avocat AVIGNON
Accident de la route : Tout savoir sur vos droits à l’indemnisation
Vous avez récemment été victime d’un accident de la route et vous vous interrogez sur les démarches à entreprendre pour obtenir une indemnisation ? Voici les principales étapes à suivre pour maximiser vos chances d’être justement dédommagé.
Qui vous indemnisera ?
L’indemnisation est généralement prise en charge par l’assurance du responsable de l’accident. Cependant, si ce dernier n’est pas assuré ou reste inconnu, c’est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) qui interviendra.
Pour engager la procédure, vous devez transmettre une déclaration d’accident accompagnée de justificatifs. Ces documents permettent à l’assureur ou au Fonds de Garantie d’examiner votre dossier et de mandater un expert pour réaliser une expertise médicale. Cette étape est cruciale pour évaluer l’étendue de vos préjudices.
Avant d’entamer cette expertise, il est conseillé de préparer soigneusement votre dossier afin d’éviter certaines erreurs fréquentes et d’obtenir une indemnisation optimale.
Responsabilité et droits des victimes
La législation française, notamment la Loi Badinter, accorde une protection renforcée à certaines catégories de victimes, comme les piétons, passagers ou cyclistes. Ces derniers sont indemnisés même en cas de faute de leur part. Par exemple, un piéton blessé en traversant hors des passages piétons pourra obtenir réparation pour son préjudice corporel, sauf exceptions, telles qu’une tentative de suicide.
Ces victimes peuvent également percevoir des provisions avant l’expertise médicale, ce qui leur permet de couvrir rapidement des frais urgents, tels que la perte de revenus ou les frais médicaux.
En cas d’accident de trajet lié au travail, la Sécurité sociale intervient en versant des indemnités journalières. Toutefois, celles-ci seront déduites de l’indemnisation définitive réglée par l’assureur.
Pour les conducteurs de véhicules motorisés, l’indemnisation dépend des circonstances de l’accident :
Si vous n’êtes pas responsable : c’est l’assurance du tiers ou le Fonds de Garantie qui prend en charge l’intégralité des préjudices.
Si vous êtes responsable : vous ne serez indemnisé que si vous avez souscrit une Garantie Conducteur. Dans ce cas, le montant versé dépendra des clauses de votre contrat.
Comment est déterminé le montant de l’indemnisation ?
Le montant de l’indemnisation est évalué au cas par cas, après discussion avec l’assureur ou le Fonds de Garantie. Faire appel à un avocat est vivement recommandé, notamment si vous subissez des préjudices graves ou des séquelles durables. L’avocat vous accompagnera pour chiffrer précisément les impacts financiers et personnels de l’accident.
L’indemnisation tient compte de nombreux facteurs, comme :
Les séquelles physiques ou psychologiques,
Les pertes de revenus actuelles et futures,
L’impact sur votre carrière professionnelle ou votre retraite,
Les aménagements nécessaires à votre logement ou véhicule en cas de handicap.
Le rôle clé de l’expertise médicale
Une fois votre état de santé consolidé (stabilisé médicalement), un médecin expert évaluera vos préjudices. Ces derniers sont classés en deux catégories :
Les préjudices temporaires : perte de revenus provisoire, douleur liée à l’accident, etc.
Les préjudices permanents : séquelles définitives, préjudice esthétique, perte d’autonomie, etc.
Chaque poste de préjudice est quantifié à l’aide d’un barème qui prend en compte votre âge, votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que vos besoins spécifiques (logement adapté, impossibilité de pratiquer certains loisirs, etc.).
Pourquoi faire appel à un avocat ?
Maître Elisabeth HANOCQ vous accompagne tout au long du processus d’indemnisation. Grâce à son expertise, elle peut débloquer rapidement des provisions et défendre vos intérêts pour obtenir la meilleure compensation possible.
Que vous soyez victime d’un accident de la route en tant que piéton, cycliste, passager ou conducteur, un accompagnement juridique adapté est essentiel pour faire valoir vos droits et obtenir une indemnisation juste et complète.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités
Lire la suite