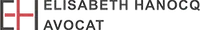Actualités
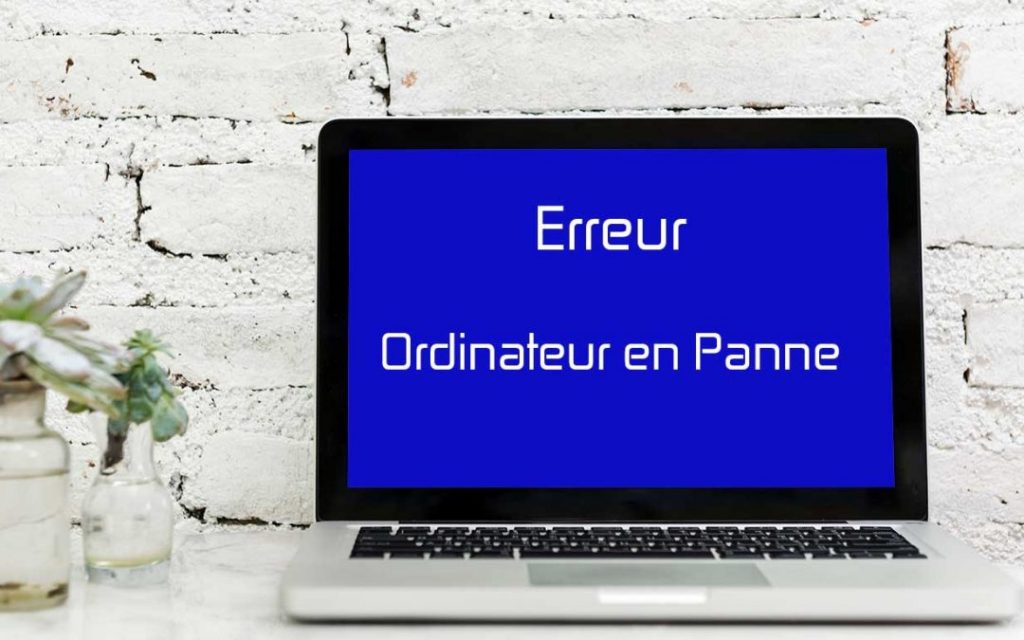
Panne informatique et respect des délais de procédure - Avocat AVIGNON
Respect des délais de procédure en cas de panne informatique
La Cour de cassation examine si une panne informatique peut constituer une cause étrangère permettant, en application de l'article 930-1 du CPC, de remettre un acte de procédure.
L'article 930-1 du CPC impose que dans certaines procédures devant la cour d'appel, les actes soient transmis par voie électronique. Cependant, cette obligation n’entraîne pas l’irrecevabilité si l’impossibilité de transmettre l’acte par voie électronique est due à une cause étrangère. Dans ce cas, l'acte peut être remis au greffe sur support papier.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait déclaré irrecevable une déclaration de saisine après renvoi par la Cour de cassation. La cour d'appel avait estimé que l'acte, remis au greffe sur support papier le 22 mars 2018, ne démontrait pas que l’avocat de l’appelant avait été empêché d’accéder au RPVA. Elle relevait qu’aucune panne de la clé RPVA n’était établie et que cette clé pouvait être utilisée sur tout ordinateur avec un accès internet, notamment dans des locaux tiers, comme ceux de l'ordre des avocats ou d'un confrère, démarche que l’avocat n’avait même pas tenté.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juin 2021, casse cette décision. Elle souligne que l'avocat avait prouvé que son matériel informatique avait subi une panne, rendant impossible l'accès à internet. Cette panne, causée par un câble défectueux, avait nécessité l'intervention d'un réparateur pendant trois jours pour identifier et résoudre le problème.
La Cour de cassation retient donc l'existence d'une cause étrangère justifiant l'impossibilité de transmission électronique et valide, dans ce contexte, la remise de l'acte sur support papier.
Cet arrêt clarifie les conditions dans lesquelles une panne informatique peut constituer une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du Code de procédure civile.
Référence : Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-10522.
Lire la suite

L’indemnité de licenciement est-elle un bien de communauté ?
L’indemnité de licenciement est-elle un bien de communauté ?
Les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : bien commun ou bien personnel ?
Une indemnité versée pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue un bien commun lorsqu'elle vise à réparer le préjudice lié à la perte d'emploi.
Dans une affaire récente, des époux, mariés sans contrat, se sont disputés lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux après leur divorce.
La cour d’appel de Riom avait décidé que la communauté devait une récompense à l’ex-épouse. Elle estimait que les dommages-intérêts versés par l’employeur, condamné pour licenciement abusif, avaient pour but d’indemniser un préjudice strictement personnel.
Cependant, dans un arrêt du 23 juin 2021 (pourvoi n° 19-23.614), la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a reproché aux juges de ne pas avoir vérifié si cette indemnité réparait exclusivement un dommage affectant la personne de l’ex-épouse, ou si elle concernait aussi le préjudice lié à la perte d’emploi.
Selon la Cour de cassation, les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du Code civil précisent que les indemnités perçues par un époux entrent dans la communauté, sauf si elles sont exclusivement attachées à la personne du bénéficiaire.
Cet arrêt rappelle l'importance de bien qualifier la nature des indemnités lors de la liquidation des régimes matrimoniaux.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d'AVIGNON, Cour d'appel de NIMES
Lire la suite

Promesse de vente : L’indemnité d’immobilisation ne peut pas être réduite par le Juge - Avocat AVIGNON
Le Juge ne peut pas réduire une indemnité d'immobilisation dans une promesse de vente.
Une promesse de vente immobilière a été signée sous condition suspensive de l’octroi d’un prêt. Cependant, les acquéreurs n’ont pas rempli leurs obligations pour obtenir le crédit. La vente n’a donc pas été finalisée.
Les vendeurs ont alors réclamé l’indemnisation prévue contractuellement, à hauteur de 10 % du prix de vente.
Les acquéreurs ont reconnu leur défaillance dans leurs obligations, notamment celle de justifier des demandes de prêts dans les délais. Cependant, ils ont contesté le montant réclamé. Selon eux, cette somme constituait une clause pénale visant à sanctionner un manquement. Ils considéraient donc qu’elle représentait des dommages-intérêts forfaitaires que le juge pouvait réduire.
De leur côté, les vendeurs ont affirmé que cette indemnité d’immobilisation n’était pas une clause pénale. Ils ont soutenu qu’elle représentait le prix de l’exclusivité accordée aux acquéreurs et était donc insusceptible de modification judiciaire.
La décision de la Cour d’appel de Paris :
Dans un arrêt du 3 septembre 2021 (Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, n° 20/00747), la Cour a tranché en faveur des vendeurs.
La Cour a jugé que l’indemnisation prévue dans la promesse de vente — fixée à 10 % du prix — constitue une contrepartie de l’immobilisation du bien par le vendeur. Elle n’a pas pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation. En conséquence, cette indemnité ne peut pas être modifiée par le juge.
Les juges ont estimé que les arguments avancés par les vendeurs étaient exacts et pertinents. Ils ont confirmé la condamnation des acquéreurs à payer l’indemnité d’immobilisation.
Cette décision rappelle que l’indemnisation prévue dans une promesse unilatérale de vente peut être considérée comme une contrepartie de l’exclusivité et non comme une clause pénale. Les vendeurs disposent ainsi d’une sécurité juridique pour préserver leurs droits lorsque la vente n’aboutit pas.
Pour toute question relative aux promesses de vente, il est essentiel de se faire conseiller par un avocat compétent en droit immobilier.
Me HANOCQ – Tribunal judiciaire d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – IMMOBILIER – PROMESSE DE VENTE – Indemnité d’immobilisation
Lire la suite

Une servitude discontinue ne peut s’acquérir par prescription
Servitude d'écoulement des eaux usées : l'impossibilité d'acquisition par prescription
Une servitude d'écoulement des eaux usées nécessite l'intervention humaine pour son exercice. Cette condition lui confère un caractère discontinu. Par conséquent, elle ne peut être acquise par prescription.
Un litige entre voisins
Dans cette affaire, M. [V] a assigné ses voisins, M. et Mme [D], pour demander la suppression de canalisations d'évacuation des eaux usées empiétant sur son terrain. La cour d'appel a rejeté sa demande, estimant que M. et Mme [D] avaient acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription trentenaire.
M. [V] a contesté cette décision. Selon lui, une telle servitude ne peut être acquise par prescription, même si les canalisations sont apparentes et permanentes. Il a invoqué les articles 688 et 691 du code civil pour soutenir sa position.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a rappelé que les servitudes discontinues exigent une intervention humaine pour être exercées. Qu'elles soient apparentes ou non, elles ne peuvent s’acquérir que par titre.
Elle a donc cassé l’arrêt de la cour d'appel. La haute juridiction a jugé que la servitude d’écoulement des eaux usées, de nature discontinue, ne pouvait être acquise par prescription.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 juin 2021 (20-19.968).
Cet arrêt rappelle que l'acquisition d'une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription est impossible en raison de son caractère discontinu. Pour établir une telle servitude, un titre explicite est indispensable.
Me ELISABETH HANOCQ - Tribunal judiciaire AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - immobilier - servitudes
Lire la suite

Indemnisation de l’époux de la victime d’un accident médical - Avocat AVIGNON
Indemnisation de l’époux de la victime d’un accident médical
Lorsqu’une infection nosocomiale entraîne le décès d’une victime, son époux peut demander une indemnité à l’ONIAM. C’est ce qu’illustre une décision récente de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, la cour d’appel a constaté que, avant l’accident médical, la victime aidait quotidiennement son époux dans les tâches ménagères. Celui-ci était dans l’incapacité de les assumer seul, un fait que l’ONIAM n’a pas contesté. En conséquence, la cour a jugé que la perte de cette aide représentait un préjudice économique réparable dans le cadre de la solidarité nationale. Elle a donc accordé à l’époux une rente trimestrielle viagère, en estimant à une heure par jour l’assistance que lui procurait son épouse.
Le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s’applique également à d’autres préjudices. Le préjudice sexuel, par exemple, inclut l’ensemble des atteintes à la sphère sexuelle. Ce préjudice peut aussi être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe.
Cependant, lorsque l’indemnisation intervient au titre de la solidarité nationale sur la base de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, les préjudices subis par la victime indirecte du vivant de la victime directe ne donnent pas lieu à réparation. Ainsi, les conséquences personnelles ressenties par l’époux à la suite du décès de son conjoint, comme la privation de relations sexuelles, sont indemnisées dans le cadre du préjudice d’affection.
Référence : Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-227873
Me HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Santé publique - infection nosocomiale - indemnisation des préjudices
Lire la suite

Vente immobilière : la condensation est-elle un vice caché ?
Vente immobilière : la condensation est-elle un vice caché ?
Le 19 mai 2014, Monsieur Roger G. a vendu à Monsieur Patrice D. une maison d’habitation avec terrain pour un montant de 113.000 euros, par acte authentique.
Durant l’été 2014, Monsieur Patrice D. a signalé des problèmes d’humidité affectant le carrelage de la maison. Une expertise amiable a été réalisée. Faute d’accord, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le 5 juillet 2018, Monsieur Patrice D. a assigné Monsieur Roger G. devant le tribunal de grande instance de Pau. Il invoquait l’article 1641 du Code civil et réclamait la restitution de 27.600 euros, correspondant à une partie du prix de vente.
Décision de la Cour d’appel de Pau (1re chambre, 22 juin 2021, RG n° 19/01981)
La Cour d’appel de Pau a reconnu l’existence d’un vice caché. Le vendeur n’avait pas informé l’acquéreur d’un phénomène de condensation de l’air ambiant, fréquent en zone de montagne. Cette condensation engendrait des problèmes d’humidité importants.
L’acquéreur, charpentier-couvreur de profession, ne pouvait être considéré comme un expert en matière de condensation dans les régions de moyenne montagne. Lors de la visite hivernale, les problèmes d’humidité n’étaient pas visibles. Ces phénomènes se manifestaient uniquement par temps de fortes chaleurs, causant des traces d’eau sur certaines zones du carrelage.
L’humidité constatée altérait l’usage du bien, notamment en rendant le carrelage du rez-de-chaussée glissant et donc dangereux.
La Cour a prononcé la restitution partielle du prix de vente, permettant ainsi de couvrir les coûts liés à la réparation de ce vice caché.
Me HANOCQ / AVIGNON / Cour d’appel de NIMES / IMMOBILIER / vices cachés / humidité
Lire la suite

L'action du syndicat des copropriétaires face aux nuisances d'un restaurant - Avocat AVIGNON
Une SCI possédait des lots comprenant un local commercial situé au rez-de-chaussée et une place de parking au premier sous-sol d'un immeuble soumis au régime de la copropriété. Le 29 janvier 2014, cette SCI a loué le local à une société en vue d’y exploiter un restaurant sur place ou à emporter, sans installation d'extraction. L'activité a débuté le 31 août 2014.
Le recours du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires peut demander judiciairement la cessation des nuisances liées à l’exploitation du restaurant. Il est habilité à agir contre le propriétaire bailleur pour contraindre ce dernier à faire respecter les règles de la copropriété. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que le syndicat pouvait présenter une demande en cessation d’activité sous astreinte, en raison des troubles de voisinage liés à l’exploitation du restaurant.
Les nuisances relevées comprennent :
des bruits causés par les clients, les scooters et les livraisons nocturnes ;
des odeurs de nourriture persistantes ;
des poubelles laissées sur le trottoir ou des déchets abandonnés par les clients ;
une obstruction des passages communs de l’immeuble par les livreurs, les clients et leurs véhicules.
Ces nuisances, constatées jusqu'en août 2016, étaient répétées, intenses et durables. Elles excédaient les inconvénients normaux du voisinage par leur ampleur, leur fréquence (y compris la nuit) et leur impact sur la vie des copropriétaires.
La responsabilité du propriétaire bailleur
La Cour d’appel a rappelé que le propriétaire bailleur engage sa responsabilité dans deux cas :
En raison du non-respect des règles de copropriété et au règlement de copropriété, qui imposent que l’activité exercée n’occasionne pas de nuisances..
En raison de son incapacité à faire respecter ce règlement par son locataire.
Par ailleurs, le propriétaire est également responsable des troubles anormaux du voisinage causés par son locataire.
Une décision claire de la Cour d’appel
La Cour d’appel de Paris (Pôle 4, chambre 2, 7 avril 2021, RG n° 17/14387) a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires. Elle a condamné la SCI à faire cesser l’activité de son locataire sous astreinte.
Les juges ont confirmé que les nuisances affectaient l’ensemble de l’immeuble, notamment en raison du risque incendie et du trouble causé aux copropriétaires, certains résidant jusqu’au 4ème étage. Le syndicat des copropriétaires a prouvé un préjudice collectif sur une durée de deux ans, particulièrement en été, en raison des bruits et des déchets. Ce préjudice a été évalué à 8 000 euros.
Cette affaire rappelle l’importance pour un propriétaire bailleur de veiller à la bonne exécution du règlement de copropriété par son locataire. En cas de nuisances répétées, le syndicat des copropriétaires dispose de moyens d’action pour garantir le respect des droits de tous les occupants de l’immeuble.
Me HANOCQ / AVIGNON / Cour d’appel de NIMES / COPROPRIETE / NUISANCES / TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
Lire la suite

Immobilier : Servitude de vue
Immobilier : Servitude de vue
Selon l’article 678 du Code civil, il est interdit de créer des vues droites, telles que des fenêtres donnant directement sur la propriété d’un voisin, à moins de respecter une distance de 1,90 mètre entre le mur concerné et la limite de cette propriété. Cette règle s’applique aux héritages clos ou non clos.
Cependant, l’article 690 du même code prévoit que les servitudes continues et apparentes peuvent être acquises par une possession de trente ans.
Dans cette affaire, la fenêtre litigieuse se trouve en limite séparative des terrains, sans respecter la distance imposée par l’article 678. Les éléments présentés montrent que cette ouverture a été réalisée lors de travaux de rénovation en 1985. Des photographies d’époque confirment que la fenêtre n’existait pas avant ces travaux.
Le permis de construire a été délivré le 9 avril 1985. Il est donc nécessaire de vérifier si la prescription trentenaire de l’article 690 a été atteinte depuis cette date.
Toutefois, la procédure montre que les consorts G. ont contesté cette ouverture par une demande reconventionnelle datée du 6 octobre 2014. Ce délai empêche d’invoquer valablement la prescription trentenaire.
Ainsi, la Cour condamne les époux T. R. à supprimer la vue droite litigieuse sous quatre mois à compter de la signification de l’arrêt. Passé ce délai, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera appliquée, et ce, pendant une durée maximale de six mois.
Référence : Cour d’appel de Chambéry, 2e chambre, 5 septembre 2019, RG n° 18/00762.
Me HANOCQ / Tribunal judiciaire AVIGNON / Cour d’appel de NIMES / DROIT IMMOBILIER / SERVITUDE DE VUE
Lire la suite

Divorce par consentement mutuel : Le droit de changer d’avis
Divorce par consentement mutuel : Le droit de changer d’avis
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 juin 2021 (n°19-10.550) concernant l’homologation des conventions de divorce. Cet arrêt précise que le juge peut refuser l’homologation si les intérêts de l’un des époux ne sont pas suffisamment préservés.
Dans cette affaire, deux époux, mariés sans contrat en 2003, souhaitaient divorcer. Ils avaient signé un projet de partage devant notaire, prévu pour être homologué par le juge dans le cadre de la procédure de divorce.
Selon l’article 268, alinéa 2, du Code civil : « Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».
Pendant la procédure, l’épouse a estimé que la convention ne garantissait pas ses droits. Elle a relevé, notamment, qu’elle était privée d’une partie de l’indemnité d’occupation à laquelle elle pouvait prétendre. Elle s’est donc opposée à l’homologation du projet notarié.
La Cour d’appel de Versailles lui a donné raison en refusant d’homologuer l’acte. L’ex-époux a formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Cour. Celle-ci a rappelé que « le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux ».
Ainsi, deux vérifications s’imposent au juge :
Les conclusions des deux parties doivent être concordantes.
La convention doit préserver suffisamment les intérêts des époux.
Cet arrêt renforce la souplesse de la procédure de divorce et de partage. Même après avoir signé un projet de partage devant notaire, un époux peut changer d’avis si ses intérêts sont en jeu.
Maître Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’Avignon, vous accompagne dans vos procédures de divorce et de partage. N’hésitez pas à la consulter pour bénéficier de conseils personnalisés et d’une assistance adaptée à votre situation.
Lire la suite