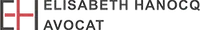Actualités

Responsabilité du notaire - Avocat AVIGNON
Responsabilité du notaire en cas de faute de conseil concernant un terrain à bâtir
Le 20 décembre 2010, M. X a acquis un terrain à bâtir. Toutefois, un permis de construire lui a été refusé. En cause, le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur interdisait toute nouvelle construction sur ce terrain.
Une modification ultérieure de ce PLU a permis à M. X de redéposer une demande de permis de construire. Cette fois, le permis a été accepté.
M. X a ensuite assigné le notaire en justice, estimant que celui-ci avait manqué à son obligation de conseil. Selon M. X, le notaire aurait dû l’informer des restrictions imposées par le PLU lors de l’achat du terrain. Il a donc demandé réparation pour le préjudice subi.
Décision de la Cour d’appel de Nîmes
La Cour d’appel de Nîmes a donné raison à M. X. Elle a condamné le notaire à lui verser :
21.420,30 euros pour le surcoût de la construction,
19.200 euros pour la perte locative.
Le notaire a contesté cette décision devant la Cour de cassation. Il a soutenu que le simple manquement à l’obligation de conseil ne suffisait pas pour prouver que le préjudice était directement lié à sa faute. Pour être indemnisé, il fallait établir que le dommage n’aurait pas eu lieu sans cette faute.
Analyse de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 10 novembre 2021 (pourvoi n° 20-15.739), la Cour de cassation a rappelé les principes découlant de l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil : seul un dommage ayant un lien causal direct et certain avec la faute peut ouvrir droit à réparation.
La Cour a relevé que :
La Cour d’appel avait retenu un manquement du notaire à son devoir de conseil. Ce manquement portait sur l’absence d’information concernant les limitations d’urbanisme du terrain.
M. X ne demandait pas la réparation d’une perte de chance de renoncer à l’acquisition, mais celle du retard dans son projet immobilier, causé par le surcoût et la perte de loyers.
Cependant, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment recherché si ces préjudices auraient été évités en l’absence de la faute du notaire. En conséquence, elle a annulé la décision pour défaut de base légale.
En conclusion
Cet arrêt illustre l’importance du lien de causalité entre la faute et le dommage dans la responsabilité civile du notaire. Pour être indemnisé, il ne suffit pas de prouver une faute. Il faut également démontrer que le dommage est directement imputable à cette faute.
Ainsi, tout acquéreur d’un bien immobilier soumis à des restrictions d’urbanisme doit vérifier que le notaire remplit pleinement son devoir de conseil. En cas de doute ou de préjudice, une consultation juridique peut s’avérer nécessaire.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES - responsabilité du Notaire
Lire la suite

Don manuel ou don d'usage ? - Avocat AVIGNON
Les cadeaux de fin d'année : don d'usage ou don manuel ?
Noël ou d'autres événements familiaux sont souvent l'occasion de faire plaisir à ses enfants ou petits-enfants. Mais ces cadeaux peuvent-ils être considérés comme des dons manuels ? Cette distinction peut avoir des conséquences juridiques et fiscales importantes.
Qu’est-ce qu’un don d’usage ?
Un don d’usage est un cadeau offert à un proche lors d’un événement particulier. Pour être qualifié ainsi, il doit remplir quatre conditions :
Fondement traditionnel : Le don doit s’inscrire dans une tradition, comme Noël, un anniversaire, un mariage ou une naissance.
Remise en main propre : Le bien doit être remis directement au bénéficiaire.
Biens meubles uniquement : Il peut s'agir de mobilier, d'une voiture ou encore d'espèces.
Valeur raisonnable : Le cadeau ne doit pas dépasser une valeur proportionnelle à la fortune du donateur.
Le don d’usage a plusieurs avantages. Il n’est pas soumis aux droits de mutation, ne nécessite pas de déclaration fiscale et n’entraîne pas de rapport à la succession.
Quand un don d’usage devient-il un don manuel ?
Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, le don peut être requalifié en don manuel. Ce dernier se caractérise par la transmission d'un bien mobilier ou d'une somme d'argent d'une personne à une autre « de la main à la main ».
Les obligations liées au don manuel
Contrairement au don d’usage, le don manuel impose certaines formalités. Le bénéficiaire doit déclarer ce don au service des impôts. Cette déclaration peut être effectuée via le formulaire Cerfa 2735 ou 2734, selon le mode de paiement des droits de mutation, ou directement en ligne sur le site impots.gouv.fr.
La déclaration présente plusieurs intérêts :
Fixer une date certaine pour le don.
Justifier la provenance des fonds ou des biens.
Conséquences fiscales du don manuel
Fiscalement, le don manuel peut bénéficier d’abattements significatifs. Par exemple, un don à un enfant est exonéré jusqu’à 100 000 euros. En l’absence de stipulations contraires, le don manuel est considéré comme une avance sur l’héritage. Cela signifie qu'il sera déduit de la part successorale de l’héritier au moment de la succession.
Cependant, il est possible de déroger à cette règle. Si le donateur précise que le don est « hors part successorale », il ne sera pas pris en compte lors du calcul de la succession.
Les cadeaux faits à vos proches peuvent relever du don d’usage ou du don manuel, selon leur nature et leur valeur. Une attention particulière doit être portée aux règles en vigueur pour éviter tout malentendu juridique ou fiscal. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
Lire la suite
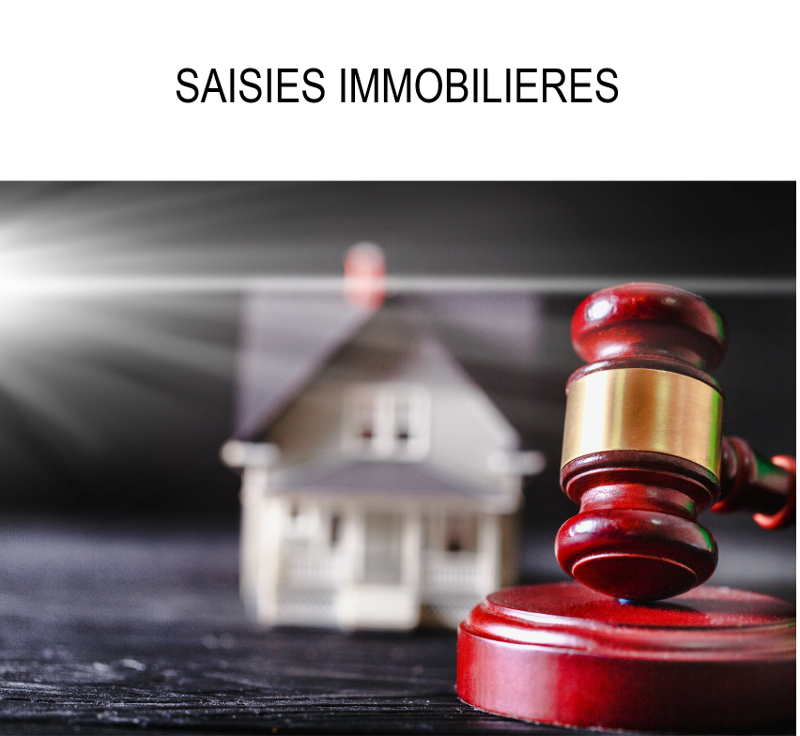
Saisie immobilière et demande de report de l'audience d'adjudication - Avocat AVIGNON
Saisie immobilière et demande de report de l'audience d'adjudication - Avocat AVIGNON
La Cour de cassation précise que toute demande visant à reporter une audience d’adjudication doit respecter les règles fixées par l’article R311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette demande doit impérativement être formée par voie de conclusions.
Cependant, la Cour rappelle également que l’absence de signature sur des conclusions constitue une simple irrégularité de forme. Cette irrégularité n’entraîne pas automatiquement la nullité des conclusions. Pour qu’une telle nullité soit prononcée, la partie qui s’en prévaut doit démontrer le préjudice causé par cette absence de signature.
Référence : Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-16.393, F-B.
Maître Elisabeth HANOCQ
Avocat au Barreau d’Avignon
Cour d’appel de Nîmes – Saisies immobilières
4o
Lire la suite

Successions : La Protection renforcée de la réserve héréditaire – Avocat sur Avignon – Droit des successions
Successions : La Protection renforcée de la réserve héréditaire
La Loi du 24 août 2021, entrée en vigueur le 1er novembre 2021, renforce les droits des héritiers réservataires. Elle introduit deux nouvelles règles dans le Code civil.
Un droit de prélèvement compensatoire
L’article 913 du Code civil prévoit un droit de prélèvement sur les biens situés en France. Ce droit s’applique si un héritier est exclu de la succession par une loi étrangère.
Une obligation renforcée pour le notaire
Le notaire a désormais un devoir accru d’information et de conseil envers les héritiers réservataires. Il doit s’assurer que leurs droits sont respectés lors du règlement de la succession.
L’article 921, alinéa 2 du Code civil précise ce point :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
Ces mesures renforcent la protection des héritiers et visent à garantir un traitement équitable lors des successions.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions.
Lire la suite

Assurances : la prescription biennale est constitutionnelle – Avocat sur Avignon
Assurances : la prescription biennale est constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel valide le délai de prescription de deux ans pour les contrats d’assurance
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 17 décembre 2021, a confirmé la conformité à la Constitution de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Cet article prévoit un délai de prescription de deux ans pour toutes les actions découlant d’un contrat d’assurance.
Ce délai commence à courir à partir de l’événement à l’origine de l’action.
Cette décision (Cons. const., 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC) était très attendue. Elle sécurise le cadre juridique des relations entre assureurs et assurés, en maintenant une règle essentielle pour garantir la prévisibilité et la sécurité des contrats.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances
Lire la suite
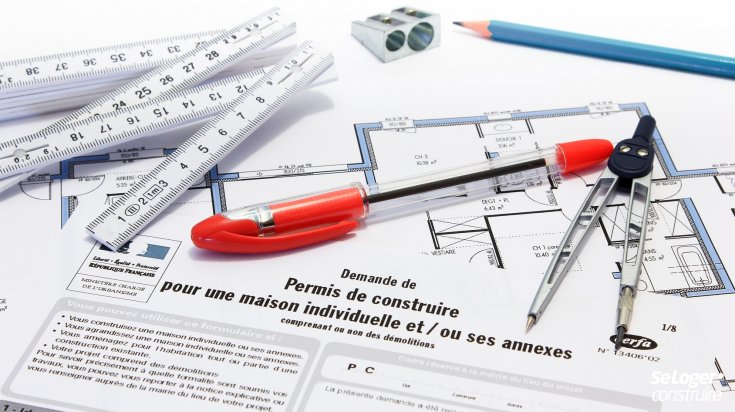
Immobilier : non-conformité au permis de construire et trouble anormal de voisinage – Avocat sur Avignon
En 2012, M. A a obtenu un permis de construire pour réaliser des travaux. Ces travaux incluaient une démolition partielle et la construction d’une maison plus grande. Le projet prévoyait aussi un étage supplémentaire et un sous-sol enterré.
Sa voisine, Mme G, a rapidement exprimé des inquiétudes. Elle a constaté des dégradations sur sa propriété, un problème de servitude de vue et une construction qu’elle jugeait trop imposante. Selon elle, les travaux ne respectaient pas le permis de construire.
Mme G a alors saisi le juge des référés. Par ordonnance du 4 juin 2014, un expert a été désigné. Celui-ci a remis son rapport le 21 décembre 2015. Sur cette base, Mme G a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d’appel de Versailles.
La voisine reprochait à M. A un trouble anormal de voisinage. Ce trouble était causé par la construction de cette maison plus grande sur le terrain voisin. Les travaux avaient également entraîné un important terrassement et une manipulation massive de terres. Ces interventions ont bloqué l’écoulement naturel des eaux, causant des dégradations à la maison de Mme G.
Bien que ces dégradations n’aient pas affecté la structure de sa maison, Mme G a obtenu gain de cause. Les juges ont estimé que les préjudices dépassaient les inconvénients normaux de voisinage. M. A a donc été condamné à réparer ces préjudices.
La cour d’appel de Versailles a fixé les indemnisations suivantes : 3.890 euros pour les préjudices matériels, 8.000 euros pour le préjudice de jouissance et 800 euros pour le préjudice moral.
Référence : Cour d’appel de Versailles, 3e chambre, 9 décembre 2021, RG n° 20/02095.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Trouble anormal de voisinage
Lire la suite

CAUTIONNEMENT : les nouveautés à compter du 1er janvier 2022 – Avocat sur AVIGNON
CAUTIONNEMENT : les nouveautés à compter du 1er janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, le cautionnement a évolué. La nullité ne s'applique plus si la caution ne recopie pas une « formule » précise dans l'acte. La caution doit simplement indiquer qu'elle s'engage à payer au créancier les dettes du débiteur défaillant, dans la limite d’un montant exprimé en lettres et en chiffres.
Un cadre plus souple et simplifié
Auparavant, la validité de certains cautionnements reposait sur des mentions manuscrites strictes. Ces mentions, conformes à des modèles prévus par la loi, visaient à informer la caution sur son engagement. Cela concernait notamment les cautionnements accordés à des créanciers professionnels, ou dans le cadre de crédits à la consommation et immobiliers.
Avec l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces règles sont remplacées par un nouveau régime général, plus simple, codifié à l’article 2297 du Code civil.
Quelles obligations pour la caution ?
Désormais, toute personne physique doit renseigner les mentions, peu importe si le créancier est un professionnel ou non. Par exemple, cela s’applique aux baux d’habitation entre particuliers.
Cependant, ces exigences ne concernent pas :
les personnes morales ;
les actes notariés ;
les actes d’avocat.
Mention à apposer par la caution elle-même
L’article 2297 ne demande plus de mention manuscrite mais une mention apposée par la caution. Cela permet de s’adapter aux contrats électroniques. Conformément à l’article 1174 du Code civil, l’apposition doit garantir qu’elle provient bien de la caution.
Sous peine de nullité, la caution doit indiquer dans l’acte :
son engagement à payer les dettes du débiteur en cas de défaillance ;
le montant garanti, exprimé en lettres et en chiffres. En cas de divergence, la somme en lettres prévaut.
Assouplissements des obligations
Les nouvelles dispositions simplifient également certains aspects :
La durée de l’engagement n’est plus obligatoire, contrairement à ce que prévoyait le Code de la consommation.
La mention « sur ses biens et revenus » n’est pas requise. Cela reste implicite, car le cautionnement engage tout le patrimoine de la caution.
Modifications concernant la solidarité
La clause de solidarité évolue : elle couvre non seulement la solidarité entre la caution et le débiteur principal, mais aussi celle entre plusieurs cautions pour une même dette. De plus, les articles L 331-3 et L 343-3 du Code de la consommation sont abrogés. Ces articles considéraient comme non écrites les clauses de solidarité en l’absence de limitation de montant pour une personne physique s’engageant envers un créancier professionnel.
Emplacement de la signature
Aucune règle stricte n’est prévue quant à l’emplacement de la signature par rapport aux mentions. Cela laisse plus de liberté dans la rédaction des actes.
Ces changements doivent être pris en compte pour tous les cautionnements signés à partir du 1er janvier 2022. Ils permettent une meilleure adaptabilité, tout en garantissant une information suffisante pour la caution.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Cautionnement
Lire la suite

Délai pour l'action en Résolution de vente - Avocat AVIGNON
Délai pour l'action en Résolution de vente
En mai 1994, Mme Y. a vendu à sa petite-fille, Mme X., sa maison à usage d'habitation. Cette vente prévoyait une réserve d'usage et d'habitation pour Mme Y. jusqu'à son décès. Le prix de vente était converti en une rente annuelle et viagère.
Mme Y. est décédée le 19 mai 2014, laissant quatre enfants pour lui succéder. En mars 2016, l'une de ses filles, Mme Z., a demandé l'annulation de la vente en viager. Toutefois, cette demande a été déclarée prescrite.
L'action en nullité fondée sur un prix dérisoire (ou vil prix) doit être intentée dans les cinq ans suivant la signature du contrat. C'est à cette date que le prix est fixé et que les conditions de la convention peuvent être examinées. Ainsi, le délai de prescription de cette action a expiré en mai 1999. Contrairement à une revendication immobilière, elle n'est pas soumise au délai trentenaire prévu par l'article 2227 du Code civil.
Par ailleurs, conformément à l'article 724 du Code civil, l'héritier reprend les droits du défunt. Toutefois, les droits de Mme Y. étaient déjà prescrits au moment de son décès. Mme Z. n'a apporté aucun élément permettant de suspendre ou d'interrompre ce délai de prescription. Par conséquent, ses droits n'ont pas été conservés jusqu'à l'assignation.
Référence : Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 20 janvier 2021, RG n° 19/00417.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – résolution de vente
Lire la suite

Divorce et indemnité d'occupation - Avocat AVIGNON
Divorce et indemnité d'occupation : Le procès-verbal de difficultés interrompt la prescription
Lorsqu'un ex-époux demande une indemnité d'occupation après le divorce, cette indemnité se limite aux cinq années précédant la demande, sauf interruption ou suspension du délai.
Dans un arrêt du 17 novembre 2021 (RG n° 20-14.914), la Cour de cassation a précisé qu'un PV de difficultés peut interrompre le délai de prescription si ce document mentionne une demande d'indemnisation. La cour a jugé que la prescription quinquennale avait été interrompue par un tel PV. Cette dernière avait estimé que la demande d'indemnisation était prescrite.
La Cour de cassation a ainsi annulé un arrêt qui condamnait Mme Y. à payer une indemnité d'occupation de 10.883 € à l'indivision post-communautaire pour l'usage privatif d'un bien immobilier. Elle a rappelé que la décision violait les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 3, du Code civil, ainsi que l'article 2244, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
La cour d'appel avait également considéré que la remise des clés par Mme Y. avait mis fin à la jouissance privative. Or, selon la Cour de cassation, le procès-verbal du 19 avril 2012 était suffisant pour interrompre la prescription. M. X. était donc en droit de réclamer une indemnisation portant sur les cinq années précédant sa demande, soit à partir du 19 avril 2007.
Cette décision souligne l’importance des actes interruptifs de prescription et leur impact sur les droits des indivisaires.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce – indemnité d’occupation - prescription
Lire la suite