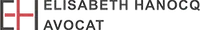Actualités
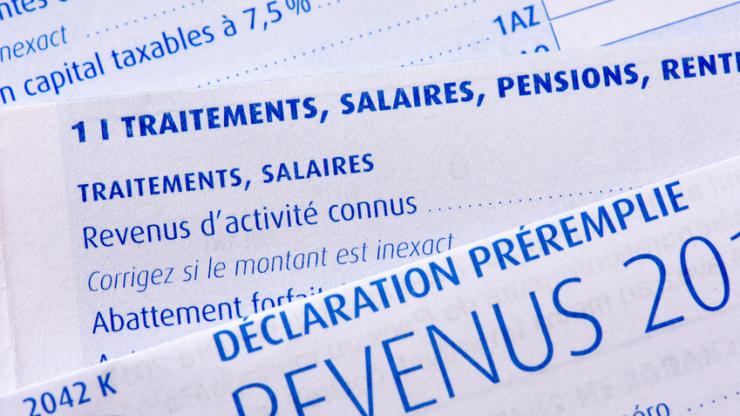
La solidarité fiscale entre époux - Avocat AVIGNON
Les époux sont solidairement responsables du paiement des impôts du couple. Cela s’applique sans distinction des revenus ou du patrimoine imposable de chacun.
Toutefois, une demande de décharge de solidarité peut être envisagée dans certaines situations. Une réponse ministérielle (Rép. min. n° 40560, J.O. A.N. 5 octobre 2021, p. 73827) précise les conditions nécessaires. Celles-ci incluent notamment une séparation effective ou un divorce, un comportement fiscal irréprochable, et une disproportion significative entre la dette fiscale et le patrimoine du demandeur.
Pour évaluer cette disproportion, la résidence principale du demandeur n’est pas prise en compte. En cas de désaccord sur cette appréciation, seul le juge administratif est compétent pour trancher.
« L'imposition commune des personnes physiques au niveau du foyer est un des fondements du droit fiscal français. La solidarité de paiement en est le corollaire et constitue l'une des garanties de l'effectivité du recouvrement. La loi n° 2007-1822 de finances pour 2008 a modifié le régime de la solidarité fiscale, en instituant, sous certaines conditions, un mécanisme de droit à décharge de responsabilité solidaire (DRS) au profit de l'ex-conjoint ou de l'ex-partenaire lié par un PACS tenu au paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce texte a abrogé les articles 1685 et 1685 bis du code général des impôts (CGI) qui prévoyaient seulement une possibilité pour chacun des conjoints ou partenaires de solliciter une décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu. Le nouveau dispositif, codifié sous l'article 1691 bis du CGI, prévoit désormais des conditions spécifiques de recevabilité : la nécessité d'une rupture de la vie commune, la constatation d'un comportement fiscal exempt de toute critique et l'existence d'une « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ». Lors des débats parlementaires, le législateur a jugé préférable de ne pas définir de façon trop précise les critères permettant de qualifier la condition tenant à la disproportion marquée, afin de laisser à l'administration une certaine souplesse d'appréciation, lui permettant de tenir compte des circonstances propres à chaque situation particulière. Il a été ainsi décidé que les modalités d'appréciation de cette condition seraient définies plus précisément par instruction. Tel est le cas pour apprécier la situation financière et patrimoniale, nette de charges, à la date de la demande de décharge, l'objectif étant d'appréhender au mieux la faculté contributive du demandeur, compte tenu de ses revenus, de ses charges, de la valeur de son patrimoine, déduction faite des dettes qui le grèvent. Il en va de même du rapport entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale devant être regardé comme manifestant une disproportion marquée. L'instruction commentant les modalités d'appréciation des nouveaux critères prévus par ce dispositif a été publiée le 20 avril 2009 (BOI n° 5 B-13-09) et complétée par diverses notes de service. En pratique, l'examen de l'existence d'une telle disproportion s'effectue au cas par cas, d'abord au regard de la situation patrimoniale. À cet égard, l'administration exclut toujours la prise en compte de la résidence principale de la personne demandeuse pour apprécier l'existence ou non de la « disproportion marquée ». L'appréciation qui est faite, au cas par cas, par l'administration sur la disproportion marquée peut être soumise au juge administratif garant du traitement équitable des demandeurs. Les modalités actuelles de mise en œuvre de ce dispositif répondent donc à la volonté du législateur qui était d'instaurer une procédure encadrée pour la personne divorcée et délaissée justifiant être dans l'incapacité de faire face au règlement de l'impôt commun. Le nombre limité de recours en contestation des décisions prises dans ce cadre par les services, soit auprès de l'administration centrale de la direction générale des Finances publiques (une quinzaine par an en moyenne) ou devant le juge (environ 30 instances déférées en appel entre 2014 et 2020), dont une partie donne d'ailleurs lieu à correction favorable à la personne demandeuse, tend à accréditer que l'essentiel des demandes débouche sur une issue donnant satisfaction au demandeur. Enfin, une ouverture plus large du droit à DRS pourrait remettre en cause l'égalité de traitement avec les personnes placées dans la même situation financière mais qui n'étant pas séparées, ne peuvent avoir droit à aucune décharge, voire encourager la connivence de contribuables simulant une situation de séparation, afin d'échapper par ce biais au recouvrement de leurs dettes, et pourrait constituer une remise en cause du principe même de la solidarité de paiement des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui découle de l'imposition par foyer. »
Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES
Lire la suite

Le vendeur immobilier est-il présumé constructeur ? - Avocat AVIGNON
Le vendeur immobilier est-il présumé constructeur ?
L’article 1792 du Code civil stipule : « Est considéré comme constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. »
Selon ce texte, tout constructeur est responsable de plein droit envers l’acquéreur des dommages suivants :
Ceux dûs à un vice du sol ;
Ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ;
Ceux rendant l’ouvrage impropre à sa destination, qu’ils affectent un élément constitutif ou d’équipement.
De plus, un vendeur qui a construit ou fait construire un ouvrage est considéré comme constructeur. Il est alors tenu d’une responsabilité pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires.
Une décision judiciaire : travaux et qualification de constructeur
Dans une affaire récente, un vendeur avait réalisé d’importants travaux avant de vendre son bien. L’acquéreur soutenait que ces travaux faisaient du vendeur un constructeur, l’obligeant à répondre des désordres à la fois décennaux et intermédiaires.
Le vendeur contestait cette interprétation. Il affirmait que les travaux étaient limités et ne relevaient que de l’entretien ou du confort.
L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers
Par un arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel de Poitiers a tranché en faveur du vendeur. Elle a relevé que l’acquéreur listait bien les travaux réalisés (menuiserie, électricité, plomberie, peinture, isolation, maçonnerie). Cependant, il ne fournissait ni analyse ni qualification juridique permettant de prouver l’ampleur de ces travaux.
Le vendeur, de son côté, arguait que les travaux représentaient une somme modeste, soit 8.000 euros, toiture incluse. Cette estimation, non contestée, était cohérente avec des travaux d’entretien ou de rénovation légère. En l’absence d’éléments tels qu’une extension, une création de pièce ou une modification majeure du bâti, la cour a conclu que les travaux n’étaient pas suffisamment significatifs pour qualifier le vendeur de constructeur.
Ainsi, la cour a confirmé le jugement initial et débouté l’acquéreur. Le vendeur n’était pas tenu aux obligations prévues par l’article 1792 du Code civil.
Référence de l’arrêt : Cour d’appel de Poitiers, 1re chambre civile, 2 novembre 2021, RG n° 19/03977.
Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Droit immobilier - Construction
Lire la suite

Agents immobiliers : l'importance du double exemplaire - Avocat AVIGNON
La Cour de cassation rappelle aux agents immobiliers l'importance de respecter strictement le formalisme des mandats de vente. Cette rigueur s’impose tout particulièrement en présence de clauses sensibles, comme :
Les clauses d’exclusivité,
Les clauses pénales,
Ou celles prévoyant des honoraires dus, même si la vente est conclue sans l'intervention de l'agent.
Pour être valables, ces clauses doivent figurer dans un mandat dont un exemplaire a été remis au client. Cette obligation est encadrée par l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
La preuve de la remise du mandat incombe à l'agent immobilier
Dans un récent arrêt (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-24526), la Cour de cassation a rappelé que c’est à l'agent immobilier de prouver qu’il a bien remis un exemplaire du mandat à son client. Sans cette preuve, il ne peut pas se prévaloir des clauses pénales ou d’exclusivité inscrites dans le mandat.
Cette règle s'applique à tous les types de mandats de vente. Ainsi, même une remise tardive de l’exemplaire peut entraîner l’annulation du mandat.
L'importance du double exemplaire
La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que la remise immédiate d'un exemplaire au client est une condition essentielle de validité :
Clause d’exclusivité : la remise d’un exemplaire est obligatoire pour que cette clause soit valable (Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 08-14787).
Formalité du double exemplaire : cette exigence s’applique à tous les mandats (Cass. 1re civ., 5 mai 1982, n° 81-11028 ; 26 novembre 1980, n° 78-14081).
Pour prévenir tout litige, il est conseillé aux agents immobiliers d'ajouter une mention comme : "Fait en double exemplaire, dont un remis à chacune des parties, qui le reconnaît."
Ils peuvent également faire signer un récépissé de remise. Ces précautions simples peuvent s’avérer déterminantes en cas de litige.
Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Droit immobilier - mandat de vente
Lire la suite

Immobilier : La promesse unilatérale de vente ne peut se rétracter - Avocat AVIGNON
Qu’est-ce qu’une promesse unilatérale de vente ?
L’article 1124 du Code civil définit la promesse unilatérale de vente comme un avant-contrat. Dans ce cadre, le promettant s’engage à vendre un bien si le bénéficiaire décide de lever l’option d’achat. Pendant la durée de l’option, deux scénarios sont possibles :
Le bénéficiaire accepte, et le contrat de vente devient définitif à la date de la levée d’option.
Il refuse, et le contrat n’est pas formé.
Mais que se passe-t-il si le promettant se rétracte avant la levée de l’option ?
L’évolution jurisprudentielle
Avant l’ordonnance du 10 février 2016, la rétractation du promettant n’avait pour conséquence que d’engager sa responsabilité civile. Le bénéficiaire pouvait alors demander des dommages-intérêts, mais pas la réalisation forcée de la vente.
Depuis cette réforme, et pour les promesses conclues après le 1er octobre 2016, l’article 1124 alinéa 2 du Code civil permet d’obtenir l’exécution forcée de la vente. Cette solution a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 (n° 20-17554).
Un exemple concret
Dans une affaire récente, des indivisaires avaient vendu des parcelles à une société pour un euro symbolique. La vente prévoyait une exploitation des terrains par extraction de substances minérales, suivie de leur retour aux vendeurs après la fin des travaux.
Malgré plusieurs avenants de prolongation, la société a rétracté sa promesse de revente. Les indivisaires ont alors intenté une action en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou, à défaut, une indemnisation.
La position de la Cour de cassation
La Cour d’appel d’Agen avait rejeté leur demande, estimant que la rétractation de la société avant la levée d’option empêchait la formation du contrat. Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021 (n° 20-19514), a cassé cette décision.
Elle a rappelé que l’engagement du promettant était ferme et définitif, dès la signature de l’avant-contrat. En l’absence de stipulation contraire, la rétractation du promettant ne peut empêcher la réalisation forcée de la vente.
En conclusion
La jurisprudence actuelle confirme une sécurisation des engagements pris dans le cadre des promesses unilatérales de vente. Depuis 2016, le promettant ne peut plus se rétracter librement avant la levée de l’option, renforçant ainsi la protection du bénéficiaire. Cette évolution est essentielle pour assurer la stabilité et la prévisibilité des relations contractuelles.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – PROMESSE DE VENTE
Lire la suite

Caducité du compromis de vente - Avocat AVIGNON
Caducité du compromis de vente en cas de non-respect des délais
Le 16 mars 2017, M. A a signé un compromis de vente avec M. B pour acheter un bien immobilier. Ce compromis était soumis à une condition suspensive : l’obtention d’un prêt immobilier. Une agence immobilière a agi en tant qu’intermédiaire.
Le contrat prévoyait que la condition suspensive serait réalisée dès qu’une banque émettrait une offre de prêt. Cette offre devait être présentée avant le 2 mai 2017. Par ailleurs, la vente devait être finalisée par acte authentique au plus tard le 12 juin 2017.
Le 9 mai 2017, une banque a donné à M. A un accord de principe pour le prêt. Cependant, l’offre de prêt n’a été émise que le 16 juin 2017, soit après les délais prévus.
Le 5 juin 2017, M. B, le vendeur, a envoyé une lettre recommandée pour annuler le compromis de vente. Il considérait que la condition suspensive n’avait pas été respectée faute d’offre de prêt reçue avant le 2 mai 2017.
Malgré cela, le notaire a convoqué les parties pour signer l’acte de vente. Le vendeur ne s’est pas présenté. Une seconde convocation a été émise, puis le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
M. A a alors assigné M. B en justice pour faire reconnaître la validité de la vente. Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2021, la Cour d’appel de Pau a statué :
Caducité automatique de la promesse de vente : Si la condition suspensive n’est pas réalisée dans les délais prévus, le compromis devient caduc de plein droit. Cette caducité s’applique sauf accord explicite des parties pour prolonger les délais.
Offre de prêt tardive : Une offre de prêt obtenue après la date limite de signature de l’acte authentique n’a aucun effet sur la caducité du compromis.
Accord de principe insuffisant : Un accord de principe émis par une banque, assorti de conditions telles que l’acceptation par une assurance ou la régularisation de garanties, ne remplit pas les exigences de la condition suspensive.
Responsabilité du vendeur : La caducité du compromis, due à la non-réalisation de la condition suspensive dans les délais prévus, n’est pas imputable au vendeur. Par conséquent, la responsabilité du vendeur ou de son mandataire ne peut être engagée.
Cet arrêt illustre l’importance de respecter scrupuleusement les délais prévus dans un compromis de vente. Les parties doivent s’assurer de la clarté des conditions suspensives et de leur réalisation dans les délais impartis. En cas de doute, un conseil juridique adapté est indispensable.
Cour d’appel de Pau, 1re chambre, 7 septembre 2021, RG n° 18/03169
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Compromis de vente
Lire la suite

Distances des plantations entre voisins - Avocat AVIGNON
Plantations en limite de propriété : que dit la loi ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a rappelé les règles essentielles prévues par l’article 671 du Code civil. Ce texte précise :
Les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent respecter des distances minimales avec la propriété voisine. Ces distances sont fixées par des règlements locaux ou des usages reconnus. À défaut, la loi prévoit :
Deux mètres de la limite pour les plantations dépassant deux mètres de hauteur.
Un demi-mètre pour celles qui restent en dessous.
Les arbres peuvent toutefois être plantés en espaliers contre un mur séparatif, sans distance minimale, mais ne doivent pas dépasser la crête du mur. Si ce mur n’est pas mitoyen, seul le propriétaire peut y appuyer des espaliers.
Le litige : un cas de bambous et de marronniers
Dans cette affaire, M. et Mme W demandaient l’arrachage de bambous plantés en limite de propriété par leur voisin, ainsi que l’élagage des branches de marronniers dépassant sur leur terrain.
La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 novembre 2019, avait condamné le voisin à arracher les bambous sous astreinte. Insatisfait, celui-ci s’était pourvu en cassation.
La décision de la Cour de cassation
Dans son arrêt, la Cour de cassation a infirmé la décision de la Cour d’appel. Elle a rappelé que :
Les arbres peuvent être plantés à moins de deux mètres de la limite si deux conditions sont remplies :
Respecter une distance minimale d’un demi-mètre de la limite.
Maintenir les plantations à une hauteur maximale de deux mètres.
En cas de non-respect de ces règles, le voisin peut demander :
L’arrachage des arbres.
Leur réduction à une hauteur de deux mètres.
L’option appartient alors au propriétaire des plantations.
Une base légale insuffisante
La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel n’avait pas vérifié si les bambous étaient plantés à moins de 50 cm de la limite séparative. En conséquence, sa décision manquait de fondement juridique.
Cet arrêt confirme que l’arrachage des plantations ne peut être exigé que si celles-ci sont situées à moins de 50 cm de la limite de propriété. Les propriétaires doivent donc veiller à respecter les distances légales pour éviter tout contentieux.
Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Droit immobilier - Troubles de voisinages - distance des plantations
Lire la suite

Conditions de la prescription acquisitive : Il faut justifier des actes matériels de possession - Avocat AVIGNON
Le terme « usucapion », aussi appelé « prescription acquisitive », désigne un mécanisme juridique permettant d’acquérir un droit de propriété par une possession paisible, publique et prolongée. La durée nécessaire pour prétendre à ce droit est définie par la loi.
Ce droit s’applique aussi bien aux biens mobiliers (par exemple une marque ou un objet) qu’aux biens immobiliers (comme un immeuble ou une servitude apparente).
Les règles encadrant la prescription acquisitive sont prévues aux articles 2255 à 2277 du Code civil. Ces délais peuvent être interrompus ou suspendus sous certaines conditions.
À l’opposé, la prescription extinctive ôte un droit réel ou personnel en raison de l’inaction prolongée de son titulaire.
Les conditions de la prescription acquisitive
Pour acquérir un bien par prescription, la possession doit répondre à plusieurs critères :
Être continue et non interrompue.
Être paisible.
Être publique.
Être non équivoque et exercée à titre de propriétaire (article 2261 du Code civil).
Les actes de simple tolérance ou de pure faculté ne permettent ni possession ni prescription (article 2262 du Code civil).
Les délais de prescription
Selon l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, si une personne acquiert un bien immobilier de bonne foi et avec un juste titre, elle peut en devenir propriétaire en 10 ans.
Illustration par une affaire judiciaire
Dans une affaire récente, Mme C reprochait à son voisin d’avoir entrepris des travaux sur une partie de son terrain, causant des dégradations à une voûte située au rez-de-chaussée de son bâtiment. Elle a alors assigné ce voisin en justice, réclamant :
La restitution de la partie de terrain occupée.
La réalisation de travaux de réparation.
Le paiement de dommages et intérêts.
Le voisin a invoqué la prescription acquisitive pour conserver la partie de terrain en question. Cependant, le juge doit constater des actes matériels révélant une possession effective pour valider une telle prétention.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a précisé : une décision ne peut conclure à la prescription acquisitive sans identifier des actes matériels de possession antérieurs aux travaux ou sans prouver une possession trentenaire.
Arrêt cité : Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 juin 2021, pourvoi n° 20-16.955.
Lire la suite

Trouble anormal de voisinage : les aboiements du chien du voisin - Avocat AVIGNON
Trouble anormal de voisinage : les aboiements du chien du voisin
Trouble anormal de voisinage : une atteinte au droit des propriétaires
Le trouble anormal de voisinage repose sur un principe clair : nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux de la vie en communauté. Ce principe découle de l'article 544 du Code civil, qui précise : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
D’autres articles du Code civil renforcent cette protection. L’article 1243 rend le propriétaire d’un animal responsable des dommages causés par celui-ci. Par ailleurs, l’article 1240 oblige toute personne ayant causé un dommage à en assumer la réparation.
Une affaire marquante : des aboiements incessants
Dans un litige, Mme X habitait un appartement situé au-dessus de celui de M. et Mme M. Ces derniers ont rapporté des nuisances importantes causées par les aboiements du chien de Mme X.
Mme M, professeur, préparait ses cours à domicile et s’occupait de son fils handicapé souffrant d’un trouble attentionnel. M. M travaillait également chez lui deux jours par semaine. Ces conditions rendaient leur tranquillité indispensable.
Le règlement de copropriété interdisait les animaux domestiques bruyants, soulignant l’importance de préserver la quiétude des occupants. Pourtant, des témoignages attestent que le chien aboyait pendant plusieurs heures, en semaine et parfois sans interruption durant les week-ends. Certains aboiements ont été décrits comme des « hurlements à la mort ».
Des preuves incontestables
Un huissier a constaté, lors d’une visite, des hurlements quasi-continus provenant de l’appartement de Mme X. Ces hurlements ont repris après son départ. Les témoignages et ce constat suffisent à établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a jugé que ces nuisances avaient causé un préjudice direct à M. et Mme M. La Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, ordonnant :
La cessation des troubles sous astreinte de 50 € par jour, à compter du 15e jour après la notification de la décision.
2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
500 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Cette décision illustre que le trouble anormal de voisinage n’est pas toléré, et que les juridictions sont prêtes à le sanctionner fermement. Propriétaires ou locataires doivent veiller à respecter la tranquillité de leurs voisins pour éviter de telles condamnations.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, 24 septembre 2020, RG n° 17/14699
Lire la suite

Location meublé : les obligations du propriétaire - Avocat AVIGNON
Les obligations du propriétaire pour la location d’un logement meublé
Lorsqu’un propriétaire loue un logement meublé en tant que résidence principale, il doit respecter des obligations précises. Ces règles garantissent au locataire un logement décent et correctement équipé.
Un logement décent : les critères essentiels
Le propriétaire doit proposer un logement répondant aux normes de décence. Cela signifie que le bien loué doit :
Comprendre au moins une pièce principale de 9 m² avec une hauteur sous plafond minimale de 2,20 mètres, ou offrir un volume habitable de 20 m³.
Ne pas présenter de risques pour la santé ou la sécurité du locataire :
Fenêtres et portes étanches à l’air et à l’eau,
Garde-corps en bon état,
Installations électriques et de gaz conformes aux normes,
Pièces principales bien éclairées naturellement et correctement ventilées.
Ne pas abriter d’animaux nuisibles ou de parasites (cafards, punaises de lit, rats, etc.).
Respecter des critères de performance énergétique minimale :
Bonne isolation contre les infiltrations d’air,
Fenêtres et portes étanches.
Inclure certains équipements indispensables : eau potable, chauffage, évacuation des eaux, coin cuisine, WC séparés, et un réseau électrique permettant un usage courant des appareils.
Si le logement ne respecte pas ces critères, le locataire peut demander par écrit au propriétaire de réaliser les travaux nécessaires. Une lettre recommandée avec accusé de réception permet de formaliser cette demande en précisant les délais convenus. En cas de non-respect, le propriétaire risque des sanctions : réduction de loyer ou dommages et intérêts.
Enfin, un logement non décent prive le locataire des aides au logement.
Les équipements obligatoires d’un logement meublé
Depuis août 2015, un logement meublé doit inclure une liste précise d’équipements pour être conforme :
Literie (avec couette ou couverture).
Volets ou rideaux dans les chambres.
Appareils de cuisine : plaques de cuisson, four ou micro-ondes, réfrigérateur avec compartiment de congélation (à -6 °C minimum).
Vaisselle et ustensiles pour préparer et consommer les repas.
Table et sièges.
Étagères de rangement.
Luminaires.
Matériel d’entretien adapté (balai, aspirateur, serpillière, selon les sols).
En l’absence de ces équipements, un juge peut requalifier le bail en location vide, modifiant ainsi les obligations juridiques liées à la location.
Autres obligations du propriétaire
Le propriétaire doit respecter la vie privée du locataire. Il ne peut pas entrer dans le logement sans son accord, même pour des visites ou des travaux. Avant d’entreprendre des rénovations, il doit informer le locataire par écrit.
De plus, le propriétaire doit fournir gratuitement une quittance de loyer au locataire. Elle peut être envoyée par mail si le locataire le souhaite.
Enfin, le locataire a aussi des obligations : paiement du loyer, souscription à une assurance habitation et entretien courant du logement.
Référence juridique
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 définit la liste des équipements obligatoires pour un logement meublé. Assurez-vous de le consulter pour rester conforme aux réglementations en vigueur.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Tribunal judiciaire d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES - bail d'habitation - location meublé
Lire la suite