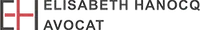Actualités

La signature d’un PV de bornage vaut acquiescement à une servitude de passage – Avocat Avignon Nîmes
La signature d’un PV de bornage vaut acquiescement à une servitude de passage
Le 14 mai 2019, M. et Mme [F], M. et Mme [X], ainsi que M. et Mme [N], tous propriétaires de parcelles desservies par une voie privée, ont assigné en référé Mme [H] et M. [T]. Ils demandaient la remise en état de l’usage d’une servitude de passage grevant une parcelle acquise par ces derniers en indivision en février 2013. Une astreinte était également sollicitée pour assurer l’exécution.
M. et Mmes [F], [X] et [N] contestaient la décision de la cour d’appel qui avait rejeté leur demande de retrait immédiat des piquets métalliques bloquant l’usage de la servitude. Selon eux, un procès-verbal de bornage peut servir de titre pour définir l’assiette d’une servitude de passage, à condition qu’il ait été signé par les propriétaires des parcelles concernées.
Cependant, la cour d’appel avait estimé que les propriétaires des parcelles dominantes ne prouvaient pas que les acquéreurs de la parcelle servant avaient connaissance de la servitude au moment de leur achat. Cette décision s’appuyait sur le fait que les opérations de bornage invoquées avaient été réalisées plusieurs années après cette acquisition.
Toutefois, les demandeurs soutenaient que le procès-verbal de bornage, signé par les propriétaires du fonds servant, était précédé d’un constat d’accord entre les riverains reconnaissant l’existence de la servitude. Ce constat avait servi de base aux travaux du géomètre. Ainsi, ils considéraient que la signature du procès-verbal impliquait l’acquiescement des propriétaires du fonds servant à la servitude.
En ne recherchant pas si cet acquiescement résultait de la signature du procès-verbal, la cour d’appel n’avait pas fondé sa décision sur une base légale suffisante. C’est en ce sens que la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 février 2022 (3ème chambre civile, RG n° 20-19.954), a cassé cette décision.
Ce qu'il faut retenir
Cet arrêt souligne l’importance d’une analyse approfondie des faits et documents, notamment lorsqu’un accord préalable des parties pourrait être démontré. Il rappelle également que le procès-verbal de bornage peut constituer un élément déterminant dans les litiges relatifs aux servitudes de passage.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Servitudes de passage - Bornages
Lire la suite

Cautionnement : Un gérant de société est-il un "emprunteur averti" ? - Avocat Avignon
La seule qualité de gérant de société ne suffit pas à conférer à un emprunteur la qualité d’emprunteur averti. Sans éléments supplémentaires, il doit être considéré comme profane.
Cependant, l’emprunteur ne peut reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. L’offre de prêt notarié précisait clairement les caractéristiques du contrat. Elle indiquait que le prêt était à terme fixe et remboursable grâce à une épargne en assurance-vie. Elle alertait également l’emprunteur sur le rendement incertain de ce placement et le risque que le capital ne soit pas suffisant pour rembourser le prêt à son échéance.
En outre, le prêt était garanti par une hypothèque et adossé à un contrat d’assurance-vie qui a permis de générer un montant de 58 323 euros. L’emprunteur disposait également de revenus mensuels d’environ 2 698 euros.
Enfin, aucun endettement supplémentaire contemporain n’a été signalé par l’emprunteur. Ses revenus étaient donc compatibles avec le crédit souscrit.
Cour d'appel de Colmar, 1ère chambre civile, section A, 13 octobre 2021, RG n° 19/02597.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Cautionnement
Lire la suite

Immobilier : Les maires sont-ils tenus de fournir les coordonnées des propriétaires fonciers de leurs communes ?
Question écrite n° 41319, 28/09/2021 ) - collectivités territoriales - André Chassaigne - Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Question de M. André Chassaigne
Député Puy-de-Dôme -
André Chassaigne interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les transmissions des données de propriétaires par les mairies. La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018) relative à la protection des données personnelles a réglementé la transmission des données personnelles. Ces nouvelles règles concernent également les collectivités territoriales. Les mairies sont souvent confrontées à des demandes d'ordre cadastral, notamment sur des parcelles boisées pour connaître le nom et l'adresse des propriétaires en vue d'une éventuelle transaction, ou lorsqu'un tiers a endommagé des arbres sur une parcelle jouxtant celle où il a entrepris des travaux d'abattage, voire pour solliciter un droit de passage temporaire sur des parcelles aux fins de pouvoir extraire une coupe de bois. Certaines collectivités refusent de donner le nom et l'adresse des propriétaires concernés, d'autres s'autorisent à fournir les renseignements sollicités en demandant une formulation écrite et le renseignement du formulaire Cerfa n° 6815-EM-SD. Ces renseignements sont diffusés au regard de l'interprétation qui est faite du règlement général de la protection des données et de la pertinence de la requête. Ainsi, les réponses à ces demandes divergent d'une collectivité à l'autre. Afin de clarifier ces situations et de les rendre homogènes, il lui demande de donner un cadre précis aux collectivités dans le domaine de la transmission des données personnelles.
Publication au J.O. Assemblée nationale du 28 sept. 2021
Réponse
L'article L.107 A du livre des procédures fiscales) prévoit un droit de communication des informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Un immeuble au sens de cet article s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété (article R* 107 A-1 du livre des procédures fiscales)), ce qui comprend aussi les parcelles boisées. Sont ainsi communicables aux tiers de manière ponctuelle les seules informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale d'un immeuble, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication (avis de la CADA du 6 juin 2018), n° 20184943).Les articles R* 107 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales) encadrent cette procédure et en précisent les modalités. Ainsi, les demandes de communication des informations relatives à un immeuble doivent être effectuées par écrit auprès des services de l'administration fiscale ou des communes. En dehors des dérogations prévues au II de l'article R* 107 A-3, le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. La communication a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Enfin, l'article 86 du règlement général de la protection des données (RGPD)) et l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précisent que le droit à la protection des données à caractère personnel doit être concilié avec le droit d'accès du public aux documents administratifs et aux archives publiques. En conséquence, le titulaire d'un droit d'accès exercé conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ne peut être regardé comme une personne non autorisée au sens du RGPD). Ainsi, le cadre légal et réglementaire prévu par le livre des procédures fiscales, qui est conforme au RGPD), est suffisamment précis pour être appliqué de manière homogène par l'ensemble des communes.
Publication au J.O. Assemblée nationale du 15 févr. 2022
Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Droit immobilier
Lire la suite

SUCCESSIONS : Le recel successoral n'est pas caractérisé en raison du repentir de l'héritier – Avocat sur Avignon
Le recel successoral et le repentir spontané de l'héritier
Le recel successoral ne peut être établi si l’héritier se repent de manière spontanée. Le fait de cacher des comptes bancaires et des dons manuels à son frère lors de l’ouverture de la succession ne suffit pas. Ces actes matériels doivent être accompagnés d’une intention frauduleuse pour constituer un recel successoral.
Dans cette affaire, l’héritier a révélé l’existence des comptes et des dons litigieux avant toute assignation en justice. Ces révélations ont été faites avant l'engagement des poursuites pour recel. L’appelant ne peut donc prétendre ignorer le montant des dons reçus par son frère. Ces montants figurent dans une déclaration de succession rectificative élaborée avec l’assistance de son propre avocat.
Les dons manuels mentionnés dans cette déclaration concordent avec un autre document. Ce dernier met en évidence une indemnité de réduction à la charge de l’héritier. Cette indemnité correspond, à l’euro près, au montant du chèque qu’il a adressé à son frère. Ce paiement visait à mettre fin à une atteinte à la réserve héréditaire.
En outre, un comportement frauduleux ne peut être déduit du seul fait que cette indemnité ne reflète pas les droits exacts de l’héritier dans l’indivision successorale. Par ailleurs, les révélations de l’héritier ont été spontanées, car elles n’ont pas été faites sous contrainte de ses cohéritiers.
Enfin, les motivations de cette révélation n’ont pas pu être déterminées avec certitude. Elles sont, de toute façon, sans importance pour apprécier la spontanéité du repentir. Même si ce repentir était motivé par la crainte de poursuites fiscales ou pénales, cela reste sans incidence.
Référence : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 28 octobre 2020, RG n° 17/19959
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions – Recel successoral
Lire la suite

DIVORCE : La preuve des récompenses dues par la communauté - Avocat sur Avignon
La preuve d’un droit à récompense en faveur d’un époux suppose la preuve de l’encaissement des fonds propres par la communauté.
Pour la Cour d’appel d’Agen, le seul fait que l’acquisition de l’immeuble commun ait été effectuée par les époux, sans recours à un emprunt, 3 jours après la vente de l’immeuble propre du mari, ne suffit pas à prouver que cet achat a été financé à l’aide de fonds propres
En l’absence de tout autre élément, comme par exemple des relevés bancaires permettant de déterminer sur quels comptes a été versé le prix perçu lors de la vente et à partir de quels comptes a été financée la nouvelle acquisition, rien n’atteste de l’encaissement des fonds propres par la communauté, de sorte qu’il n’y a pas lieu à récompense en faveur du mari.
La preuve d’un tel encaissement ne saurait résulter de la seule présomption d’acquêts.
Cour d’appel d’Agen, 1re chambre civ., 25 mai 2020, RG n° 17/01548
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce – Liquidation de communauté – Récompenses
Lire la suite
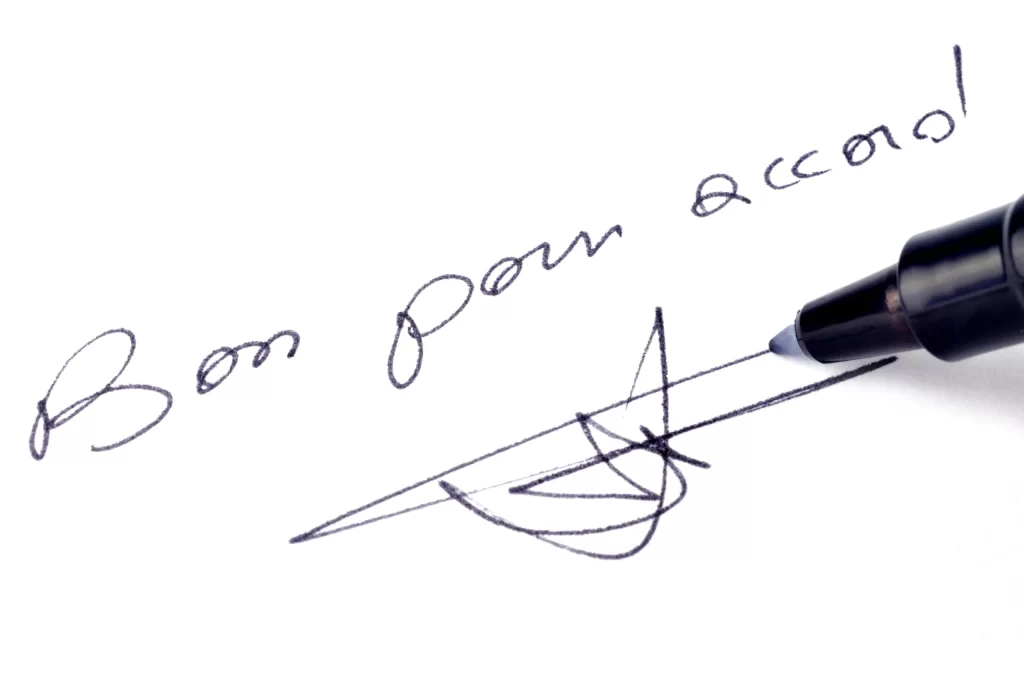
Cautionnement et principe de proportionnalité – Avocat sur AVIGNON
La disproportion de l'engagement d'une caution sous le régime de la séparation de biens : une analyse jurisprudentielle
Une personne mariée sous le régime de la séparation de biens s’est engagée comme caution solidaire pour garantir un emprunt contracté par une société. Lorsque cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, la banque s’est retournée contre la caution pour obtenir le remboursement. En défense, la caution a invoqué la disproportion de son engagement.
En appel, les juges ont donné raison à la caution. Ils ont estimé que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Ils ont notamment pris en compte qu’elle était propriétaire, en indivision avec son épouse, d’une maison. Toutefois, étant mariée sous le régime de la séparation de biens, ce bien n’entrait pas dans son patrimoine propre. De plus, son épouse n’avait pas donné son consentement au cautionnement.
La Cour de cassation a annulé cette décision. Dans son arrêt du 19 janvier 2022 (Cass. 1ère civ., n° 20-20.467), elle a rappelé que la disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens doit s’apprécier à partir de ses biens et revenus personnels, mais aussi en incluant sa quote-part dans les biens indivis. Elle a fondé sa décision sur les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du Code de la consommation, et 1538 du Code civil.
Cet arrêt met en lumière l’importance d’intégrer l’ensemble des éléments patrimoniaux à l’analyse de la disproportion. Même sous le régime de la séparation de biens, une quote-part d’indivision peut avoir une incidence déterminante.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – cautionnement – principe de proportionnalité
Lire la suite

COPROPRIETE : l’AG approuvant les comptes rend exigible la créance sur le copropriétaire - Avocat AVIGNON
Impayés de charges de copropriété : les obligations des copropriétaires
M. Pascal P. possède plusieurs lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Le 19 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, l’a assigné en justice. L’objet du litige : des charges de copropriété non réglées.
Une fois approuvés par l’assemblée générale, les comptes du syndic rendent les charges certaines, liquides et exigibles. Chaque copropriétaire doit alors payer sa quote-part.
Un copropriétaire ne peut pas refuser de payer ces charges s’il n’a pas contesté l’approbation des comptes dans les délais fixés par l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Référence jurisprudentielle : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 janvier 2022, RG n° 18/15416.
Différentes catégories de charges
L’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 définit les charges comme les dépenses définitives qui incombent aux copropriétaires, réparties selon leur quote-part.
Ces charges se distinguent :
des provisions sur charges (sommes versées en attente du solde final),
et des avances (fonds réservés pour des besoins spécifiques, définis par le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale).
Participation aux charges : une obligation
Les copropriétaires doivent contribuer à deux types de charges :
Charges liées aux services collectifs et équipements communs, comme l’ascenseur ou le chauffage collectif.
Charges relatives aux parties communes, couvrant leur entretien, administration et conservation.
Dans tous les cas, seule une décision de l’assemblée générale peut fixer le montant des charges communes.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES - copropriété
Lire la suite

Responsabilité du médecin : manquement à l'obligation d'information – Avocat sur AVIGNON
Obligation d'information : un cas de défaut lié à une prostatectomie
Un patient atteint d’un cancer de la prostate a subi une prostatectomie radicale avec curage bilatéral. À la suite de cette opération, il n’a retrouvé aucune fonction sexuelle malgré plusieurs traitements.
La jurisprudence impose aux professionnels de santé un devoir clair : informer leurs patients des risques connus au moment de l’intervention. Ce principe garantit à chaque patient le droit d’être éclairé sur les risques avant tout examen, traitement ou mesure préventive. Le consentement, recueilli par le praticien, repose sur cette information préalable. Le non-respect de cette obligation cause un préjudice au patient qui en était légalement bénéficiaire.
Une obligation inscrite dans le Code de la santé publique
L’article L 1111-2 du Code de la santé publique précise ce devoir : toute personne a droit à des informations sur son état de santé, les traitements envisagés, leurs conséquences et les risques prévisibles, même graves. Les autres solutions possibles, ainsi que les conséquences d’un refus de traitement, doivent également être abordées. Si des risques nouveaux sont découverts après une intervention, le patient doit en être informé, sauf impossibilité de le contacter.
La loi exige que le praticien prouve qu’il a respecté ce devoir d’information. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Un défaut d’information avéré
Dans cette affaire, le patient, souffrant désormais de troubles sexuels, affirme ne pas avoir été informé des risques liés à l’intervention. Un courrier du chirurgien à son médecin traitant mentionnait diverses options thérapeutiques. Cependant, aucun élément ne prouve que les risques de l’opération aient été explicitement expliqués.
Évoquer d’autres options thérapeutiques ne signifie pas automatiquement que les risques de la chirurgie ont été abordés. À l’inverse, l’absence d’information sur ces risques entraîne un consentement vicié.
Le formulaire de consentement signé par le patient était générique et ne concernait pas spécifiquement l’opération envisagée. Il ne constitue donc pas une preuve d’un consentement éclairé. De plus, bien qu’une notice d’information de l’Association française d’urologie ait été évoquée, elle n’a pas été remise directement par le praticien.
Une responsabilité engagée
Le chirurgien a été jugé responsable pour manquement à son devoir d’information. Le tribunal a estimé que ce manquement avait causé une perte de chance pour le patient de renoncer à l’opération. Cette perte de chance a été évaluée à 20 %.
Référence : CA Angers, 11 janvier 2022, n° 18/00386, Jurisdata n° 2022-000360.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Responsabilité civile – Responsabilité médicale – Perte de chance
Lire la suite

Vente immobilière et devoir de loyauté – AVOCAT SUR AVIGNON
Vente immobilière et devoir de loyauté des vendeurs
Un litige a opposé des vendeurs à un acquéreur concernant l’état de la maison vendue.
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur doit garantir les défauts cachés de la chose vendue. Ces défauts doivent rendre la chose impropre à l’usage prévu ou réduire cet usage de façon telle que l’acheteur n’aurait pas acheté ou aurait payé un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
Pour invoquer cette garantie, l’acheteur doit apporter la preuve de :
L’existence d’un défaut caché précis et antérieur à la vente.
Un défaut suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage prévu.
Dans cette affaire, un rapport d’expertise a confirmé que les désordres rendaient la maison impropre à sa destination. Par exemple, les fenêtres étaient bloquées et la solidité de l’ouvrage était compromise.
Certaines fissures étaient dissimulées sous du papier peint ou du lambris, les rendant invisibles. Un acquéreur non averti ne pouvait pas détecter leur nature évolutive ni leur gravité.
Entre particuliers, une clause d’exclusion de garantie ne peut être écartée que si le vendeur est de mauvaise foi. Cela signifie qu’il doit avoir eu connaissance du vice. La charge de preuve repose sur l’acheteur.
Dans ce cas, les fissures avaient été aggravées par des conditions climatiques, mais leur origine était liée à la construction elle-même. Les vendeurs avaient masqué ces fissures en faisant effectuer des travaux de rebouchage avec enduit et résine pour améliorer l’aspect visuel. Ils ne pouvaient ignorer les risques pour la structure de la maison. Cela constitue un manquement à leur devoir de loyauté.
La clause de non-garantie a donc été écartée. Les acquéreurs ont demandé la résolution de la vente, qui a été prononcée. Les vices cachés et les désordres rendaient la maison impropre à l’usage prévu.
Cour d’appel d’Angers, Chambre civile A, 7 décembre 2021, RG n° 18/00638
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Résolution de vente immobilière
Lire la suite