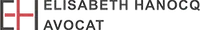Actualités

Divorce : La prestation compensatoire ne doit pas porter atteinte au montant de l’allocation adulte handicapé
Divorce : La prestation compensatoire ne doit pas porter atteinte au montant de l’allocation adulte handicapé
Lors d’une procédure de divorce, une épouse avait contesté la prestation compensatoire payable en huit ans par mensualités. Elle demandait à la place un capital, à verser dans un délai maximal de 12 mois, sur la base des articles 270 et suivants du Code civil.
L’épouse faisait valoir que le paiement étalé sur huit ans aurait pour conséquence de réduire le montant de l’allocation adulte handicapé qu’elle percevait.
Dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 21-10.026), la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel. Cette dernière avait pris en compte les revenus et charges des deux parties à la date où elle statuait pour fixer le montant de la prestation compensatoire.
Cependant, la cour d’appel n’avait pas répondu à l’argument de l’épouse selon lequel la rente réduirait son allocation adulte handicapé. Ce manquement viole l’article 455 du Code de procédure civile, qui impose de motiver toute décision de justice.
Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Divorce - Prestation compensatoire
Lire la suite

Liquidation judiciaire : les poursuites contre l’époux – Avocat Avignon
Une banque avait accordé un crédit immobilier à deux époux mariés sous le régime de la communauté. Les deux conjoints étaient engagés solidairement pour le remboursement de ce prêt.
Par la suite, l’époux a été placé en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre privilégié. L’immeuble financé par le prêt a été vendu par le liquidateur, permettant un remboursement partiel de la créance. La procédure de liquidation judiciaire s’est ensuite achevée par une clôture pour insuffisance d’actif.
Quatre ans plus tard, un fonds de titrisation a saisi le compte bancaire de l’épouse en pratiquant une saisie attribution. Cette dernière a contesté cette saisie.
Dans un arrêt du 2 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la validité de la saisie. La haute juridiction a estimé que l’épouse, en tant que codébitrice solidaire, ne pouvait pas invoquer l’interdiction de reprise des poursuites prévue par l’article L. 643-11 du code de commerce. Cette interdiction, spécifique au débiteur soumis à une liquidation judiciaire, ne s’étend pas au conjoint codébiteur solidaire.
Référence : Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2022, RG n° 20-18.791.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit commercial – Liquidation judiciaire - saisie attribution
Lire la suite

Lotissement et violation du cahier des charges : les délais de prescription - Avocat AVIGNON
Construction illicite dans un lotissement : prescription trentenaire ou quinquennale ?
Dans un lotissement, un propriétaire a contesté la construction réalisée par son voisin en limite de propriété. Cet ouvrage, destiné à servir d’abri et de local à vélos, aurait été construit en violation des règles du cahier des charges du lotissement.
Le plaignant a engagé deux actions en justice contre son voisin : La démolition de la construction en question et une indemnisation pour le préjudice personnel subi.
La Cour de cassation a été saisie pour déterminer les délais de prescription applicables à ces deux demandes.
Dans un arrêt rendu le 6 avril 2022 (Cass. civ. 3e, 06.04.2022, n°21-13891), la Cour a précisé les règles suivantes :
Action en démolition : Cette action vise à faire supprimer une construction réalisée en violation d’une charge réelle inscrite dans le cahier des charges du lotissement. Il s’agit d’une action réelle immobilière. Elle est donc soumise à une prescription de 30 ans (article 2227 du Code civil).
Action en réparation : Cette demande concerne le préjudice personnel causé par la violation des règles du lotissement. Elle est qualifiée d’action personnelle et se prescrit par 5 ans (article 2224 du Code civil).
Le point de départ de ces délais de prescription dépend de la date à laquelle le propriétaire lésé a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des faits en question. En principe, cette date correspond à l’achèvement de la construction contestée.
Revirement par rapport à la Cour d’appel de Paris
Dans cette affaire, la Cour de cassation a annulé une décision de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 08.01.2021, RG 19/10197). Celle-ci avait considéré que l’action en démolition relevait d’une prescription quinquennale, applicable aux actions personnelles.
Cependant, la Cour de cassation a validé le rejet de l’action en indemnisation pour préjudice personnel. Cette demande, présentée trop tardivement, était effectivement prescrite.
Points clés à retenir
Cet arrêt clarifie les délais applicables aux litiges entre colotis dans un lotissement :
30 ans pour obtenir la démolition d’une construction réalisée en violation des charges réelles du cahier des charges.
5 ans pour obtenir réparation d’un préjudice personnel causé par ces mêmes violations.
La distinction entre ces deux types d’actions repose sur leur nature juridique : action réelle ou action personnelle.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Vente immobilière : Refus par le vendeur de réitérer la vente par acte authentique – Avocat Avignon
Dans une affaire récente, un compromis de vente immobilière stipulait que la vente ne serait parfaite qu’après la signature de l’acte authentique. Le transfert de propriété était donc conditionné à cette étape.
Les juges ont considéré que la signature de l’acte authentique était une condition essentielle du consentement du vendeur. Elle n’était pas une simple formalité.
En refusant de signer cet acte, les vendeurs ont empêché la finalisation de la vente. Par conséquent, l’acheteur ne pouvait pas obtenir la reconnaissance de la perfection de la vente. Il ne pouvait pas non plus contraindre les vendeurs à régulariser l’acte devant notaire.
Cependant, l’acheteur avait mis les vendeurs en demeure de régulariser la vente. Les juges ont jugé sa demande d’application de la clause pénale justifiée.
Cette clause prévoyait une pénalité égale à 10 % du prix de vente. La cour n’a pas estimé ce montant excessif.
Les vendeurs ont donc été condamnés à payer 15.145 euros à l’acheteur, en application de la clause pénale.
Référence juridique : Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 11 janvier 2022, RG n° 20/01583
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Compromis de vente - Refus de réitération de l’acte authentique
Lire la suite

Agent immobilier : Achat d’un bien immobilier pour un proche – Avocat Avignon
L’achat d’un bien par un agent immobilier : que dit la loi ?
L’article 1596 du Code civil interdit formellement à un agent immobilier mandaté pour la vente d’un bien de l’acquérir, que ce soit en son nom propre ou par l’intermédiaire d’un tiers.
La déontologie de la profession renforce cette interdiction. Un agent immobilier s’engage à ne pas acheter, même indirectement, un bien pour lequel il a un mandat. Cela inclut toute acquisition par un proche ou par une structure dans laquelle il détient une participation (C. déont. art. 9°).
Dans un dossier récent, une SCI vend un bien à un couple par l’intermédiaire d’une agence immobilière. Cette agence est gérée par le fils des acquéreurs et fonctionne sous forme de société.
La SCI décide alors d’attaquer en justice. Elle demande l’annulation de la vente pour violation de l’article 1596 du Code civil. Elle réclame aussi des dommages-intérêts pour un prétendu manquement de l’agence à son devoir de conseil.
La décision de la Cour de cassation
Après un premier jugement (Cass. 3e civ. 16 mai 2019, n° 18-17772), la Cour de cassation se prononce à nouveau en décembre 2021. Elle rejette les demandes de la SCI, en se fondant sur deux arguments principaux :
Connaissance des liens familiaux
La SCI était informée de la relation entre les acquéreurs et le gérant de l’agence. Ce lien figurait clairement dans la promesse de vente.
Absence d’interposition
Le bien n’a pas été acquis au profit de l’agence ni du fils des acquéreurs. Ces derniers ont acheté le bien pour leur usage personnel, dans l’objectif de compléter leur retraite. Ils ont encaissé les loyers, géré directement les conflits locatifs, notamment les impayés, et assumé toutes les responsabilités afférentes.
Ainsi, pour la Cour, la vente a été réalisée au bénéfice exclusif des acquéreurs nommés dans l’acte de vente, sans interposition d’un tiers (Cass. 3e civ. 8 déc. 2021, n° 20-21841).
Cette décision rappelle que l’interdiction prévue par l’article 1596 du Code civil doit s’appliquer strictement. Toutefois, la présence de liens familiaux entre un agent immobilier et un acquéreur ne suffit pas, à elle seule, à rendre une vente nulle. Pour qu’une telle nullité soit prononcée, il faut démontrer une réelle interposition ou un contournement des règles.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Mandat
Lire la suite

Location : Fin du bail verbal et tacite reconduction – Avocat Avignon
Location : Fin du bail verbal et tacite reconduction
Un contrat de location doit obligatoirement être rédigé par écrit. Cette obligation est prévue par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989. Pourtant, en pratique, il arrive que des baux verbaux soient conclus entre les parties.
Dans une affaire récente, un immeuble avait été frappé d’un arrêté de péril. Ce bâtiment représentait un danger pour ses occupants et les voisins. Des travaux de mise en sécurité étaient nécessaires.
La Commune a demandé aux propriétaires de rembourser les frais de relogement d’un occupant. Le tribunal saisi a toutefois constaté que cet occupant était sans droit ni titre.
Face à cette situation, la Commune a assigné les propriétaires et l’occupant en tierce opposition. La Cour de cassation est intervenue et a annulé le jugement en se basant sur l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule :
« Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. »
La réponse de la cour de cassation
Selon la Cour de cassation, un bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale est soumis aux mêmes règles qu’un contrat écrit. Pour des bailleurs personnes physiques, en indivision ou en SCI familiale, la durée minimale est de trois ans. À défaut de congé en bonne et due forme, ce bail est tacitement reconduit par périodes de trois ans.
Ainsi, l’absence d’écrit ne rend pas le bail invalide. Un bail verbal reste régi par la loi du 6 juillet 1989 et se reconduit automatiquement s’il n’y a pas de congé.
Référence : Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-19.450.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Bail d’habitation
Lire la suite

Servitude de vue et troubles de voisinage : Prescription acquisitive pour une véranda
Une demande a été faite concernant des troubles anormaux de voisinage, en raison de l’implantation irrégulière d’une véranda.
Cette demande a été jugée irrecevable car étant prescrite.
En effet, la véranda litigieuse était implantée depuis plus de cinq ans. Le fait que le requérant n’ait pas occupé personnellement l’immeuble, donné en location, est sans incidence sur le cours de la prescription.
La véranda litigieuse comporte des fenêtres en limite de propriété s’ouvrant sur la propriété voisine, générant des vues contraires aux dispositions de l’article 678 du Code civil.
Toutefois, il est établi que cette véranda a été édifiée depuis plus de trente ans, de sorte que son propriétaire est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive.
Par conséquent, le mur construit par le propriétaire requérant dans l’unique but d’obstruer la vue cause un trouble anormal de voisinage et se heurte donc à la servitude de vue acquise par prescription trentenaire.
Sa destruction doit donc être ordonnée sous astreinte.
Cour d’appel de Douai, 1re chambre, 2e section, 27 Janvier 2022, RG n° 20/00050
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Trouble anormal de voisinage - Servitudes
Lire la suite

L’indivisaire qui occupe seul un bien immobilier doit payer une indemnité d’occupation - Avocat Avignon
Lorsqu’un bien immobilier est détenu en indivision, l’indivisaire qui l’occupe seul doit, en principe, verser une indemnité d’occupation aux autres indivisaires. Cette règle découle de l’article 815-9 du Code civil, qui précise que l’indivisaire jouissant seul d’un bien indivis est tenu, sauf accord contraire, de payer une indemnité.
Dans une affaire récente, une indivisaire a demandé en justice la fixation d’une indemnité d’occupation. Elle reprochait à une autre indivisaire d’utiliser seule un bien indivis, tant pour un usage personnel que professionnel.
Cependant, la défenderesse a nié occuper exclusivement le bien. Elle a mis en avant le fait qu’elle possédait d’autres domiciles et que la demanderesse disposait elle aussi des clés de la propriété, y séjournant régulièrement pour les vacances.
Le Tribunal a estimé qu’aucune preuve d’une occupation exclusive n’avait été apportée.
Pour qu’une indemnité d’occupation soit due, l’indivisaire doit empêcher les autres de jouir du bien, et ce même si ces derniers n’y résident pas effectivement.
En appel, la Cour a relevé que la défenderesse reconnaissait avoir utilisé le bien, mais uniquement une partie, et pour une durée limitée. La demanderesse, quant à elle, conservait les clés et continuait à venir séjourner sur place.
Ainsi, la Cour d’appel a conclu que l’occupation exclusive et privative n’était pas prouvée. En conséquence, elle a rejeté la demande d’indemnité d’occupation.
Cour d’appel de Paris, Pôle 3 Chambre 1, 23 février 2022, RG 19/18085
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Indivision
Lire la suite

PPromesse de vente : validité de la rétractation exercée par email - Avocat Avignon
Courriel ou lettre recommandée : quel mode de rétractation pour une promesse de vente ?
Un simple courriel envoyé au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir une rétractation d'une promesse de vente offre-t-il les mêmes garanties qu'une lettre recommandée avec avis de réception ? Cette question a été au cœur d'une affaire tranchée par la Cour de cassation.
Un couple bénéficiait d'une promesse unilatérale de vente pour un appartement. Cette promesse, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, avait été reçue le 29 avril 2017. En cas de non-réalisation de la vente, une indemnité d'immobilisation était prévue.
Le 9 mai 2017, les acquéreurs ont informé le notaire par courriel qu'ils souhaitaient exercer leur droit de rétractation. Cette démarche a été confirmée le lendemain par une lettre recommandée avec avis de réception.
Les vendeurs ont alors assigné les acquéreurs en paiement de l'indemnité d'immobilisation. Ils ont soutenu que le courriel ne valait pas notification régulière.
La décision de la cour d'appel
La cour d'appel de Paris a donné raison aux vendeurs (CA Paris, 23 oct. 2020). Elle a estimé que l'envoi d'un courriel ne permettait ni d'identifier clairement les parties ni de garantir la date de réception.
Elle a également rappelé que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret du 9 mai 2018 reconnaissent l'équivalence entre une lettre recommandée papier et une lettre recommandée électronique, cette équivalence ne s'étend pas à un simple courriel.
La cassation
La Cour de cassation a annulé cette décision (Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, n° 20-23.468). Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Selon elle, les juges auraient dû vérifier si l'envoi du courriel, reçu par le notaire le 9 mai 2017 à 18 h 25 et confirmé en justice, ne présentait pas des garanties équivalentes à celles d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Ce qu'il faut retenir
Un courriel ne garantit pas automatiquement les mêmes protections qu'une lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, s'il peut être prouvé que le notaire, mandaté pour recevoir la notification, a bien reçu le courriel et attesté de sa réception, ce mode de communication pourrait être jugé suffisant.
Cette décision rappelle l'importance de bien respecter les formes exigées par la loi pour exercer son droit de rétractation. En cas de doute, il reste préférable d'utiliser une lettre recommandée avec avis de réception ou une lettre recommandée électronique.
Pour toute question sur les formalités juridiques liées à une vente immobilière, n'hésitez pas à consulter un avocat compétent en droit immobilier.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Promesse de vente - Rétractation
Lire la suite