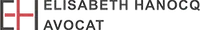Actualités

Divorce : Le délai de prescription applicable aux créances entre époux - Avocat Avignon Nîmes
Prescription des créances entre époux séparés de biens : ce qu’il faut savoir
Les créances qu’un époux séparé de biens peut réclamer à l’autre sont soumises au délai de prescription de droit commun. En matière personnelle ou mobilière, et en l’absence de règles spécifiques, ce délai est fixé à 5 ans par l’article 2224 du Code civil.
C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2022. Ce délai de 5 ans commence à courir à partir du moment où le divorce acquiert force de chose jugée.
Ainsi, si vous êtes concerné par une telle situation, il est essentiel de bien surveiller ce délai pour faire valoir vos droits.
Référence : Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725, F-B.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Divorce – Régimes matrimoniaux
Lire la suite

Délai pour déposer la déclaration de succession - Avocat Avignon
Délai pour déposer la déclaration de succession
Question de M. Michel Zumkeller, Député Territoire de Belfort -
Michel Zumkeller interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant l'obligation qui pèse sur les héritiers de déposer la déclaration de succession et de payer les droits de succession dans un délai de 6 mois à compter du décès. Dans la mesure où les notaires disposent de tous les éléments pour établir la déclaration, et que les héritiers ont requis contractuellement les notaires de préparer la déclaration et de leur présenter aux fins de signature, il souhaite savoir s'ils ont une obligation de moyen ou de résultat de présenter aux héritiers la déclaration dans le délai de six mois suivant le décès.
Publication au J.O. Assemblée nationale du 20 octobre 2020
Réponse
En cas de décès d'une personne, les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale dans les délais prévus par les articles 641 et 642 du code général des impôts.
Le délai de principe fixé par ces dispositions est de six mois à compter du jour du décès. En cas de non-respect du dépôt de cette formalité dans les délais, les héritiers seront solidairement tenus de verser des intérêts de retard. C'est aux héritiers qu'il revient de faire cette déclaration. Au regard de la complexité des informations à produire et du nombre parfois élevé d'héritiers concernés, l'intervention d'un notaire est toutefois indispensable la plupart du temps. Le notaire est, d'après la jurisprudence, tenu d'une obligation de moyen. Pour engager sa responsabilité, il convient de démontrer que celui-ci a commis une faute dans l'exercice de sa mission.
Ainsi, si celui-ci n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires, permettant d'assurer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits dans les délais fiscaux, sa responsabilité pourra être engagée.
Si le règlement de la succession est complexe et ne permet pas au notaire de déposer la déclaration de succession dans les délais, il se doit d'attirer l'attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits afin d'éviter le paiement de pénalités de retard.
Le notaire est en effet tenu d'un devoir de conseil envers ses clients, et sa responsabilité peut être engagée à ce titre (v. par exemple CA Limoges, Ch. civ., 18 nov. 2004, n° 02/01042).
Publication au J.O. Assemblée nationale du 15 février. 2022
Question écrite n° 33080, 20/10/2020 - donations et successions
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Successions
Lire la suite

Concubinage et enrichissement sans cause - Avocat AVIGNON
Concubinage et enrichissement sans cause : La participation d’un concubin au paiement d’un crédit immobilier sur un bien appartenant à l’autre concubin trouve sa contrepartie dans l’hébergement dont il a bénéficié durant la vie commune.
Enrichissement injustifié : le cas d’un ex-concubin débouté
L’article 1303 du Code civil établit un principe clair : une personne qui s’enrichit injustement au détriment d’une autre doit indemniser cette dernière. Cette indemnité correspond à la moindre valeur entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
Le cas étudié concerne Florence P. et Benoît B., anciens concubins ayant vécu ensemble de 2001 à l’automne 2014.
En 2006, Mme P. a reçu de ses parents une parcelle de terrain située à Romans-sur-Isère, par donation-partage. Sur ce terrain, le couple a construit une maison d’habitation. La construction a été financée grâce à deux prêts contractés auprès du Crédit Immobilier de France. Ces prêts s’élevaient à 21 500 € et 98 635,73 €.
Après leur séparation, M. B. a assigné Mme P. devant le tribunal de grande instance de Valence. Il demandait une indemnité de 40 000 € au titre d’un enrichissement injustifié, ainsi que des frais de procédure.
Le tribunal a statué, et l’affaire a poursuivi son cours en appel.
M. B. affirmait avoir pris en charge la moitié des mensualités des prêts, les frais de notaire et diverses dépenses liées à la maison, bien qu’elle appartenait à Mme P. Cependant, la cour d’appel de Grenoble a rejeté sa demande.
Les juges ont estimé que l’immeuble, propriété de Mme P., a servi de domicile commun au couple pendant sept ans. Les dépenses engagées par M. B. trouvent leur justification dans l’hébergement dont il a bénéficié durant la vie commune, ainsi que dans sa participation aux charges du ménage. Aucun enrichissement injustifié de Mme P. n’a donc été établi.
Cette décision, rendue le 1er février 2022 par la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble (RG n° 20/00840), rappelle que l’enrichissement injustifié suppose l’absence de contrepartie réelle et légitime.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier - Concubinage
Lire la suite

Cautionnement : Le délai de prescription – Avocat Avignon
Le 20 avril 2022, la Cour de cassation a rendu une décision importante, marquant un revirement de jurisprudence. Elle a jugé que la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du Code de la consommation, fondée sur la qualité de consommateur, affecte désormais le droit du créancier. Ainsi, cette prescription constitue une exception inhérente à la dette, que la caution peut invoquer si elle y a intérêt, en vertu de l’article 2253 du Code civil.
Dans cette affaire, une banque avait accordé, le 22 novembre 2007, un prêt immobilier à un couple d’emprunteurs. Ce prêt était garanti par la société CNP Caution. Plus tard, la banque a assigné les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues.
La banque contestait le rejet de sa demande en paiement contre la caution par la cour d'appel. Selon elle, la prescription biennale de l’article L218-2 était une exception personnelle propre au débiteur principal. Elle considérait que la caution ne pouvait pas l’opposer au créancier.
Jusqu’alors, la jurisprudence considérait effectivement que la prescription biennale était une exception personnelle au consommateur. Elle ne pouvait donc pas être utilisée par la caution contre le créancier (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-16.147).
Cependant, la Cour de cassation a relevé que cette solution pénalisait le débiteur principal. En effet, celui-ci pouvait être confronté à un recours personnel de la caution, ce qui le privait du bénéfice de la prescription biennale. De plus, cette approche était moins favorable pour les cautions ayant souscrit leur engagement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui prévoit la possibilité pour une caution d’invoquer les exceptions du débiteur.
La Cour de cassation a donc modifié sa position. Elle a déclaré que la prescription biennale, bien qu’issue de la qualité de consommateur, affecte le droit du créancier. Par conséquent, cette prescription devient une exception inhérente à la dette, que la caution peut opposer.
En validant cette analyse, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Celle-ci avait constaté que le délai de prescription biennale était acquis pour l’action en paiement de la banque. Elle avait aussi relevé que la caution utilisait cet argument pour contester la demande en paiement formulée contre elle.
En conséquence, la Cour de cassation a rejeté la demande en paiement de la banque contre la caution.
Référence : Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-22.866, FS-B.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES- Droit des contrats - cautionnement
Lire la suite

Action en Justice du syndicat des copropriétaires : les charges de copropriété - Avocat AVIGNON
Conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires ont l'obligation stricte de payer les charges et provisions à échéance. Le syndic de copropriété est habilité à engager une action en recouvrement sans autorisation préalable de l'assemblée générale.
Les charges deviennent exigibles dès que l'assemblée générale approuve les comptes. Le délai de deux mois prévu pour les contestations des opposants ou défaillants doit cependant être expiré. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels lancés par le syndic constituent une créance certaine, liquide et exigible, dans les limites et conditions fixées par ce texte.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer l'existence et le montant de sa créance. Le juge évalue librement si les preuves apportées sont suffisantes pour justifier la demande.
L'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que certains frais, comme ceux liés aux mises en demeure, aux relances ou à la prise d'hypothèque, sont à la charge exclusive du copropriétaire concerné. Cela inclut également les frais d'actes des huissiers et les droits de recouvrement ou d'encaissement.
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, 17 février 2022, RG n° 20/00757.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier - copropriété
Lire la suite

Agent immobilier : Des honoraires négociables - Avocat AVIGNON
Nouvelles règles pour les honoraires des agents immobiliers dès le 1er avril 2022
Depuis le 1er avril 2022, les honoraires des agents immobiliers sont encadrés par de nouvelles règles, issues de l'arrêté du 26 janvier 2022. Ce texte modifie l'arrêté du 10 janvier 2017 et impose des obligations supplémentaires aux professionnels de l'immobilier.
Mention obligatoire d’un honoraire « maximum »
Les agents immobiliers doivent désormais préciser, dans toutes leurs annonces, que le montant de leurs honoraires représente un « montant maximum ». Cette précision vise à faciliter la négociation des honoraires par les clients. Ainsi, les particuliers peuvent plus aisément obtenir une baisse des frais pour les services liés à la vente, la location ou la gestion d’un bien immobilier.
Informations renforcées en zones d'encadrement des loyers
Dans les zones où le loyer est encadré, les agents immobiliers doivent inclure plusieurs informations dans leurs annonces :
Le loyer de base, hors charges.
Le loyer de référence majoré, qui constitue le plafond légal du loyer de base.
Éventuellement, le complément de loyer, si applicable.
Ces nouvelles obligations visent à garantir une transparence accrue pour les locataires potentiels.
Un cadre légal renforcé
L’arrêté du 26 janvier 2022, publié au Journal officiel le 4 février 2022, s’inscrit dans une démarche de protection des consommateurs. Il renforce les droits des clients face aux professionnels de l’immobilier, tout en améliorant la lisibilité des informations disponibles.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Successions : Loi application à un testament – Avocat Avignon
Le testament et les règles juridiques applicables au jour de sa rédaction
Un testament est toujours soumis à la loi en vigueur à la date de sa rédaction. Ainsi, un legs ne peut être affecté par une interdiction légale non encore en vigueur à cette époque. C’est le cas de l’article L.116-4, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles, qui interdit aux auxiliaires de vie à domicile de recevoir un legs.
Dans cette affaire, une personne décédée sans descendance avait rédigé un testament authentique, complété par un codicille. Elle désignait plusieurs légataires universels ainsi que des légataires à titre particulier. Des conflits ont surgi entre eux concernant la succession, conduisant à une intervention judiciaire.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2019, avait estimé que le legs à l’une des légataires à titre particulier était frappé d’interdiction. En se basant sur l’article L.116-4 précité, elle avait jugé que les légataires universels n’étaient pas tenus de délivrer ce legs.
Cependant, cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 23 mars 2022 (Cass., 1re civ., n° 20-17.663). La Cour s’est appuyée sur l’article 2 du Code civil, qui stipule que la loi ne dispose que pour l’avenir et ne peut avoir d’effet rétroactif.
En effet, au moment de la rédaction du testament, l’article L.116-4 n’était pas encore en vigueur. Par conséquent, la loi en question ne pouvait pas s’appliquer au legs consenti. La Cour a rappelé un principe fondamental : les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur à la date où ils ont été établis, sauf disposition contraire.
Cette décision illustre l’importance de vérifier la législation applicable au moment de la rédaction d’un acte juridique. Pour toute question relative aux successions et testaments, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

La signature du PV de bornage vaut acquiescement à une servitude de passage - Avocat AVIGNON
La signature du PV de bornage vaut acquiescement à une servitude de passage
Le 14 mai 2019, M. et Mme [F], M. et Mme [X], ainsi que M. et Mme [N], tous propriétaires de parcelles desservies par une voie privée, ont assigné Mme [H] et M. [T] en référé. Ils demandaient le rétablissement, sous astreinte, de l’usage d’une servitude de passage grevant une parcelle cadastrée [Cadastre 1], acquise en indivision par Mme [H] et M. [T] en février 2013.
Par la suite, Mme [H] a cédé ses droits indivis à M. [T] et a été mise hors de cause.
M. et Mme [F], M. et Mme [X] et M. et Mme [N] contestaient une décision de la cour d’appel. Celle-ci avait refusé de retirer les piquets métalliques bloquant l’usage de la servitude de passage. Ils soutenaient qu'un procès-verbal de bornage peut servir de titre pour définir l’assiette d’une servitude de passage, dès lors qu’il est approuvé par les propriétaires des parcelles concernées.
Cependant, la cour d’appel a rejeté leur demande. Elle a estimé que les opérations de bornage invoquées étaient postérieures à l’acquisition de la parcelle par M. [T]. Elle a ajouté que les demandeurs n’avaient pas apporté la preuve que M. [T] était informé de l’existence de la servitude au moment de son achat.
La Cour de cassation a toutefois censuré cette décision. Elle a relevé que la cour d’appel n’avait pas examiné un élément crucial. En l’occurrence, elle n’avait pas vérifié si l’approbation et la signature, par M. [T], du procès-verbal de bornage, basé sur un constat d’accord précédent entre riverains, pouvaient valoir acceptation de la servitude.
En omettant cette analyse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 février 2022, RG n° 20-19.954).
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier - Bornages
Lire la suite

Vente immobilière : L’action de l’acquéreur pour vices cachés doit être exercée dans un double délai
Vente immobilière : L’action de l’acquéreur pour vices cachés doit être exercée dans un double délai
L’acquéreur victime d’un vice caché doit agir rapidement contre son vendeur. Deux délais s’imposent : 2 ans à partir de la découverte du vice et 5 ans à compter de la signature du contrat de vente. Ces délais s’appliquent indépendamment de la prescription liée à la chaîne des contrats. Ainsi, même si l’action du vendeur intermédiaire contre le fabricant est prescrite, celle de l’acquéreur final peut rester recevable.
L’article 1648 du Code civil prévoit que l’action pour vice caché doit être engagée dans les deux ans suivant la découverte du défaut. Par ailleurs, l’article L.110-4 du Code de commerce fixe un délai général de prescription de cinq ans pour les obligations commerciales, sauf délais spécifiques plus courts.
Dans une affaire récente, un vendeur professionnel avait vendu un véhicule à un particulier. Ce dernier, confronté à un vice caché, a attaqué le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. La Cour d’appel avait estimé que l’action contre le fabricant était prescrite. La Cour de cassation a cependant tranché autrement.
Elle a statué que, dans des ventes successives, le sous-acquéreur peut agir contre le vendeur intermédiaire, même si ce dernier ne peut plus engager de recours contre le vendeur initial.
Pour une vente impliquant un commerçant (vendeur intermédiaire) et un particulier (acquéreur final), deux échéances doivent donc être respectées :
Un délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché.
Un délai de cinq ans à partir de la date de la vente initiale.
Cette jurisprudence de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (n° 20-13.493), confirme que les droits du sous-acquéreur prévalent sur les prescriptions dans une chaîne de contrats.
Ainsi, les particuliers doivent être vigilants face aux vices cachés et agir dans les délais légaux. Les vendeurs professionnels doivent anticiper les recours possibles même si leurs propres droits contre le fabricant sont éteints.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Vente – Garantie des vices cachés
Lire la suite