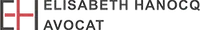Actualités

Elagage des arbres du voisin – Avocat AVIGNON NIMES
Elagage des arbres du voisin
Les articles 671 à 673 du Code civil encadrent les règles concernant les arbres situés à proximité des propriétés voisines. Ces dispositions précisent :
Les distances légales à respecter entre un arbre et la limite séparative (article 671) ;
Les droits du voisin de demander l’arrachage d’un arbre planté à une distance inférieure à la distance légale (article 672) ;
Les conditions dans lesquelles un voisin peut exiger l’élagage des branches ou des racines s’étendant sur son fonds (article 673).
Les droits du voisin
Un voisin peut exiger que les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux dépassant sur sa propriété soient coupées par leur propriétaire. Il a également le droit de récupérer les fruits tombés naturellement sur son terrain.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui envahissent son terrain, le voisin peut les couper lui-même à la limite de la propriété. Ce droit, tout comme celui de faire couper les branches, est imprescriptible, c’est-à-dire qu’il ne s’éteint pas avec le temps.
Une affaire d’élagage devant la Cour de cassation
Dans une affaire récente, les propriétaires d’une maison ont assigné leurs voisins pour demander l’abattage, l’étêtage et l’élagage de plusieurs arbres. Ils ont également réclamé des indemnités pour divers préjudices.
La cour d’appel avait condamné les voisins à procéder, sous astreinte, à l’élagage annuel des branches dépassant sur leur terrain. Cette décision a été contestée devant la Cour de cassation, qui l’a annulée.
La Haute Juridiction a rappelé qu’il n’est pas possible de présumer pour l’avenir que le propriétaire ne respectera pas son obligation légale d’élagage. En imposant une astreinte annuelle, la cour d’appel a violé l’article 673 du Code civil.
Ce qu’il faut retenir
Le droit à l’élagage des branches ou des racines qui empiètent sur votre propriété est garanti par la loi. Cependant, les tribunaux ne peuvent pas anticiper une éventuelle violation future de cette obligation légale. Les recours doivent se limiter à des situations concrètes et actuelles.
Si vous êtes confronté à un conflit concernant l’élagage des arbres ou arbustes de votre voisin, un avocat peut vous accompagner pour faire valoir vos droits et éviter tout contentieux prolongé.
Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n° 19-23.456
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Troubles de voisinage
Lire la suite

Annulation d’un testament – avocat AVIGNON
Annulation d’un testament
La Cour de cassation a précisé le point de départ du délai de prescription pour l’action en restitution, après l’annulation d’un testament. Cette action se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil, partir du moment où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a eu connaissance des faits permettant d’exercer son action.
L’article 2224 du Code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En cas d’une annulation de testament, le délai commence à courir lorsque l’héritier ou le légataire rétabli a eu connaissance de l’appropriation des biens par le bénéficiaire du testament annulé. Ce délai ne peut débuter avant le prononcé de la nullité du testament.
Une illustration par une affaire récente
Dans cette affaire, les ayants droit du défunt ont appris par le Notaire, le 3 octobre 2013, que des sommes avaient été versées à un légataire. Ils ont introduit leur action en restitution le 4 août 2017.
La cour d’appel a jugé leur action recevable, estimant qu’elle avait été intentée dans les délais légaux. La Cour de cassation a confirmé cette analyse. Elle rappelle que le délai de prescription avait bien commencé à courir à partir du moment où les héritiers avaient eu connaissance des faits.
En cas d’annulation d’un testament, les héritiers ou légataires disposent d’un délai de cinq ans pour agir en restitution. Ce délai débute à partir de la date où ils ont pris connaissance des faits permettant d’agir.
Pour toute question relative à la contestation d’un testament ou à l’exercice d’une action en restitution, un avocat spécialisé en droit des successions peut vous accompagner et défendre vos droits.
Référence : Cour de cassation, 1ère civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Divorce et insaisissabilité de la résidence principale : ce que dit la loi – Avocat AVIGNON NIMES
Divorce et insaisissabilité de la résidence principale : ce que dit la loi
La résidence principale d’un entrepreneur individuel bénéficie d’une protection légale. Cette insaisissabilité vise à préserver le lieu de vie de l’entrepreneur et de sa famille en cas de difficultés financières. Toutefois, cette protection peut être remise en cause dans certaines situations, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2022.
Un entrepreneur individuel, en procédure de divorce, voit son ordonnance de non-conciliation attribuer la jouissance exclusive du logement familial à son épouse. Contraint de quitter la maison, il se retrouve quelques années plus tard en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Le liquidateur obtient l’autorisation de vendre la maison, désormais occupée exclusivement par l’épouse. Celle-ci s’y oppose, invoquant l’insaisissabilité de la résidence principale prévue par l’article L. 526-1 du Code de commerce.
La cour d’appel donne raison à l’épouse et refuse la vente. Elle considère que la maison reste protégée par l’insaisissabilité, car elle constitue toujours la résidence principale de l’entrepreneur, malgré la procédure de divorce.
La position de la Cour de cassation
La chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une position différente. Elle rappelle que l’insaisissabilité de la résidence principale doit s’apprécier concrètement. Au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’entrepreneur n’occupait plus la maison. Celle-ci avait été attribuée à son épouse par l’ordonnance de non-conciliation.
Par conséquent, la maison ne pouvait plus être considérée comme la résidence principale de l’entrepreneur. La protection légale prévue par l’article L. 526-1 ne s’applique donc pas. Le liquidateur est autorisé à procéder à la saisie et à la vente de l’immeuble.
Ce qu’il faut retenir
La protection de la résidence principale d’un entrepreneur individuel n’est pas absolue. En cas de divorce, si la jouissance du logement est attribuée à l’un des époux avant l’ouverture d’une procédure collective, l’immeuble peut perdre son statut de résidence principale. Cette décision permet au liquidateur de saisir et vendre le bien pour rembourser les créanciers.
Pour toute question sur l’insaisissabilité des biens, les procédures collectives ou les droits en cas de divorce, un avocat expérimenté peut vous conseiller et défendre vos intérêts.
Référence : Cour de cassation, Chambre com., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-22.768, F-B
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Divorces - Liquidations
Lire la suite

Une servitude de passage ne peut s’établir que par titre – Avocat AVIGNON
Une servitude de passage ne peut s’établir que par titre
Un exploitant agricole utilisait depuis 33 ans un chemin situé sur une parcelle voisine pour accéder à sa maison et à son terrain agricole. Ce passage régulier avec des engins agricoles de grande taille a été bloqué par la pose d’un bloc en pierre, rendant le chemin impraticable.
L’exploitant a alors assigné son voisin pour faire reconnaître une servitude de passage et demander la suppression de l’obstacle.
Décision des juges
La cour d’appel de Dijon a rejeté sa demande. Elle a rappelé que, selon l’article 691 du Code civil, une servitude de passage ne peut être établie que par un titre. Une possession prolongée, même pendant plusieurs décennies, ne suffit pas à créer ce droit.
Par ailleurs, l’exploitant ne pouvait invoquer un état d’enclave, car son terrain disposait déjà d’un accès direct à la voie publique via un autre chemin situé sur l’une de ses parcelles.
Les arguments rejetés
Le requérant avait avancé que le chemin voisin était plus pratique et adapté pour ses engins agricoles. Cependant, les juges ont souligné que :
L’article 682 du Code civil n’autorise pas à exiger un passage plus direct à travers une propriété voisine si un accès existant, même moins pratique, est disponible.
Le chemin déjà en sa possession permettait de passer avec ses engins, y compris une moissonneuse.
Ce qu’il faut retenir
Une servitude de passage ne peut être reconnue sans titre, même après plusieurs années d’usage continu. De plus, un propriétaire ne peut pas revendiquer un passage sur une propriété voisine si son terrain n’est pas enclavé. Cela s'applique même si l’accès existant est moins pratique ou plus long.
Référence : Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 juin 2022, RG n° 21/00469
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – servitude de passage
Lire la suite

Procédure accélérée d'expulsion de squatteurs – Avocat Avignon
Procédure Accélérée d'Expulsion des Squatteurs
Depuis le 1er janvier 2021, la procédure administrative d'expulsion des squatteurs occupant illégalement un logement a été simplifiée. Cette évolution résulte de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap) du 7 décembre 2020, qui vise à rendre cette procédure plus rapide et plus efficace.
Depuis le 1er février 2021, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent recourir à un huissier de justice pour les aider dans les démarches nécessaires à la récupération de leur bien. Cette assistance inclut plusieurs étapes clés :
Constater l'occupation illégale ;
Déposer une plainte pour violation de domicile ;
Rédiger et transmettre une demande auprès du préfet ;
Suivre les démarches administratives et, si besoin, accompagner le propriétaire dans une procédure judiciaire.
Étapes Essentielles de la Procédure Administrative
Pour obtenir la libération d’un logement occupé illégalement, le propriétaire doit suivre les étapes suivantes :
Porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie pour violation de domicile.
Prouver que le logement est son domicile. Cela peut être fait à l’aide de factures, de documents fiscaux ou d’une attestation d’un voisin.
Faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.
Demander au préfet d’ordonner aux squatteurs de quitter les lieux.
Le préfet dispose de 48 heures pour notifier sa décision ou justifier un refus. Si la mise en demeure de quitter le logement n’est pas respectée dans un délai de 24 heures, le préfet doit ordonner l’évacuation forcée.
Particularités de la Trêve Hivernale
La trêve hivernale, qui interdit en principe les expulsions locatives entre novembre et mars, ne s’applique pas aux occupations illégales. Ainsi, les propriétaires peuvent faire valoir leurs droits à tout moment de l’année.
Cette procédure simplifiée offre une solution plus rapide et efficace pour déloger les squatteurs tout en respectant les droits des propriétaires. Si vous êtes confronté à une telle situation, n’hésitez pas à solliciter un avocat ou un huissier de justice pour vous accompagner.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
Lire la suite
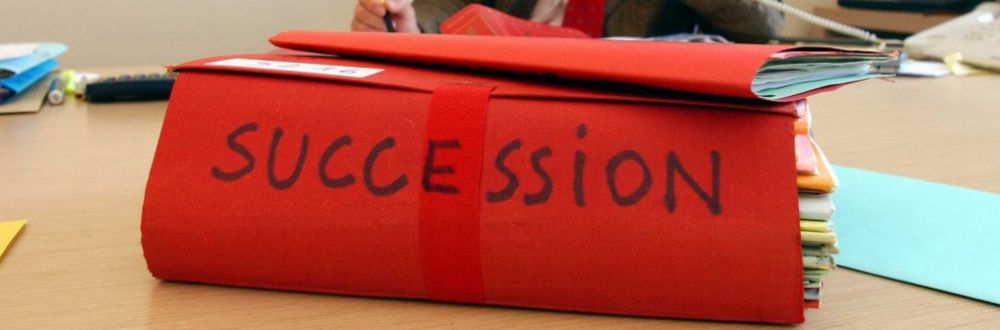
Peut-on déshériter ses enfants ? Avocat Avignon
Peut-on déshériter ses enfants ?
La loi française protège les héritiers réservataires, notamment les enfants. Aucune disposition testamentaire ne peut écarter leurs droits légaux, prévus à l'article 913 du Code civil. En conséquence, toute libéralité qui excède la quotité disponible est réduite pour respecter cette réserve.
Les libéralités consenties en usufruit doivent être imputées sur la quotité disponible en termes d’assiette, et non selon leur valeur convertie en pleine propriété. Cette distinction est essentielle pour déterminer si une atteinte à la réserve héréditaire a eu lieu.
Une affaire récente : legs en usufruit et réserve héréditaire
M. X est décédé en laissant pour successeurs sa compagne et sa fille, issue d’une précédente union. Dans son testament olographe, il avait légué à sa compagne l’usufruit de la maison d’habitation.
La fille du défunt a demandé la réduction de ce legs, estimant qu'il portait atteinte à sa réserve. La Cour d’appel avait rejeté cette demande, en considérant que la valeur de l’usufruit était inférieure à la quotité disponible.
Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision. Elle a jugé que la Cour d’appel avait mal appliqué les articles 913 et 919-2 du Code civil. Selon la Haute juridiction, l’atteinte à la réserve devait être évaluée en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible en termes d’assiette, sans conversion en pleine propriété.
Cette décision de la Cour de cassation (1re chambre civile, 22 juin 2022, pourvoi n° 20-23.215) rappelle l’importance de respecter la réserve héréditaire. Les libéralités doivent être calculées avec précision pour éviter toute atteinte aux droits des héritiers réservataires.
Pour toute question liée à la réserve héréditaire et aux testaments, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit des successions.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Accident de la circulation à l’étranger – Avocat Avignon Nîmes
Accident de la circulation à l’étranger
La Cour de cassation a rappelé l’importance de la Convention de La Haye du 4 mai 1971. Ce texte fixe la loi applicable en cas d’accidents de la circulation routière.
La Convention détermine que la loi de l’État où l’accident a eu lieu s’applique (article 3). Toutefois, il existe des exceptions. Par exemple, si plusieurs véhicules sont impliqués et immatriculés dans le même pays, la loi de cet État s’applique (article 4, b).
Un cas pratique : accident en Tunisie
Dans une affaire récente, un accident s’est produit en Tunisie. Un camion immatriculé dans ce pays a percuté une voiture française. Cette voiture a ensuite heurté l’épouse du conducteur, qui s’apprêtait à monter à bord.
La victime a saisi un juge français pour demander une indemnisation, invoquant la loi française du 5 juillet 1985. Le litige portait sur la loi applicable, notamment sur les conditions de responsabilité et les délais de prescription.
La décision de la Cour de cassation
La Cour d’appel avait estimé que la Convention de 1971 ne concernait pas les contrats d’assurance. Elle avait donc appliqué la loi française.
Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision. Elle a jugé que, puisque l’action était dirigée contre l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident survenu en Tunisie, la loi tunisienne devait s’appliquer. Cette loi devait déterminer les conditions de responsabilité et la prescription de l’action.
Une jurisprudence à retenir
Cette décision (Civ. 1re, 15 juin 2022, F-B, n° 21-13.306) rappelle que la loi applicable est essentielle en matière d’accidents internationaux. Pour toute question liée aux accidents de circulation à l’étranger, il est préférable de consulter un avocat spécialisé.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités – accidents de la circulation
Lire la suite

Successions : Droit d’habitation pour le conjoint survivant – Avocat Avignon Nîmes
Successions : Droit d’habitation pour le conjoint survivant
Le Code civil accorde deux droits distincts au conjoint survivant en matière de logement. Le droit temporaire au logement est automatique (article 763). En revanche, le droit viager au logement (article 764) doit être demandé. Le conjoint dispose d’un délai d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté d’en bénéficier (article 765-1).
Une option expresse ou tacite
Cette demande n’est soumise à aucune forme obligatoire. Elle se fait souvent par acte notarié, comme dans l’acte de notoriété. Cependant, la Cour de cassation reconnaît que l’option peut être tacite.
Dans une affaire de 2016, le conjoint survivant avait continué à occuper le logement et demandé le droit viager dans la déclaration de succession (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-16.116). En 2019, un conjoint avait manifesté son souhait dans un acte d’assignation et un projet d’acte de notoriété, en plus de rester dans les lieux (Cass. 1re civ., 13 fév. 2019, n° 18-10.171).
La limite du maintien dans les lieux
La Cour de cassation a toutefois précisé que le maintien dans les lieux, à lui seul, ne suffit pas à caractériser une volonté tacite. Dans une décision récente, elle a rappelé que cette volonté doit être non équivoque.
Dans cette affaire, une veuve continuait à occuper un logement acquis avec son mari. Cependant, le fils unique issu d’une précédente union contestait ce droit. La Cour de cassation lui a donné raison, estimant que le maintien seul ne suffisait pas (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674).
Un choix à faire dans un délai précis
Le conjoint survivant doit être informé de l’importance de déclarer son choix dans l’année suivant le décès. Ce choix a des conséquences, notamment sur les règles d’imputation prévues par l’article 765 du Code civil. L’accompagnement par un avocat spécialisé peut être déterminant pour sécuriser ce droit.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Copropriété : la contestation d’une résolution de principe - Avocat Avignon Nîmes
Copropriété : la contestation d’une résolution de principe
Une décision de principe ne constitue pas une résolution pouvant être contestée au sens de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette décision ne porte ni sur le vote de la réalisation et du coût des travaux relatifs à la motorisation d'une porte cochère, ni sur la délégation au syndic pour leur exécution, ni même sur le principe de ces travaux. Elle se limite à un accord de principe visant à confier au conseil syndical et au syndic l’étude d’un projet de motorisation de la porte cochère.
La résolution précise que cette étude aboutira à une proposition émanant du conseil syndical et du syndic. Les décisions susceptibles de contestation seront, le cas échéant, votées lors d'une future assemblée générale. Ainsi, cette décision de principe n'engage pas l'assemblée générale à ce stade.
De ce fait, il n'est pas possible de demander l'annulation de cette décision de principe. Cela s'applique notamment en invoquant une violation du principe de spécialité des votes, une non-conformité aux règles de majorité, ou encore une atteinte à une servitude de passage ou à l’état descriptif de division de l'immeuble.
Cette position a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, dans un arrêt rendu le 23 février 2022 (RG n° 18/09341).
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite