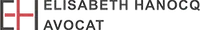Actualités

Précisions sur l'acquisition d’une cave par prescription – Avocat AVIGNON
Précisions sur l'acquisition d’une cave par prescription
Dans un arrêt du 19 octobre 2022 (pourvoi n° 21-19.852), la Cour de cassation a statué sur l'acquisition d'une cave par prescription.
En 2005, M. T a acheté une cave dans un bien en copropriété. Peu après l’acquisition, le notaire l'a informé qu'il ne disposait pas de la cave correspondant à son lot. Face à cette situation, M. T a accepté de restituer la cave occupée à son propriétaire légitime.
Par la suite, M. T s'est adressé à Mme A, propriétaire du lot 81, qui correspondait à une autre cave située dans le même sous-sol, mais identifiée dans le plan d'origine comme étant le lot 82. Il a demandé à Mme A de lui restituer cette cave. Mme A ayant refusé, puis vendu son lot à Mme C, M. T a décidé d’assigner Mme C en justice, estimant que cette dernière occupait irrégulièrement la cave en question.
La cour d'appel avait jugé que les copropriétaires successifs n’avaient pas pu acquérir par prescription la propriété de la cave. Elle avait fondé sa décision sur deux points. D'une part, les titres de propriété faisaient référence à un autre lot. Dautre part, les actes de vente successifs n'avaient pas transféré la possession effective de la cave concernée. En conséquence, la cour avait conclu que le lot litigieux était resté « en dehors de la vente » et que le propriétaire actuel ne pouvait pas ajouter à sa possession celle de son prédécesseur.
La décision de la cour de cassation
La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a considéré que la cour d'appel avait insuffisamment motivé son raisonnement pour exclure que les ventes successives aient pu porter, dans l'intention des parties, sur la cave effectivement possédée par le copropriétaire. La Cour a également relevé que des modifications – même irrégulières – de l'emplacement et de la numérotation des caves pouvaient entraîner un transfert de possession en accord avec l'état descriptif initial. Ainsi, la Cour a rappelé que l’article 2265 du Code civil permet l'acquisition par prescription lorsque les conditions légales de possession sont remplies.
Cet arrêt illustre l’importance d'une analyse précise des intentions des parties et des éléments factuels dans les litiges liés à la copropriété. Les professionnels du droit et les copropriétaires doivent donc être vigilants à l’égard des documents contractuels et des pratiques liées à l’occupation des lots.
Me ELISABETH HANOCQ – AVOCAT AU BARREAU D’AVIGNON – COUR D’APPEL DE NIMES – DROIT IMMOBILIER
Lire la suite

Bail d’habitation : le congé donné par le bailleur – Avocat AVIGNON
Bail d’habitation : le congé donné par le bailleur
Lorsque le bailleur souhaite donner congé à son locataire, il doit respecter un délai de préavis précis. Ce délai est de six mois pour une location vide et de trois mois pour une location meublée.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le délai de préavis commence à courir à partir de la réception de la lettre recommandée. Cette réception suppose une remise en main propre du courrier à son destinataire.
Cependant, la jurisprudence a rappelé que le congé n’est pas valablement délivré si la lettre recommandée revient à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, dans un arrêt récent (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-17.691, FS-B), la Cour de cassation a jugé que, dans ce cas, le congé n’a pas été régulièrement notifié.
Une situation contestable
Ce principe peut toutefois poser problème. La date de réception de la lettre recommandée est souvent incertaine, ce qui complique le calcul du délai de préavis. Plus encore, il permet au locataire de faire preuve de mauvaise foi en refusant volontairement de récupérer son courrier. Si le courrier reste non réclamé, le délai de préavis ne commence jamais à courir, ce qui place le bailleur dans une position désavantageuse.
Dans une décision antérieure, la Cour de cassation avait pourtant adopté une approche différente. Elle avait jugé qu’un locataire ne pouvait pas, en refusant de retirer son courrier, empêcher le début du délai de préavis. Dans cette affaire (Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-16.838), la Cour avait retenu que le délai devait courir à partir de la date de retour du courrier à l’expéditeur.
Une jurisprudence fluctuante
Cette décision de 2020 semble s’appuyer sur une logique d’équité. Néanmoins, elle ne fait pas jurisprudence et les tribunaux appliquent aujourd’hui strictement le principe prévu par l’article 15 de la loi de 1989. Ainsi, en cas de refus de réception par le locataire, le congé risque de ne pas produire ses effets juridiques.
Pour les bailleurs, il est essentiel de bien comprendre ces règles et de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la notification du congé. Un conseil juridique adapté peut permettre d’éviter ces écueils.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Bail d’habitation
Lire la suite

Vente d’un immeuble par un professionnel : présomption de connaissance du vice - AVOCAT AVIGNON
Vente d’un immeuble par un professionnel : présomption de connaissance du vice
Dans une affaire récente, un maçon avait entrepris lui-même la rénovation de sa maison avant de la mettre en vente. L’acquéreur, constatant des vices cachés affectant le bien, a engagé une action contre le vendeur. Il demandait à la fois une réduction du prix et une indemnisation.
Le vendeur a tenté de se défendre en invoquant une clause du contrat de vente qui limitait sa responsabilité. La cour d’appel lui avait donné raison, estimant qu’en tant qu’entrepreneur en maçonnerie, il n’avait pas les compétences nécessaires pour détecter un éventuel vice du sol lors des travaux.
Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision. Elle a rappelé qu’un vendeur qui réalise lui-même des travaux sur un bien immobilier doit être considéré comme un professionnel. En conséquence, ce vendeur est présumé connaître les vices affectant l’immeuble, y compris ceux liés au sol. Cette présomption de mauvaise foi lui interdit de se prévaloir d’une clause exonératoire de responsabilité, conformément à l’article 1641 du Code civil.
Cet arrêt de la Cour de cassation (3e civ., 15 juin 2022, n° 21-21.143) confirme une position stricte : un vendeur assimilé à un professionnel ne peut échapper à ses obligations en matière de vices cachés.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Délai de prescription applicable aux charges de copropriété – Avocat AVIGNON
Le délai de prescription du Code de la consommation ne s'applique pas aux charges de copropriété
Les syndicats de copropriétaires ne peuvent pas invoquer la prescription biennale prévue par l'article 218-2 du Code de la consommation pour les actions engagées par des professionnels concernant les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs.
C'est ce que la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt rendu le 28 septembre 2022.
Champ d'application de l'article 218-2 du Code de la consommation
L'article 218-2 du Code de la consommation concerne uniquement les consommateurs et les non-professionnels. Le texte définit les consommateurs comme « toute personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Quant aux non-professionnels, il s'agit de « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».
Spécificités des syndicats de copropriétaires
Contrairement à une personne physique, un syndicat de copropriétaires est une entité juridique organisée par la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Cette loi prévoit trois organes distincts : le syndic, le conseil syndical et l'assemblée générale des copropriétaires. Ces structures fonctionnent sous le cadre strict établi par la loi et le règlement de copropriété.
En raison de cette organisation juridique, un syndicat de copropriétaires ne peut être assimilé à un consommateur ou à un non-professionnel au sens du Code de la consommation.
La position de la Cour de cassation
Dans son arrêt, la Cour de cassation a jugé que la prescription biennale prévue pour protéger les consommateurs ne s'applique pas aux syndicats de copropriétaires. La cour d'appel avait également retenu à juste titre que le syndicat ne pouvait pas bénéficier de ce délai, estimant qu'il n'y avait pas de différence de traitement injustifié entre des situations comparables.
Cette décision, prise sur le fondement de la loi et des statuts propres aux syndicats de copropriétaires, clarifie les limites d'application de la prescription biennale dans ce contexte.
Référence : Cass. 3e civ., 28 sept. 2022, n° 21-19.829, FS
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Immobilier : L'information du locataire ou de l’acquéreur des risques – Avocat AVIGNON
Immobilier : L'information du locataire ou de l’acquéreur des risques
Le décret du 1er octobre 2022 impose une nouvelle obligation aux propriétaires de biens immobiliers. Ils doivent désormais informer, en amont, les locataires ou les acquéreurs des risques naturels ou technologiques liés au bien.
Cette obligation concerne les biens situés dans des zones exposées à ces risques ou inscrits dans un secteur d’information sur les sols. Elle s’applique dès le début du processus de vente ou de location, y compris dans l’annonce immobilière.
Le texte précise le contenu et la forme du document à fournir. Celui-ci doit détailler les risques identifiés ou les caractéristiques du secteur d’information sur les sols. Il est remis aux candidats locataires ou acquéreurs pour garantir leur information complète et transparente.
Ce décret, publié au Journal officiel le 5 octobre 2022, est entré en vigueur le 1er janvier 2023.
Référence : Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Vente aux enchères immobilière sur AVIGNON
Vente aux enchères immobilières à Avignon : comment le Cabinet peut vous assister
Le Cabinet accompagne ses clients dans les procédures de saisie immobilière et dans toutes les démarches liées à l’achat de biens vendus aux enchères.
Les ventes aux enchères judiciaires immobilières se déroulent devant le Tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bien concerné.
Enchérir : les règles essentielles
Pour participer à une adjudication, vous devez obligatoirement être représenté par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal compétent. Un avocat ne peut représenter qu’un seul adjudicataire et ne peut pas enchérir pour le débiteur saisi. Par ailleurs, vous ne devez pas être en procédure de surendettement, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Avant l’audience : les démarches à suivre
Vous pouvez consulter le cahier des conditions de vente au Greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire. Ce document détaille les conditions de la vente.
Une visite du bien est organisée par un huissier de justice environ quinze jours avant l’audience. Nous vous recommandons vivement d’y assister, car les ventes aux enchères ne bénéficient pas de la garantie contre les vices cachés.
Si vous restez intéressé après cette visite, vous devrez fournir à votre avocat :
des justificatifs d’identité et de solvabilité,
un pouvoir,
un chèque de banque correspondant à 10 % de la mise à prix, avec un minimum de 3 000 €.
Le jour de la vente : le rôle de votre avocat
Lors de l’audience, votre avocat enchérira dans la limite du mandat que vous lui aurez confié.
Si vous n’êtes pas déclaré adjudicataire, votre avocat vous restituera votre chèque de banque. Si vous remportez l’enchère et qu’aucune surenchère n’est effectuée dans les 10 jours, votre avocat vous précisera les frais supplémentaires à prévoir.
Les frais à prévoir en cas d’adjudication
En plus du prix d’adjudication, vous devrez régler :
Les frais préalables : environ 5 000 €, annoncés lors de l’audience par l’avocat poursuivant la vente.
Les émoluments de vente : calculés sur le prix d’adjudication, ils incluent les frais de votre avocat et de l’avocat poursuivant.
Les droits d’enregistrement : droits de mutation à régler dans le mois suivant l’adjudication, sous peine de pénalités.
La taxe de publicité foncière : 0,10 % du prix d’adjudication pour la publication du titre de propriété.
Le solde du prix d’adjudication : déduction faite des 10 % déjà remis à l’avocat, ce solde doit être payé dans un délai de deux mois après la vente définitive.
Une précaution essentielle
Assurez-vous de disposer des fonds nécessaires pour régler ces frais et le prix d’adjudication. À défaut, une nouvelle mise en vente pourra être engagée, et vous serez tenu de couvrir les frais de la première adjudication.
Pourquoi faire appel à Maître HANOCQ ?
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Maître HANOCQ vous assiste dans toutes les étapes de la procédure et vous représente lors des ventes aux enchères devant le Tribunal judiciaire d’Avignon. Elle prend également en charge les formalités nécessaires après la vente.
Professionnel ou particulier, Maître HANOCQ pourra vous accompagner dans cette procédure et vous représenter lors des ventes devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON. Elle se chargera de toutes les formalités postérieures.
Lire la suite

La prescription de l'action en responsabilité du notaire – Avocat AVIGNON
La prescription de l'action en responsabilité du notaire
Le Cabinet de Me HANOCQ vous informe sur les règles de prescription en matière de responsabilité du notaire. Cette question est essentielle lorsqu’un préjudice survient longtemps après la prestation réalisée.
Une affaire révélatrice
Dans une affaire, un expert-comptable avait conseillé à son client un montage juridique visant à céder son fonds de commerce sans être imposé sur les plus-values. Le commerçant donne son fonds en location-gérance à une société dont il est le gérant et associé majoritaire.
Le 29 août 2007, l’administration fiscale lui notifie un redressement concernant les plus-values. Après un long contentieux, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette sa demande d’exonération le 7 janvier 2014.
Une action jugée irrecevable
Les 14 et 23 mars 2016, le commerçant assigne le notaire et l’expert-comptable en responsabilité civile. Mais, le 30 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux déclare cette action prescrite. Elle estime que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir dès la réception de la lettre de redressement en 2007.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a censuré cette décision le 29 juin 2022 (Cass. 1re civ., n° 21-10.270). Elle rappelle que, selon l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à partir du moment où le titulaire d’un droit a connaissance des faits permettant d’exercer son action.
En l’espèce, la Haute Juridiction souligne que le préjudice ne s’était réellement concrétisé que le 7 janvier 2014, date du rejet définitif par la cour administrative d’appel. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription quinquennal.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision confirme que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité notariale dépend du moment où le dommage se réalise véritablement, et non d’une étape intermédiaire comme la notification d’un redressement fiscal.
Si vous êtes confronté à une situation semblable ou si vous souhaitez engager une action contre un notaire, un avocat expérimenté pourra vous aider à déterminer le point de départ de la prescription et protéger vos droits.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités
Lire la suite

Loyers commerciaux et Covid 19 – Avocat AVIGNON
Dans trois arrêts rendus le 30 juin 2022, la Cour de cassation se prononce sur la question des loyers commerciaux dus durant l’épidémie de Covid 19 pour les commerces dits « non essentiels »
Dans les trois arrêts rendus, la Cour de cassation juge que le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
La mesure d'interdiction de recevoir du public prise pendant la crise sanitaire n'entraîne pas la perte du local loué, ne constitue pas une inexécution de son obligation de délivrance par le bailleur et ne peut pas être invoquée au titre de la force majeure par le locataire.
Ainsi :
Selon la Cour de cassation, le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance au cours des périodes pendant lesquelles les commerces non essentiels ont été fermés par décret gouvernemental, même si le preneur n’a pas pu exercer son activité commerciale.
Pas de possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution, car cela suppose que le bailleur ait manqué à son obligation de délivrer le local loué et d’en garantir la jouissance paisible. Ainsi, l’obligation de délivrance n’inclurait pas l’obligation d’assurer l’accessibilité au local loué en cas de fermeture administrative résultant d’une mesure générale.
L’interdiction de recevoir du public ne peut pas être assimilée à la perte du local loué.
Les locataires ne peuvent se prévaloir de la force majeure et ne sont donc pas fondés à demander la résolution du contrat ou sa suspension.
L’obligation de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable, le juge des référés pouvait donc condamner le locataire à payer les arriérés.
Cass. com., 30 juin 2022, n° 21-19.889, F-P+B : JurisData n° 2022-010947
Cass. com., 30 juin 2022, n° 21-20.127, F-P+B : JurisData n° 2022-010745
Cass. com., 30 juin 2022, n° 21-20.190, F-P+B : JurisData n° 2022-010741
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES
Lire la suite

Succession et dettes en Ehpad : que doivent payer les héritiers ? – AVOCAT AVIGNON
Succession et dettes en Ehpad : que doivent payer les héritiers ?
Les dettes liées à l’hébergement en Ehpad peuvent peser sur les héritiers dans le cadre d’une succession. Cette question soulève souvent des litiges, comme le montre une affaire récente.
Dans cette affaire, Mme T. a été hébergée dans un Ehpad à partir du 3 juillet 2013 jusqu’à son décès le 15 septembre 2015. Pendant cette période, des frais d’hébergement pour un montant de 16 680,76 euros restaient impayés pour les mois de janvier à septembre 2015.
Après son décès, l’Ehpad a réclamé cette somme, majorée des intérêts, à ses trois fils, MM. Bernard T., Jean-Claude T. et Christian T., devant le tribunal de grande instance d’Albi.
La Cour d’appel de Toulouse a confirmé que la dette réclamée par l’Ehpad correspond à une créance locative due par Mme T., et non à une créance alimentaire. En tant qu’ayants droit, ses fils sont solidaires du paiement de cette somme, qui fait partie intégrante du passif successoral. Cette créance peut être directement réclamée par l’Ehpad aux héritiers sans déclaration préalable auprès du notaire chargé de la succession.
Concernant le partage de la charge entre les héritiers, celui-ci relève des opérations de liquidation et de partage de la succession. Cette étape n’était pas l’objet du litige en question.
Ce qu’il faut retenir
Lorsqu’un parent décède avec des dettes impayées envers un Ehpad, celles-ci entrent dans le passif successoral. Les héritiers, en tant qu’ayants droit, en sont responsables solidairement.
Si vous êtes confronté à une telle situation, Me HANOCQ peut vous conseiller et vous assister. Que ce soit pour contester une créance, organiser la répartition des dettes entre héritiers, ou engager les procédures nécessaires devant le juge.
Maître Elisabeth HANOCQ – avocat au barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite