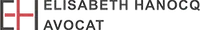Actualités

Succession : Comment protéger le conjoint survivant ? Avocat AVIGNON
Protéger le conjoint survivant dans le cadre d'une succession : les solutions juridiques
Anticiper la protection du conjoint survivant est essentiel pour garantir ses droits et assurer une transmission sereine du patrimoine. Plusieurs solutions juridiques permettent d’organiser efficacement sa succession.
1. Le testament
Rédiger un testament permet de favoriser le conjoint survivant en lui attribuant une part supplémentaire des biens ou des droits spécifiques, comme l’usufruit d’un bien. Pour être valide, le testament doit respecter les formalités du Code civil. Un professionnel peut vous aider à le formaliser correctement.
2. La donation entre époux
Appelée donation au dernier vivant, elle permet de transmettre des biens au conjoint en prévision du décès. Cet acte notarié peut porter sur la quotité disponible ou des biens en usufruit ou pleine propriété. Flexible et révocable, elle offre également des avantages fiscaux en exonérant les biens de droits de succession.
3. Le régime matrimonial
Certains régimes matrimoniaux, comme la communauté universelle, protègent le conjoint survivant. Dans ce régime, tous les biens des époux sont partagés à parts égales, garantissant au conjoint la moitié de la communauté.
4. L’assurance-vie
En désignant son conjoint comme bénéficiaire d'une assurance-vie, celui-ci perçoit directement le capital au décès. Cette solution est avantageuse fiscalement car les sommes transmises échappent aux droits de succession.
5. La clause de préciput
Insérée dans un contrat de mariage, cette clause permet au conjoint survivant de prélever certains biens avant le partage entre héritiers. Elle constitue un avantage supplémentaire pour préserver des biens précis.
Conclusion
Protéger le conjoint survivant repose sur une stratégie personnalisée. Testament, donation entre époux, assurance-vie ou régime matrimonial : chaque solution offre des atouts distincts. Pour garantir vos volontés, consulter un avocat en droit des successions reste indispensable.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES –
Lire la suite

Divorce et prestation compensatoire : Comprendre vos droits – Avocat AVIGNON
Divorce et prestation compensatoire : comprendre vos droits
Le divorce entraîne souvent un bouleversement financier pour l’un des époux, en raison de la différence de niveaux de vie qu’il peut engendrer. Afin de rétablir un équilibre, la prestation compensatoire intervient comme un mécanisme d'indemnisation, destiné à compenser cette disparité.
Qu’est-ce que la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est une somme d’argent ou un avantage matériel versé à l’un des époux pour limiter les conséquences financières du divorce. Elle repose sur une analyse approfondie des besoins du bénéficiaire et des capacités financières de l’ex-conjoint qui la verse.
Les différents cas de versement
La prestation compensatoire peut être due dans deux types de divorce :
Divorce par consentement mutuel, où les époux se mettent d’accord sur le principe et le montant dans une convention.
Divorce judiciaire, où le juge fixe la prestation après analyse des situations respectives des parties.
En revanche, le juge peut refuser d’octroyer cette prestation dans des situations spécifiques, notamment si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux demandeur, comme en cas de violences conjugales.
Comment est déterminé le montant de la prestation compensatoire ?
La fixation du montant repose sur plusieurs critères objectifs, définis par le Code civil. Parmi eux :
La durée du mariage ;
L’âge et l’état de santé des époux ;
Les revenus et les ressources de chaque partie ;
Les conséquences professionnelles liées aux choix faits pendant le mariage (par exemple, une carrière mise entre parenthèses pour s’occuper des enfants) ;
Le patrimoine actuel ou prévisible après la liquidation du régime matrimonial ;
Les droits à la retraite, qui peuvent être diminués pour l’un des conjoints en raison de sacrifices consentis pour la vie familiale.
Le juge analyse également les perspectives financières futures afin de garantir une solution équitable.
Sous quelles formes peut-elle être versée ?
La prestation compensatoire peut prendre plusieurs formes :
Un capital (versement d’une somme d’argent) ;
L’attribution d’un bien immobilier, en pleine propriété, viager ou avec un droit d’usage et d’habitation ;
Une rente viagère, versée périodiquement jusqu’au décès du bénéficiaire.
Le choix de la forme dépend de la situation patrimoniale des époux et des besoins du conjoint créancier.
Quelle fiscalité s’applique à la prestation compensatoire ?
La fiscalité varie selon les modalités de versement :
Si elle est versée en capital dans les 12 mois suivant le jugement, la prestation compensatoire est non imposable pour celui qui la reçoit.
En cas de versement sous forme de rente, elle est soumise au régime fiscal des pensions alimentaires.
À noter que si le débiteur de la prestation vient à décéder, le paiement peut être transmis à ses héritiers, sauf s’ils renoncent à la succession.
Peut-on réviser la prestation compensatoire ?
Une demande de modification de la prestation compensatoire, ou des modalités de son versement, est possible. Elle doit être faite par voie d’assignation devant le Juge aux affaires familiales. Cette demande intervient principalement en cas de changement significatif de la situation financière des ex-époux.
Distinction avec les autres unions
La prestation compensatoire concerne uniquement les époux dans le cadre d’un divorce. Les concubins et les partenaires de Pacs, en cas de rupture, ne peuvent solliciter que des dommages et intérêts devant le Juge aux affaires familiales, et ce, uniquement si la séparation est jugée abusive.
La prestation compensatoire est un outil essentiel pour rétablir l’équilibre financier entre les époux après un divorce. Chaque situation étant unique, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit de la famille pour vous accompagner dans vos démarches et défendre vos intérêts.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce
Lire la suite

Assurances : Principe de la réparation intégrale du préjudice – Avocat AVIGNON
Assurances : Le principe de la réparation intégrale du préjudice
Le principe de la réparation intégrale constitue l’un des fondements du droit des assurances en France. Il a pour objectif d’assurer que les victimes d’un dommage soient indemnisées de manière exhaustive, afin de les replacer dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la survenance du sinistre. La réparation ne doit donc ni enrichir ni appauvrir la victime.
Les fondements juridiques du principe de réparation intégrale
Le principe de réparation intégrale est ancré dans le Code civil ainsi que dans la jurisprudence.
L’article 1240 du Code civil établit la responsabilité civile en stipulant que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Cet article pose le fondement de l’obligation d’indemnisation des préjudices subis.
L’article 1241 du Code civil précise quant à lui que : « Le débiteur est condamné aux dommages et intérêts, soit à raison du préjudice qu’il a causé, soit à raison de l’incapacité où il a mis la victime de demander des dommages et intérêts.» Cela signifie que toute victime a droit à une compensation totale pour l’ensemble des préjudices subis.
La jurisprudence et la reconnaissance de la réparation intégrale
La jurisprudence a consolidé ce principe au fil des décisions. Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 1992, a rappelé que la réparation intégrale doit inclure tous les préjudices, qu’ils soient matériels, financiers, physiques ou moraux. L’objectif est de replacer la victime dans un état aussi proche que possible de celui qui préexistait au dommage.
Les implications pratiques de la réparation intégrale
En pratique, le principe de réparation intégrale impose une indemnisation couvrant l’intégralité des préjudices subis par la victime. Cela inclut notamment :
Les frais médicaux et les coûts de traitement ;
Les pertes de revenus et les incapacités professionnelles ;
Les préjudices physiques, économiques et moraux ;
Les coûts futurs liés à la rééducation ou à la réadaptation.
Ce principe s'applique à toutes les branches de l'assurance : assurance automobile, assurance habitation, assurance responsabilité civile, assurance santé, etc. En cas de sinistre, la victime doit donc pouvoir compter sur une couverture totale des préjudices subis.
Les limites de la réparation intégrale
Bien que la réparation intégrale vise à garantir une compensation complète, elle ne doit pas conduire à un enrichissement injustifié de la victime. La jurisprudence a ainsi précisé que le paiement d’un impôt, légalement dû, ne constitue pas un préjudice indemnisable dans la mesure où il s’agit simplement de rétablir une situation normale.
Par ailleurs, l’indemnité versée par l’assureur appartient pleinement à l’assuré. Ce dernier est libre d’utiliser cette somme comme il l’entend. L’assureur ne dispose d’aucun droit de contrôle sur l’usage de l’indemnité versée.
Le principe de la réparation intégrale est un pilier essentiel du droit des assurances en France. Il garantit à toute victime une indemnisation juste, équitable et complète pour l’ensemble des préjudices subis, qu’ils soient présents ou futurs. Ce principe joue un rôle crucial pour assurer le respect des droits des victimes tout en maintenant les compagnies d'assurance face à leurs responsabilités.
Dans un système fondé sur l’équité et la justice, la réparation intégrale constitue une protection indispensable pour toutes les personnes touchées par un dommage.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances.
Lire la suite

Prescription de l'action de la caution contre la banque - Avocat Avignon
Prescription de l'action en responsabilité de la caution à l'encontre de la banque : Précision sur la mise en demeure non réclamée
Lorsqu'une banque appelle une caution en garantie, elle doit préalablement mettre celle-ci en demeure d'exécuter son engagement, c'est-à-dire de payer à la place du débiteur principal. Cette mise en demeure constitue un élément clé pour le début du délai de prescription de l'action que la caution peut exercer à l'encontre de la banque, notamment en invoquant des manquements à son obligation de mise en garde ou une disproportion des engagements.
La Cour de cassation a récemment clarifié une question importante : quel est le sort de la prescription lorsque la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) n'est pas récupérée par la caution ?
Les faits de l'affaire
Dans cette affaire, une banque avait accordé deux prêts immobiliers à une SCI, garantis par le cautionnement d'une personne physique. Face à des défauts de paiement, la banque avait adressé en 2009 une mise en demeure à la caution par LRAR. Toutefois, la lettre n'avait pas été réclamée, et le courrier était revenu à la banque avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur ».
Par la suite, la banque avait prononcé la déchéance du terme, procédé à la vente forcée du bien et mis en œuvre une saisie-vente pour récupérer le solde restant dû. La question litigieuse portait alors sur la prescription de l'action en responsabilité engagée par la caution contre la banque.
L’argument de la banque et la position de la Cour de cassation
La banque soutenait que l'action en responsabilité de la caution était prescrite, au motif que le délai de prescription avait commencé à courir à la date d'envoi de la LRAR, même si celle-ci n'avait pas été récupérée par la caution.
Dans sa décision, la Cour de cassation a rappelé deux principes essentiels :
Le point de départ de l'action en responsabilité : Le délai de prescription de cinq ans commence à courir à partir du moment où la caution a connaissance de l'exécution de son engagement en raison de la défaillance du débiteur principal. Cette connaissance résulte de la mise en demeure qui lui est adressée.
La validité de la mise en demeure : Le fait que la lettre recommandée n'ait pas été retirée par la caution n'affecte pas sa validité. Dès lors que la mise en demeure est adressée, elle produit ses effets, y compris pour faire courir le délai de prescription.
La Cour a précisé que la mise en demeure peut prendre plusieurs formes à condition de constituer une interpellation suffisante : une sommation, une lettre missive claire ou encore l'effet d'une clause prévue dans la convention de cautionnement.
Conséquences pour les cautions
Cette décision est d'une importance capitale pour les cautions. Elle signifie que le délai de prescription de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque commence à courir dès l’envoi de la mise en demeure, même si celle-ci n’a pas été effectivement reçue. Ainsi, il est primordial pour les cautions de réagir dès qu'elles sont informées d'une telle procédure afin de ne pas se retrouver prescrites.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 janvier 2023, n° 21-23.957, F-B.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
Lire la suite
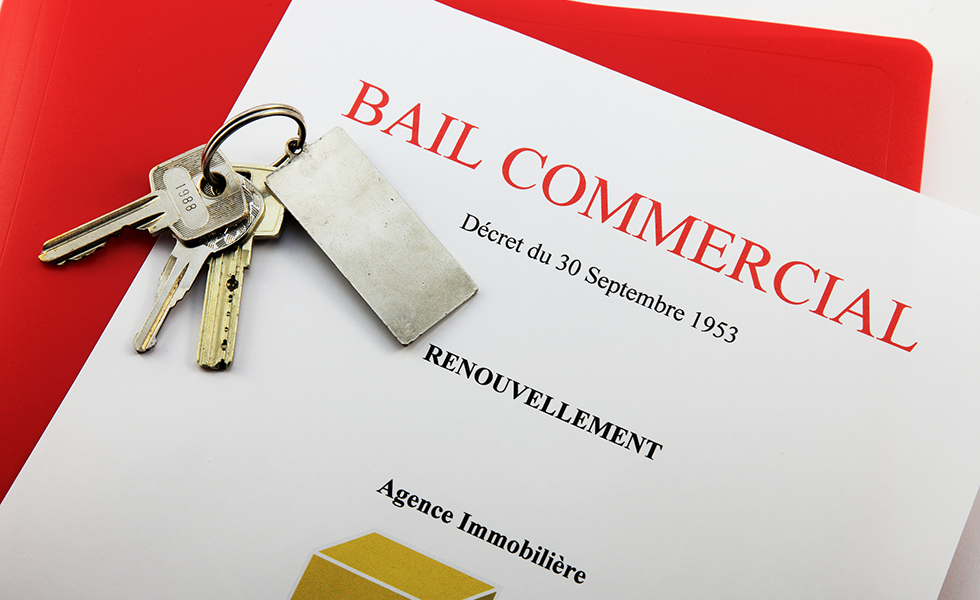
Bail commercial : Point de départ du délai de préavis pour le congé – Avocat AVIGNON
Bail commercial : Point de départ du délai de préavis pour le congé
Dans le cadre d’un bail commercial prenant effet le 1er août 2001, les bailleurs avaient donné en location des locaux à une locataire qui a souhaité donner congé pour l’échéance triennale fixée au 31 juillet 2016. Ce congé a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) expédiée le 31 janvier 2016.
Les bailleurs, contestant la régularité de cette notification reçue le 5 février 2016, avaient fait valoir leur opposition en émettant un commandement de payer le 29 mars 2017, se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail. Ils avaient ensuite assigné la locataire en paiement des loyers et charges impayés.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mars 2023 (n° 21-22.240), a tranché la question en rappelant un point essentiel : le congé avait été donné avant l'entrée en vigueur du Décret du 11 mars 2016 qui modifie les modalités de notification. Par conséquent, conformément à l'article 668 du Code de procédure civile, une notification est considérée comme régulière lorsque la lettre recommandée est présentée par les services postaux au destinataire habilité à la recevoir, peu importe la date effective de réception.
Ainsi, les bailleurs ne pouvaient reprocher à la cour d'appel d'avoir jugé que la résiliation du bail était bien intervenue à l'échéance fixée au 31 juillet 2016. La cour avait constaté que la lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2016 respectait le délai de préavis de 6 mois imposé par l'article L.145-4 du Code de commerce.
Cet arrêt rappelle avec force la nécessité de bien comprendre les règles de notification du congé dans le cadre d'un bail commercial, ainsi que les subtilités liées au point de départ du délai de préavis. Les locataires et bailleurs doivent donc veiller à respecter ces délais pour éviter toute contestation future.
Référence : Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-22.240, FS-B.
Maître Elisabeth HANOCQ – avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats – Bail commercial
Lire la suite

Succession et recel successoral : qui doit apporter la preuve ? Avocat AVIGNON
Succession et recel successoral : qui doit apporter la preuve ?
Lorsqu'un héritier est accusé de recel successoral, la charge de la preuve joue souvent un rôle central dans le débat judiciaire. Un arrêt récent de la Cour de cassation (1re civ., 16 novembre 2022, n° 21-12.269) rappelle des principes essentiels.
Dans cette affaire, un héritier contestait avoir été reconnu coupable de recel successoral. Selon lui, la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en violant les articles 778 et 1353 du Code civil. En effet, il soutenait que c'était aux co-héritiers de prouver l'intention libérale à l'origine des virements litigieux effectués par le défunt en sa faveur.
Cependant, la Cour de cassation a rejeté cet argument. Elle a rappelé que l'héritier soutenait que les sommes perçues correspondaient au remboursement de frais avancés pour le compte du défunt. Il ajoutait également qu'une partie provenait d'un trop-perçu de fermages. Cependant, la Cour d'appel a conclu qu'il ne justifiait pas la cause des virements pour un montant de 58.942,33 €. Ainsi, il n'y avait pas eu d'inversion de la charge de la preuve.
Clarification sur la charge de la preuve
La preuve du recel successoral revient aux co-héritiers qui l'invoquent. L'héritier accusé doit, de son côté, expliquer l'origine des sommes perçues. En l'espèce, les co-héritiers avaient démontré le caractère libéral des virements, ce que l'héritier n'avait pas réussi à contredire par des preuves suffisantes.
Un rappel essentiel pour les successions conflictuelles
Cet arrêt souligne que tout héritier accusé de recel successoral doit apporter des preuves claires. Sans cela, les tribunaux peuvent conclure à une intention libérale et sanctionner l'héritier.
En matière successorale, il est essentiel d'être accompagné d'un avocat compétent pour défendre ses intérêts et préparer les éléments de preuve.
Maître Elisabeth HANOCQ – avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite
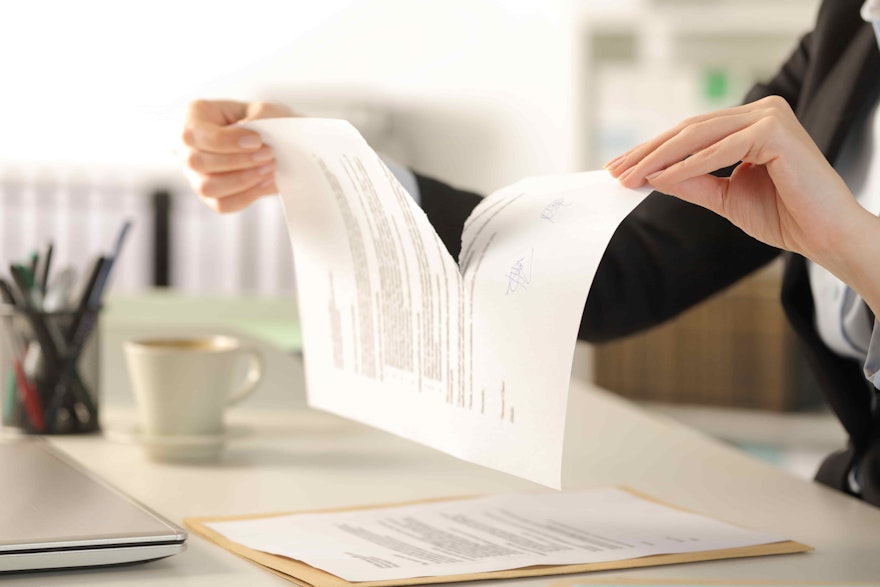
Annulation de vente immobilière : Responsabilité du Notaire et préjudices indemnisables – Avocat Avignon
Annulation de vente immobilière : Responsabilité du Notaire et préjudices indemnisables
La Cour de cassation a récemment précisé les préjudices pouvant être indemnisés après l’annulation d’une vente immobilière. Cette décision clarifie les limites de la responsabilité du notaire dans un tel contexte.
Les faits : annulation d’une vente pour infraction aux règles d’urbanisme
Dans cette affaire, la vente d’un bien immobilier a été annulée en raison d’une violation du Code de l’urbanisme et du PLU.
L’acquéreur, mécontent de la décision de la cour d’appel, avait saisi la Cour de cassation. Il demandait à être indemnisé des frais engagées. Selon lui, ces dépenses devaient être considérées comme un préjudice indemnisable si elles prenaient en compte la valeur du bien au jour de l’annulation de la vente.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a analysé les différents postes de préjudice réclamés par l’acquéreur.
Travaux de mise en conformité et de rénovation : Les travaux litigieux concernaient l’électricité, la toiture, les parquets, les plafonds et la peinture des murs. La Cour a considéré ces dépenses comme des frais de conservation du bien. Elle a confirmé que ces frais ne constituaient pas un préjudice indemnisable et ne pouvaient donc pas être couverts par la responsabilité du notaire.
Charges de copropriété, assurance et taxes foncières : En revanche, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel sur ce point. Elle a jugé que ces charges n’étaient pas des simples « restitutions » consécutives à l’annulation de la vente. Elles présentaient un caractère indemnitaire et pouvaient donc constituer des préjudices réparables.
Conclusion : la responsabilité du notaire en question
Cette décision rappelle que toutes les dépenses liées à une vente annulée ne donnent pas lieu à indemnité. Les frais considérés comme des charges de conservation restent à la charge de l’acquéreur. En revanche, les charges à caractère indemnitaires (taxes ou assurances) peuvent être prises en compte.
Cette clarification est essentielle pour les acquéreurs et les notaires, afin de définir les contours de la responsabilité et des préjudices indemnisables en cas d’annulation d’une vente immobilière.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Vices cachés : le recours du vendeur contre son propre vendeur – Avocat Avignon
Vices cachés : le recours du vendeur contre son propre vendeur
La Cour de cassation a récemment clarifié le recours dont dispose un vendeur contre son propre vendeur en cas de vices cachés.
Dans un arrêt du 16 février 2022 (Cass. 3e civ., n° 20-19.047), elle rappelle que pour les ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les défauts affectant les matériaux ou les éléments d’équipement fournis par un constructeur n’exonèrent pas ce dernier de sa responsabilité envers le maître d’ouvrage. Cette responsabilité demeure, quel que soit son fondement juridique.
La Cour souligne que, pour garantir un équilibre et éviter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur qui engage sa responsabilité en raison de matériaux défectueux peut exercer un recours contre son propre vendeur. Ce recours s’appuie sur la garantie des vices cachés, sans être bloqué par un délai de prescription partant de la vente initiale.
La Cour précise que le délai prévu par l’article 1648, alinéa 1, du Code civil ne commence à courir qu’à partir de la date où l’entrepreneur est assigné par le maître de l’ouvrage. En effet, l’entrepreneur ne peut agir contre son vendeur ou le fabricant qu’après avoir été lui-même mis en cause.
Par ailleurs, le délai prévu par l’article L. 110-4, I, du Code de commerce, qui commence à courir dès la vente initiale, est suspendu tant que la responsabilité de l’entrepreneur n’a pas été engagée.
Cette décision vient renforcer la protection des constructeurs en leur permettant d’obtenir réparation contre leur propre vendeur.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
Lire la suite
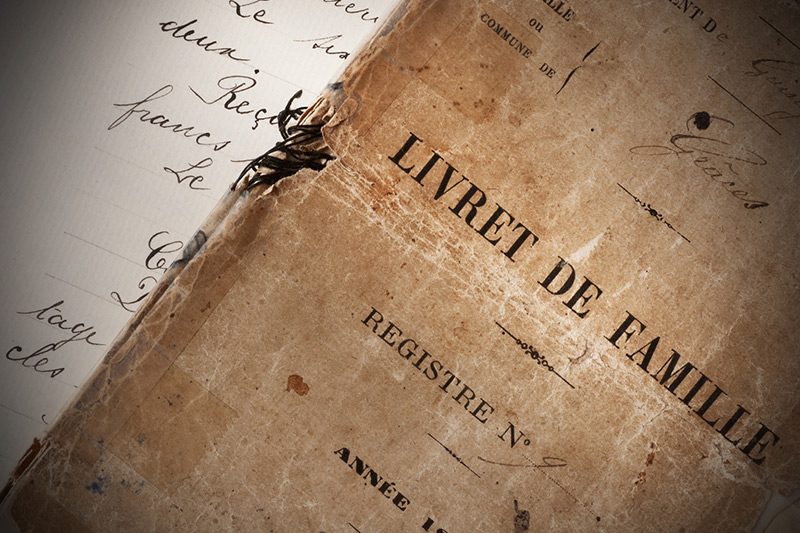
Succession bloquée ? La sommation d’opter comme solution - Avocat Avignon
Succession bloquée ? La sommation d’opter comme solution
Lorsqu’une succession est bloquée, c’est souvent à cause d’un héritier qui ne se prononce pas. Il ne dit pas s’il accepte ou renonce à la succession. Pire, il reste silencieux face aux sollicitations des autres héritiers ou du notaire.
Dans ce cas, les co-héritiers disposent d’un recours : la sommation d’opter, prévue à l’article 771 du Code civil.
Que dit la loi ?
L’article 771 du Code civil prévoit que l’héritier ne peut être obligé à choisir avant un délai de quatre mois suivant l’ouverture de la succession. Passé ce délai, un co-héritier, un créancier de la succession, un héritier de rang subséquent ou l’État peut lui adresser une sommation d’opter par acte extrajudiciaire.
L’article 772 précise que l’héritier dispose alors d’un délai de deux mois pour se décider ou demander un délai supplémentaire au juge. Ce dernier peut accorder un report, notamment si l’inventaire n’est pas achevé ou si d’autres motifs sérieux existent.
Quelles sont les options pour l’héritier sommé d’opter ?
À la réception de la sommation, l’héritier doit choisir entre trois options :
Accepter purement et simplement la succession. Il accepte l’ensemble des biens et des dettes.
Accepter à concurrence de l’actif net. Dans ce cas, l’héritier ne règle les dettes qu’à hauteur des biens qu’il reçoit.
Renoncer à la succession. Il refuse totalement sa part d’héritage.
Qu’arrive-t-il en cas de silence ?
Si l’héritier ne prend aucune décision dans les deux mois (ou dans le délai supplémentaire accordé), la loi considère qu’il a accepté purement et simplement la succession.
La procédure de sommation d’opter
Pour engager la sommation d’opter, les co-héritiers ou créanciers doivent s’adresser à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Celui-ci remet l’acte à l’héritier concerné.
La loi impose d’attendre quatre mois après l’ouverture de la succession avant d’agir. Ce délai permet de réaliser un inventaire complet des biens.
En conclusion
La sommation d’opter est un outil juridique efficace pour sortir d’une succession bloquée. Elle oblige l’héritier récalcitrant à se positionner dans des délais clairs. Passé ces délais, son silence vaut acceptation.
En cas de blocage, il est recommandé de consulter un avocat pour mener cette procédure dans les règles. L’intervention d’un professionnel garantit le respect des étapes légales et accélère le dénouement de la succession.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions.
Lire la suite