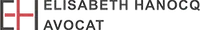Actualités

Indemnisation des accidents de la circulation – Avocat AVIGNON
Accident de la route : Tout savoir sur vos droits à l’indemnisation
Vous avez récemment été victime d’un accident de la route et vous vous interrogez sur les démarches à entreprendre pour obtenir une indemnisation ? Voici les principales étapes à suivre pour maximiser vos chances d’être justement dédommagé.
Qui vous indemnisera ?
L’indemnisation est généralement prise en charge par l’assurance du responsable de l’accident. Cependant, si ce dernier n’est pas assuré ou reste inconnu, c’est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) qui interviendra.
Pour engager la procédure, vous devez transmettre une déclaration d’accident accompagnée de justificatifs. Ces documents permettent à l’assureur ou au Fonds de Garantie d’examiner votre dossier et de mandater un expert pour réaliser une expertise médicale. Cette étape est cruciale pour évaluer l’étendue de vos préjudices.
Avant d’entamer cette expertise, il est conseillé de préparer soigneusement votre dossier afin d’éviter certaines erreurs fréquentes et d’obtenir une indemnisation optimale.
Responsabilité et droits des victimes
La législation française, notamment la Loi Badinter, accorde une protection renforcée à certaines catégories de victimes, comme les piétons, passagers ou cyclistes. Ces derniers sont indemnisés même en cas de faute de leur part. Par exemple, un piéton blessé en traversant hors des passages piétons pourra obtenir réparation pour son préjudice corporel, sauf exceptions, telles qu’une tentative de suicide.
Ces victimes peuvent également percevoir des provisions avant l’expertise médicale, ce qui leur permet de couvrir rapidement des frais urgents, tels que la perte de revenus ou les frais médicaux.
En cas d’accident de trajet lié au travail, la Sécurité sociale intervient en versant des indemnités journalières. Toutefois, celles-ci seront déduites de l’indemnisation définitive réglée par l’assureur.
Pour les conducteurs de véhicules motorisés, l’indemnisation dépend des circonstances de l’accident :
Si vous n’êtes pas responsable : c’est l’assurance du tiers ou le Fonds de Garantie qui prend en charge l’intégralité des préjudices.
Si vous êtes responsable : vous ne serez indemnisé que si vous avez souscrit une Garantie Conducteur. Dans ce cas, le montant versé dépendra des clauses de votre contrat.
Comment est déterminé le montant de l’indemnisation ?
Le montant de l’indemnisation est évalué au cas par cas, après discussion avec l’assureur ou le Fonds de Garantie. Faire appel à un avocat est vivement recommandé, notamment si vous subissez des préjudices graves ou des séquelles durables. L’avocat vous accompagnera pour chiffrer précisément les impacts financiers et personnels de l’accident.
L’indemnisation tient compte de nombreux facteurs, comme :
Les séquelles physiques ou psychologiques,
Les pertes de revenus actuelles et futures,
L’impact sur votre carrière professionnelle ou votre retraite,
Les aménagements nécessaires à votre logement ou véhicule en cas de handicap.
Le rôle clé de l’expertise médicale
Une fois votre état de santé consolidé (stabilisé médicalement), un médecin expert évaluera vos préjudices. Ces derniers sont classés en deux catégories :
Les préjudices temporaires : perte de revenus provisoire, douleur liée à l’accident, etc.
Les préjudices permanents : séquelles définitives, préjudice esthétique, perte d’autonomie, etc.
Chaque poste de préjudice est quantifié à l’aide d’un barème qui prend en compte votre âge, votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que vos besoins spécifiques (logement adapté, impossibilité de pratiquer certains loisirs, etc.).
Pourquoi faire appel à un avocat ?
Maître Elisabeth HANOCQ vous accompagne tout au long du processus d’indemnisation. Grâce à son expertise, elle peut débloquer rapidement des provisions et défendre vos intérêts pour obtenir la meilleure compensation possible.
Que vous soyez victime d’un accident de la route en tant que piéton, cycliste, passager ou conducteur, un accompagnement juridique adapté est essentiel pour faire valoir vos droits et obtenir une indemnisation juste et complète.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités
Lire la suite

Successions : la transmission de la prestation compensatoire – Avocat AVIGNON
Décès de l’époux débiteur : traitement de la prestation compensatoire dans la succession
Lorsqu’un époux débiteur d’une prestation compensatoire décède, son paiement, quelle qu’en soit la forme (rente ou capital), est prélevé sur l’actif successoral.
Les héritiers du défunt en supportent la charge, mais uniquement dans la limite des biens de la succession. Si celle-ci est insuffisante, les légataires particuliers peuvent également être mis à contribution, proportionnellement à leur part, conformément aux dispositions de l’article 927 du Code civil.
Transformation de la prestation compensatoire au décès
Deux cas se présentent selon la forme initiale de la prestation compensatoire :
Capital échelonné : en cas de décès, le solde restant dû devient immédiatement exigible, indexé selon les conditions prévues à l’article 275 du Code civil.
Rente viagère : elle est automatiquement convertie en un capital exigible immédiatement à prélever sur la succession.
Cependant, les héritiers peuvent décider collectivement de maintenir les modalités initiales de paiement qui incombaient au défunt. Cette décision doit faire l’objet d’un acte notarié, sous peine de nullité, et engage personnellement les héritiers au paiement de la prestation compensatoire.
Une affaire révélatrice : le sort d’une rente après le décès
Dans une affaire récente, un homme, condamné dans le cadre de son divorce à verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle à son ex-épouse, est décédé. Sa seconde épouse a alors saisi la justice, au nom de leurs enfants mineurs, pour demander la suppression de cette prestation compensatoire envers la première épouse.
La cour d’appel a accepté cette demande et jugé que les héritiers étaient recevables à demander une révision de la rente viagère fixée au titre de la prestation compensatoire.
Cependant, la première épouse a contesté cette décision devant la Cour de cassation, qui lui a donné raison.
La décision de la Cour de cassation
Dans son arrêt rendu le 21 juin 2023 (Cass. 1re civ., n° 21-17.077, F-B), la Haute juridiction a rappelé plusieurs principes fondamentaux en matière de prestation compensatoire au décès du débiteur :
Les dispositions des articles 280 et 280-1 du Code civil, issus de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, s’appliquent aux prestations compensatoires attribuées avant le 1er janvier 2005, sauf si la succession du débiteur avait déjà fait l’objet d’un partage définitif avant cette date.
En cas de décès du débiteur, la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée, à moins qu’un accord unanime des héritiers ne prévoie son maintien sous la forme initiale.
Dans cette affaire, la rente viagère avait été fixée en 1995. Aucun accord des héritiers pour maintenir les modalités de la rente n’a été constaté, et aucun partage définitif de la succession n’avait été réalisé. Par conséquent, la rente devait être transformée en capital, directement prélevé sur la succession.
La Cour de cassation a conclu que les héritiers ne disposaient pas de la qualité nécessaire pour demander une révision de la rente. En l’absence d’accord entre eux pour poursuivre les modalités de paiement sous forme de rente, celle-ci est automatiquement convertie en capital.
Cette décision illustre que, pour contester une prestation compensatoire après le décès du débiteur, il est impératif de respecter strictement les dispositions légales.
L’importance de l’accompagnement juridique
Ces situations complexes montrent combien il est crucial d’être bien accompagné. La gestion des prestations compensatoires dans le cadre d’une succession peut engendrer des enjeux financiers importants pour les héritiers et les légataires.
Un avocat spécialisé en droit de la famille et des successions vous aidera à défendre vos intérêts et à naviguer dans ces procédures délicates, qu’il s’agisse d’organiser le règlement de la prestation compensatoire ou de contester certaines modalités.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Droit des successions : Testament et envoi en possession - Avocat AVIGNON
L’envoi en possession d’un légataire universel : droits et obligations
Lorsqu’un testament désigne un légataire universel et qu’aucun héritier réservataire n’existe, le bénéficiaire du legs doit obligatoirement solliciter un envoi en possession pour faire reconnaître ses droits.
Une personne désignée comme légataire est présumée propriétaire des biens légués dès le jour de l’ouverture de la succession. Cependant, cette présomption ne produit ses effets que si la délivrance du legs est demandée dans les délais prévus par la loi.
Une affaire révélatrice
Dans une affaire récente, une femme décédée en juillet 2010 avait laissé un testament authentique daté de juin 2010. Ce testament instituait une personne comme légataire d’une partie de ses biens immobiliers, aux côtés de ses enfants, héritiers légaux.
Les héritiers ont contesté la décision de la cour d’appel, qui avait permis à la légataire de jouir des biens légués depuis le décès en juillet 2010, tout en rejetant leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette même date.
La décision de la Cour de cassation
Par un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. civ. 1ère, n°21-20.396), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Bien que le légataire particulier devienne juridiquement propriétaire du bien dès l’ouverture de la succession, ce droit est conditionné à une demande de délivrance du legs (l’article 1014 du Code civil).
La Cour a précisé qu’il importe peu que le testateur ait remis le bien au légataire avant son décès. En l’absence de demande de délivrance, le légataire est privé de tout droit sur le bien.
Ainsi, la cour d’appel a commis une erreur en exemptant la légataire du paiement d’une indemnité d’occupation alors qu’elle n’avait pas respecté l’obligation légale de demander la délivrance du legs.
Les conséquences juridiques de l’omission de délivrance
Le non-respect des formalités relatives à la délivrance du legs peut entraîner des conséquences graves pour le légataire :
Perte des droits de propriété. Si la prescription est acquise, le légataire perd non seulement la propriété du bien légué, mais également les fruits produits par celui-ci (par exemple, les loyers ou autres revenus).
Obligation d’indemnisation. Faute d’avoir demandé la délivrance dans les délais, le légataire pourrait être tenu de verser une indemnité d’occupation aux héritiers légaux ou réservataires pour l’utilisation du bien.
Prescription et délivrance du legs
L’article 1014 du Code civil se combine à l’article 2219 du même code. Une fois la prescription acquise, le légataire perd irrémédiablement ses droits sur le bien.
Dans cette affaire, la Cour a également rappelé que les délais doivent être rigoureusement respectés. A défaut, les héritiers peuvent revendiquer les biens légués et en demander la restitution, même si le légataire en avait la jouissance depuis le décès du testateur.
En pratique : pourquoi faire appel à un avocat ?
Les successions impliquant des legs peuvent rapidement devenir complexes et conflictuelles. Un avocat spécialisé en droit des successions peut vous accompagner pour :
Rédiger et formaliser les demandes de délivrance de legs dans les délais légaux,
Contester ou défendre une jouissance anticipée d’un bien légué,
Prévenir les risques liés à la prescription et protéger vos droits.
Que vous soyez héritier ou légataire, un accompagnement juridique est essentiel pour vous accompagner dans le cadre d’une succession.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Immobilier et Déclaration des servitudes - Avocat AVIGNON
Immobilier : Servitudes non apparentes et responsabilité du vendeur
L'article 1638 du Code civil stipule que si un bien vendu est grevé de servitudes non apparentes, sans déclaration préalable, et que celles-ci sont suffisamment importantes pour laisser supposer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il avait été informé, celui-ci peut demander la résiliation de la vente ou, à défaut, une indemnisation.
Une récente décision de la Cour de cassation est venue clarifier les conditions dans lesquelles l'importance de la servitude intervient, non pas pour l'indemnisation, mais uniquement pour justifier l'annulation de la vente.
Dans cette affaire, des acquéreurs avaient acheté une maison construite sur un terrain où ils ont découvert, lors de travaux d'extension, une canalisation enterrée faisant partie du réseau public d'eaux usées. Cette découverte a rendu impossible la réalisation des travaux tels qu'ils les avaient initialement envisagés.
Les acheteurs ont alors intenté une action contre les vendeurs, invoquant la garantie prévue à l'article 1638 du Code civil pour servitudes non apparentes non déclarées, ainsi qu’un manquement au devoir d'information.
La garantie d'éviction et son champ d'application
L’article 1638 s'inscrit dans le cadre des règles générales de garantie contre l’éviction prévues par le Code civil. En vertu de l’article 1626, le vendeur a l’obligation légale d’assurer à l’acquéreur une jouissance paisible du bien vendu et doit garantir celui-ci contre toute éviction ou charge non déclarée qui en limiterait l'usage.
Cependant, la Cour de cassation a rappelé que l’importance de la servitude occulte n’est déterminante que pour la résiliation de la vente. En revanche, pour une demande d’indemnisation, seule l’existence du préjudice et son ampleur comptent.
Appréciation judiciaire de l'indemnisation
Dans cette affaire, les juges d'appel avaient refusé d'indemniser les acquéreurs, estimant que :
La possibilité d’une extension de la maison ne constituait pas une condition essentielle de l’achat.
La présence de la servitude enterrée ne remplissait pas le critère d'importance nécessaire à l'annulation du contrat ou à l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 1638.
Or, la Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a jugé que la Cour d'appel avait appliqué à tort le critère d'importance de la servitude pour une demande de dommages-intérêts, alors que seule la réalité et l’étendue du préjudice subi par l’acquéreur auraient dû être prises en compte.
Conclusion et implications pour les acquéreurs et vendeurs
Cette décision (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-13.179) souligne que l’indemnisation d’un préjudice causé par une servitude non apparente repose avant tout sur l’évaluation du préjudice réel. L’importance de la servitude est un critère décisif uniquement pour l’annulation de la vente.
Les vendeurs doivent donc veiller à déclarer toutes les charges grevant le bien, même celles qui ne sont pas immédiatement visibles, afin d’éviter des litiges ultérieurs. Quant aux acquéreurs, ils ont intérêt à vérifier en détail la situation juridique du bien et à clarifier leurs attentes dès la phase de négociation.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier - Servitudes
Lire la suite

Troubles anormaux de voisinage : que retenir en cas de nuisance sonore d'un poulailler ? Avocat AVIGNON
Troubles anormaux de voisinage : que retenir en cas de nuisance sonore d'un poulailler ?
Un couple, estimant subir des nuisances sonores causées par un poulailler voisin, a saisi la justice pour trouble anormal de voisinage. Toutefois, leur demande a été rejetée par la cour d’appel, qui s’est fondée sur plusieurs éléments clés, dont le respect des seuils fixés par le Code de la santé publique.
En effet, selon l’article R 1336-7 du Code de la santé publique, les nuisances sonores doivent dépasser certaines valeurs pour être considérées comme excessives. Or, la seule mesure acoustique présentée dans cette affaire avait été réalisée à l’extérieur de la maison, alors que les plaignants faisaient état de réveils nocturnes ou matinaux perturbant leur sommeil. Faute de mesures complémentaires ou d'attestations supplémentaires étayant de manière précise l’intensité des nuisances, la cour a considéré que le caractère anormal du trouble n’était pas établi.
Ainsi, la Cour d’appel a jugé à juste titre que les conditions dans lesquelles la mesure acoustique avait été effectuée étaient insuffisantes pour prouver le préjudice invoqué. La Cour de cassation, saisie en dernier recours, a confirmé cette analyse en rejetant le pourvoi, estimant l’arrêt conformément justifié en droit.
Référence juridique : Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 22-11.658, F-D ; JurisData n° 2023-005543
Points à retenir pour les troubles de voisinage
Cette décision met en lumière un point crucial en matière de trouble anormal de voisinage :
Les mesures acoustiques doivent être réalisées dans des conditions adaptées au préjudice allégué (ici, à l’intérieur du domicile pour des troubles nocturnes).
Les preuves du trouble doivent être solides et variées, telles que des constats d’huissier ou des attestations corroborant les nuisances ressenties.
Si vous êtes confronté à un trouble de voisinage, il est essentiel de réunir des éléments de preuve consistants afin d’établir le caractère anormal du trouble. N'hésitez pas à consulter le cabinet de Me HANOCQ pour être accompagné dans votre démarche juridique.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Troubles de voisinage
Lire la suite

Faute de l’agent immobilier et défaut d’information - Avocat AVIGNON
Faute de l’agent immobilier et défaut d’information
Dans une affaire récente, la cour d’appel a rappelé que l’agent immobilier, en sa qualité de professionnel et mandataire du vendeur, devait mentionner des informations essentielles sur le bien vendu. En l’espèce, le bien concerné était une maison de type « Mondial Pratic », construite avec des plaques en fibrociment contenant de l’amiante. Ce n’est qu’après la vente que l’acquéreur a découvert ce risque par ses propres recherches.
La cour a considéré que l’agent immobilier avait manqué à son obligation d’information, engageant ainsi sa responsabilité. L’expertise a également établi que la présence d’amiante rendait la maison inhabitable, les travaux ordinaires étant impossibles. Le préjudice des acquéreurs a donc été fixé au coût des travaux nécessaires pour éliminer ce défaut.
Référence juridique : Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.082, F-D ; JurisData n° 2023-003842
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Accident de la circulation et faute du conducteur victime - Avocat AVIGNON
Accident de la circulation : la faute inexcusable de la victime
En cas d'accident de la circulation, les victimes, à l'exception des conducteurs de véhicules à moteur, bénéficient d'une indemnité pour leurs dommages corporels. Toutefois, selon l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, leur faute inexcusable peut exclure tout droit à réparation si elle est la cause exclusive de l'accident.
La faute inexcusable se caractérise par un acte volontaire d'une gravité exceptionnelle, exposant son auteur à un danger manifeste dont il aurait dû avoir conscience.
Exemple : Dans une décision du 13 avril 2023 (CA Paris, n° 21/18342), une victime, passagère arrière, a ouvert volontairement la portière d'un véhicule en marche (30-40 km/h) et a tenté de descendre par jeu. En posant un pied à terre, elle a chuté. Les juges ont retenu que cette faute, d'une exceptionnelle gravité, était la cause exclusive de l'accident. La consommation d'alcool par la victime n'a pas écarté sa responsabilité, car elle conservait son discernement.
Ainsi, en présence d'une faute inexcusable, aucun droit à indemnité n'est reconnu, surtout si aucune faute du conducteur n'est établie.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – accident de la circulation – indemnisation préjudice corporel
Lire la suite

Accident de la circulation : la faute inexcusable de la victime peut exclure toute indemnisation - Avocat AVIGNON
En cas d'accident de la circulation, les victimes, à l'exception des conducteurs de véhicules à moteur, bénéficient d'une indemnité pour leurs dommages corporels. Toutefois, selon l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, leur faute inexcusable peut exclure tout droit à réparation si elle est la cause exclusive de l'accident.
La faute inexcusable se caractérise par un acte volontaire d'une gravité exceptionnelle, exposant son auteur à un danger manifeste dont il aurait dû avoir conscience.
Dans une décision du 13 avril 2023 (CA Paris, n° 21/18342), une victime, passagère arrière, a ouvert volontairement la portière d'un véhicule en marche (30-40 km/h) et a tenté de descendre par jeu. En posant un pied à terre, elle a chuté. Les juges ont retenu que cette faute, d'une exceptionnelle gravité, était la cause exclusive de l'accident. La consommation d'alcool par la victime n'a pas écarté sa responsabilité, car elle conservait son discernement.
Ainsi, en présence d'une faute inexcusable, aucun droit à indemnité n'est reconnu, surtout si aucune faute du conducteur n'est établie.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – accident de la circulation – indemnisation préjudice corporel
Lire la suite

Comment déshériter son époux (se) ? Avocat AVIGNON
Comment déshériter son époux (se) ?
Il est complexe de priver totalement un conjoint de ses droits dans une succession en raison des protections juridiques qui lui sont accordées. Toutefois, certaines solutions permettent de réduire la part héréditaire qui revient au conjoint survivant. Voici quelques stratégies à envisager. Il est toutefois essentiel de consulter un avocat pour des conseils adaptés à votre situation personnelle.
Le régime matrimonial : Le choix du régime matrimonial a une influence majeure sur le partage du patrimoine en cas de décès. Par exemple, le régime de la séparation de biens permet aux époux de conserver des patrimoines distincts. Cela peut réduire les droits successoraux du conjoint survivant.
La donation entre époux : Bien que le conjoint survivant dispose par défaut de droits prévus par la loi, une donation entre époux permet de les ajuster. Ce dispositif peut à la fois augmenter ou diminuer la part successorale du conjoint, sans pour autant l'en exclure complètement.
Le testament : Rédiger un testament permet d'organiser la répartition des biens au moment du décès. Cependant, la loi impose de respecter les droits minimaux du conjoint survivant, qui ne peut être totalement déshérité.
Les protections légales du conjoint survivant : Afin d'assurer une certaine stabilité financière, le droit français prévoit des protections spécifiques. Parmi elles figure la réserve héréditaire, qui garantit une part minimale de la succession aux héritiers réservataires, notamment les enfants, et dans certaines situations, le conjoint survivant. Cette part ne peut être contournée, même par testament.
De plus, le conjoint survivant dispose d'un droit temporaire au logement, qui lui permet de rester dans le domicile familial pendant un an, même si le bien a été légué à un autre héritier. Pour assurer sa stabilité à long terme, il peut également choisir un droit viager d'usufruit. Ce droit lui permet de continuer à occuper le logement et d'en percevoir les revenus jusqu'à son propre décès. Ce mécanisme s'applique automatiquement si aucun enfant n'est présent ou en l'absence de dispositions contraires.
Par ailleurs, le conjoint survivant peut être éligible à une pension de réversion, qui correspond à une partie de la retraite du défunt. Cette pension constitue un complément financier non négligeable, en plus des droits successoraux.
L'assurance-vie : Souscrire une assurance-vie avec un bénéficiaire autre que le conjoint permet de transmettre une part du patrimoine en dehors des règles successorales. Cette stratégie est souvent utilisée pour contourner partiellement les limites légales.
Le pacte adjoint : Ce document notarié offre la possibilité de modifier certains droits du conjoint survivant, tout en respectant le cadre juridique existant.
En conclusion, bien que la loi assure des protections solides au conjoint survivant, il est possible d'aménager ses droits successoraux à travers diverses options juridiques. Une consultation avec un avocat reste indispensable pour définir la stratégie la plus appropriée à votre situation et à vos objectifs patrimoniaux.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite