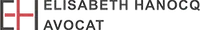Actualités

Responsabilité du Notaire et omission d’une servitude – Avocat AVIGNON
Le Notaire qui n’a pas mentionné une servitude non apparente n'est pas responsable, dès lors que le vendeur est tenu de l’exécution de la garantie prévue par l’article 1638 du Code civil.
Dans une récente décision, la Cour de cassation a précisé les contours de la responsabilité d’un notaire ayant omis de mentionner une servitude non apparente dans un acte de vente.
Dans cette affaire, le notaire avait rédigé l’acte sans signaler l’existence d’un droit de passage grevant le bien vendu. La Cour d’appel avait initialement reconnu sa responsabilité solidaire avec celle du vendeur, invoquant un manquement à son devoir de garantir l’efficacité juridique de l’acte.
Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2024 (n° 23-12.493, F-D), a annulé cette décision en s’appuyant sur les articles 1240 (anciennement 1382) et 1638 du Code civil. Ce dernier article dispose que si un bien vendu est grevé de servitudes non déclarées et suffisamment importantes pour dissuader l’acquéreur d’acheter, ce dernier peut demander la résiliation de la vente ou, à défaut, une indemnisation.
Selon la Haute Juridiction, la garantie légale prévue par l’article 1638 résulte de l’engagement contractuel des parties, et son application ne constitue pas un préjudice indemnisable en soi. En outre, la responsabilité du notaire ne peut être engagée que si le vendeur, débiteur de la garantie, fait défaut dans l’exécution de cette obligation.
Cet arrêt met en lumière une distinction importante : bien que le notaire ait l’obligation d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il rédige, sa responsabilité n’est pas systématique en cas d’omission. Elle reste subordonnée à l’existence d’un préjudice réel découlant de l’incapacité du vendeur à respecter ses engagements.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Enchères : Le juge ne peut pas adjuger un bien à un prix inférieur à la mise à prix – Avocat AVIGNON
Enchères immobilières : le juge ne peut adjuger un bien à un prix inférieur à la mise à prix légale
Les ventes aux enchères immobilières sont soumises à des règles strictes concernant la fixation et le respect de la mise à prix. La Cour de cassation a récemment rappelé que le juge ne peut pas adjuger un bien à un montant inférieur à celui fixé, sauf dans une situation spécifique prévue par l’article R. 322-47 du CPC.
Cet article prévoit qu’en l’absence d’enchères, et si la mise à prix a été modifiée par décision judiciaire, le bien peut être remis en vente avec des baisses successives, potentiellement jusqu’au montant de la mise à prix initiale.
Par ailleurs, l’article L. 322-6, alinéa 2, permet au débiteur de demander au juge de réviser la mise à prix si celle-ci est manifestement insuffisante. Quant à l’article R. 322-43, il stipule que les enchères doivent obligatoirement commencer à partir du montant fixé dans le cahier des conditions de vente ou par décision judiciaire.
En combinant ces dispositions, le juge de l’exécution n’est autorisé à adjuger un bien à un montant inférieur à la mise à prix initiale que dans le cadre strict prévu par l’article R. 322-47.
Une violation des règles constatée
Dans l’affaire examinée, des biens immobiliers saisis avaient été mis en vente avec une mise à prix fixée à 100 000 €. Pourtant, ces biens ont été adjugés à une société pour un montant de 72 000 €, bien en dessous de la mise à prix légale.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 juin 2024 (n° 22-10.790, F-B), a jugé que cette adjudication violait les textes applicables. En procédant à une vente à un prix inférieur à celui fixé, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs.
Une décision qui renforce la rigueur des ventes aux enchères
Le juge ne peut adjuger un bien à un prix inférieur à la mise à prix légale. Cet arrêt illustre l’importance du respect des règles encadrant les ventes forcées. Le juge doit veiller à ce que le montant de la mise à prix soit respecté.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Divorce : l’indemnité d’occupation d’un bien indivis est due même sans occupation effective – Avocat AVIGNON
Divorce : l’indemnité d’occupation d’un bien indivis est due même sans occupation effective
Conformément à l’article 815-9 du Code civil, l’indemnité d’occupation d’un bien indivis est due dès lors qu’un indivisaire en bénéficie de manière privative, empêchant les autres coïndivisaires d’y accéder, que cette jouissance soit effective ou non, sauf accord contraire entre les parties.
Dans une affaire récente, Mme [K] réclamait que M. [U] soit tenu de lui verser une indemnité pour l’occupation exclusive de leur ancien domicile conjugal, et ce, à partir du 1er octobre 2007 jusqu’au partage des biens. Cependant, la cour d’appel avait rejeté cette demande, s’appuyant sur un échange écrit entre les parties daté du 23 janvier 2010, où il était établi que Mme [K] détenait encore les clés de l’appartement. La cour en avait déduit que M. [U] ne bénéficiait pas d’une jouissance exclusive du bien.
Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, estimant que la cour d’appel avait omis de vérifier si l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011 n’attribuait pas à M. [U] la jouissance exclusive du domicile conjugal. Si tel était le cas, Mme [K] aurait été dans l’impossibilité d’utiliser le logement, rendant ainsi M. [U] redevable de l’indemnité d’occupation.
Il convient de rappeler que, lorsqu’un époux se voit attribuer par ordonnance la jouissance d’un logement, il est tenu de payer une indemnité d’occupation dès la date où les effets patrimoniaux du divorce prennent effet. En revanche, les impôts et charges liés à ce bien, considérés comme des dépenses de conservation, demeurent à la charge de l’indivision.
Référence : Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-13.749, JurisData n° 2024-001311.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Successions : Testament olographe sans date – Avocat AVIGNON
Successions : Testament olographe sans date
L'article 970 du Code civil dispose : Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Lorsqu’un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments constitutifs ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n’est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
De la même manière, la date complétée par l’intervention d’un tiers n’entraîne pas nécessairement la nullité du testament olographe. Lorsqu’une période de rédaction peut être établie à partir d’un point de départ intrinsèque, l’acte de dernière volonté est a priori valide.
Décision de la cour de cassation
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-17.127 : JurisData n° 2024-007507
"Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe qui n'est pas daté de la main du testateur n'est pas valable. Toutefois, lorsqu'un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n'est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. La mention d'une partie de la date figurant sur le testament, écrite de la main du testateur, peut constituer un élément intrinsèque à l'acte"
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Bail d’habitation : Responsabilité du propriétaire face aux troubles causés par le locataire – Avocat AVIGNON
Bail d’habitation : Responsabilité du propriétaire face aux troubles causés par le locataire
Lorsqu’un locataire perturbe la jouissance paisible des autres occupants d’un immeuble et que le propriétaire-bailleur reste inactif face à cette situation, le syndicat des copropriétaires peut agir en justice. En s’appuyant sur l’article 1341-1 du Code civil, cette action oblique permet au syndicat d’obtenir la résiliation du bail et la condamnation solidaire du bailleur et du locataire au versement de dommages et intérêts.
La loi impose au locataire d’user paisiblement du bien loué. En cas de manquement, le propriétaire a l’obligation d’intervenir pour faire cesser les troubles, conformément à l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Celui-ci prévoit qu’un propriétaire doit, après mise en demeure justifiée, utiliser les moyens à sa disposition pour mettre fin aux nuisances causées par son locataire.
Dans une affaire récente, un locataire causait des troubles répétés dans l’immeuble : des chiens agressifs, laissés en liberté, aboyaient sans cesse, perturbant la tranquillité des résidents. Le propriétaire, malgré les signalements, n’a entrepris aucune démarche pour résoudre la situation. Face à cette inaction, le syndicat des copropriétaires a engagé une action oblique pour obtenir la résiliation du bail et réclamer une indemnisation pour le préjudice subi.
Référence : CA Montpellier, 5e ch., 2 avril 2024, n° 21/05214, JurisData n° 2024-005256.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Successions : validité du legs d’un bien indivis – Avocat AVIGNON
Il est possible de léguer un bien indivis, y compris lorsque celui-ci dépend d’une indivision post-communautaire. Toutefois, l’efficacité réelle de ce legs est conditionnée par les résultats du partage entre les coïndivisaires, sauf si la volonté du testateur est interprétée comme imposant à ses héritiers de transférer au légataire la pleine propriété du bien.
Bien que le testateur ne soit pas seul propriétaire du bien légué, il détient néanmoins des droits réels sur celui-ci. Dès lors, le legs d’un bien indivis ne peut être assimilé à une tentative de disposition d’un bien appartenant à autrui.
Référence : Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-13.766, JurisData n° 2024-002827.
Cas d’espèce : contestation de la validité du testament
Dans une affaire récente, un testament olographe du 13 décembre 2015 avait légué des biens immobiliers relevant d’une indivision issue de la dissolution de la communauté entre le testateur et son épouse prédécédée. La cour d’appel avait annulé ce legs, estimant que le testateur ne pouvait disposer seul de ces biens, encore soumis à une indivision avec ses enfants en tant qu’héritiers de leur mère.
Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, rappelant que le caractère indivis d’un bien n’interdit pas sa transmission par voie de legs. La cour d’appel avait erré en assimilant le bien indivis à la propriété exclusive d’un tiers.
Validité et réalisation du legs : deux approches
Le legs d’un bien indivis est valide en principe, mais sa mise en œuvre peut se heurter à des contraintes pratiques, selon deux cas distincts :
Léguer une quote-part indivise :
Un indivisaire peut léguer sa part du bien indivis. Le légataire devient alors copropriétaire et peut participer au partage ultérieur.
Léguer le bien dans son intégralité :
Si le testateur lègue le bien indivis lui-même, la réalisation du legs dépend du partage. Si le bien est attribué à un autre indivisaire lors du partage, le legs devient caduc, faute d’objet. Cette solution stricte peut entraîner une frustration pour le légataire.
Pour éviter cette caducité, les juges du fond reconnaissent souvent dans ces cas l’existence d’une obligation implicite pour les héritiers de garantir la pleine propriété du bien au légataire. Ce mécanisme permet de respecter au mieux la volonté du testateur, même dans un contexte de partage complexe.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Bornage sur bornage ne vaut : un principe confirmé – Avocat AVIGNON
Le principe selon lequel une nouvelle action en bornage est irrecevable si la limite séparative établie demeure certaine a été réaffirmé. Sauf si une incertitude sur la limite séparative apparaît en raison de la disparition des bornes, une action en bornage postérieure n’est pas admise.
Dans un arrêt rendu le 28 mars 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur le litige opposant le propriétaire d’une parcelle à ses voisins. Ce dernier reprochait un empiètement sur son terrain par un mur édifié le long d’une ancienne clôture grillagée et avait engagé une action en bornage.
La Cour d’appel avait rejeté cette demande, décision confirmée par la Cour de cassation, qui a motivé son arrêt comme suit :
Un bornage amiable avait été réalisé en mars 1984, avec implantation de bornes, bien avant que les deux parties n’acquièrent leurs parcelles respectives.
Sur la base des preuves versées aux débats – notamment l’analyse d’un géomètre, une attestation et des photographies – les juges ont établi que, bien que les bornes aient disparu, la limite séparative issue de ce bornage était toujours identifiable. En effet, cette limite avait été concrétisée dès 1989 par l’installation d’une clôture grillagée par les précédents propriétaires, clôture partiellement remplacée plus tard par un mur.
Ainsi, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel : en l’absence d’incertitude sur la limite séparative, la demande en bornage était irrecevable.
Référence : Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473, FS-B
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Droit des successions : la prestation compensatoire au décès du débiteur – Avocat AVIGNON
Quel est le sort de la prestation compensatoire au décès du débiteur ? Lorsqu’un ex-époux débiteur d’une prestation compensatoire décède, le paiement de cette prestation incombe à ses héritiers, sauf s’ils choisissent de renoncer à la succession.
Règles générales :
Exigibilité immédiate : Le solde de la prestation compensatoire devient immédiatement exigible, qu’elle soit versée en capital ou sous forme de rente.
Prélèvement sur l’actif successoral : La prestation compensatoire est d’abord prélevée sur les biens de la succession. Les héritiers ne sont tenus de la régler sur leurs fonds propres que si l’actif successoral est insuffisant.
Maintien des conditions de règlement : Les héritiers peuvent, par acte notarié, décider de conserver les modalités de paiement fixées avant le décès. Cet acte doit être notifié à l’ex-époux créancier si ce dernier n’est pas présent lors de la signature.
Exceptions spécifiques :
Si l’actif successoral ne suffit pas, les héritiers doivent payer sur leurs fonds propres, mais ils conservent la possibilité de solder à tout moment le capital restant dû.
Les héritiers peuvent demander une révision des modalités de paiement.
Pour les rentes viagères fixées avant la loi de 2000 et en l’absence de partage définitif de la succession au 1ᵉʳ janvier 2005, ces rentes ne peuvent être suspendues ou supprimées. Elles doivent être capitalisées et réglées sur la succession.
Cas d’espèce : révision d’une rente viagère
Un homme, divorcé en 1996, avait été condamné à verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle. À son décès en 2012, la représentante légale de ses enfants mineurs a demandé la suppression de cette rente, invoquant un avantage manifestement excessif au profit de l’ex-épouse et des enfants issus de cette précédente union.
Décision des juges d’appel :
La Cour d’appel a accueilli cette demande, se fondant sur les dispositions de la loi du 26 mai 2004 (article 33, VI), permettant la révision ou la suppression d’une rente viagère fixée avant la réforme de 2000 en cas d’avantage disproportionné.
Arrêt de la Cour de cassation :
La Cour de cassation a cassé cette décision, en rappelant que :
Lorsque la succession du débiteur n’a pas été partagée au 1ᵉʳ janvier 2005 (date d’entrée en vigueur de la réforme de 2004), et en l’absence d’un accord entre les héritiers pour maintenir les modalités de paiement sous forme de rente, cette dernière doit être capitalisée.
En conséquence, une action en révision ou suppression de la rente devient irrecevable (articles 280 et 280-1 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi de 2004).
Référence : Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-17.077 F-B
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’Appel de NIMES – Droit des successions
Lire la suite

Droit immobilier : L'Intérêt d'une donation temporaire d'usufruit – Avocat AVIGNON
La donation temporaire d’usufruit est un mécanisme juridique encore méconnu, mais qui offre des avantages considérables tant sur le plan fiscal que patrimonial. Ce dispositif permet au donateur de céder temporairement l’usufruit d’un bien tout en en conservant la nue-propriété. Quels sont les atouts de ce procédé ? Dans quelles situations est-il le plus pertinent ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour optimiser la gestion de votre patrimoine grâce à la donation temporaire d’usufruit.
Donation Temporaire d’Usufruit : Définition et Fonctionnement
L’usufruit est le droit de jouir d’un bien appartenant à une autre personne, tout en percevant les revenus qu’il génère, comme des loyers ou des dividendes. La donation temporaire d’usufruit consiste donc à transférer ce droit à un bénéficiaire pour une durée déterminée, qui peut varier de 3 à 30 ans. Une fois la période écoulée, l’usufruit revient automatiquement au donateur.
Ce mécanisme est particulièrement apprécié car il permet de préserver la nue-propriété tout en offrant des avantages concrets au bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un tiers.
Les Avantages Fiscaux de la Donation Temporaire d’Usufruit
La donation temporaire d’usufruit est un outil puissant pour alléger sa fiscalité tout en transmettant temporairement les bénéfices d’un bien. Voici ses principaux atouts fiscaux :
1. Réduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Pour les contribuables soumis à l’IFI, la donation temporaire d’usufruit permet de réduire significativement l’assiette imposable. En effet, pendant la durée de la donation, le bien concerné est exclu du patrimoine taxable du donateur.
2. Allègement des droits de succession
Ce mécanisme peut également simplifier la transmission patrimoniale. Les droits de donation sont calculés sur la valeur de l’usufruit temporaire, qui est généralement bien inférieure à celle de la pleine propriété. De plus, en transférant les revenus d’un bien sans en aliéner le capital, cette stratégie permet de réduire les droits de succession futurs.
Avantages Patrimoniaux : Une Gestion Efficace et Flexible
Outre ses bénéfices fiscaux, la donation temporaire d’usufruit constitue une solution souple pour optimiser la gestion du patrimoine familial :
1. Soutien financier ciblé
Elle permet de transférer temporairement les revenus générés par un bien à un bénéficiaire, comme un enfant étudiant ou un jeune actif. Ce dernier peut ainsi percevoir des loyers ou des dividendes pour couvrir ses besoins financiers spécifiques, sans toucher au capital.
2. Préservation du patrimoine familial
Contrairement à une donation en pleine propriété, ce dispositif permet de partager les fruits d’un bien tout en préservant son intégrité. Une fois la période de donation terminée, l’usufruit retourne automatiquement au donateur, garantissant ainsi la récupération totale du bien.
3. Contrôle et flexibilité
Le donateur conserve la nue-propriété du bien tout au long de la durée de la donation. Ce maintien du contrôle constitue un avantage majeur pour les propriétaires soucieux de préserver leur patrimoine à long terme.
Applications Pratiques de la Donation Temporaire d’Usufruit
La donation temporaire d’usufruit peut être utilisée dans de nombreuses situations concrètes, notamment :
Soutien aux études des enfants : Par exemple, des parents peuvent transférer l’usufruit d’un appartement à un enfant étudiant. Celui-ci bénéficie des revenus locatifs pour financer ses études et son logement, tandis que les parents optimisent leur fiscalité.
Transmission anticipée : Un grand-parent peut céder l’usufruit temporaire de titres financiers à son petit-enfant, lui permettant de percevoir des revenus réguliers sans altérer le capital. Cette approche est idéale pour préparer en douceur la transmission future du patrimoine.
Pourquoi Faire Appel à un Avocat ?
La mise en place d’une donation temporaire d’usufruit nécessite une analyse juridique et fiscale approfondie. Un avocat spécialisé en droit immobilier ou en gestion patrimoniale pourra vous accompagner à chaque étape, depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la rédaction de l’acte notarié. Cela garantit une mise en œuvre conforme à vos objectifs et à la réglementation en vigueur.
Conclusion
La donation temporaire d’usufruit est une stratégie patrimoniale performante pour réduire votre fiscalité, soutenir financièrement vos proches, ou préparer la transmission de votre patrimoine. Grâce à sa souplesse et à ses nombreux avantages, elle s’impose comme une solution de choix pour les propriétaires soucieux d’optimiser la gestion de leurs biens.
Pour évaluer si ce mécanisme est adapté à votre situation, n’hésitez pas à consulter le cabinet. Son expertise vous permettra de maximiser les bénéfices de cette opération tout en sécurisant vos intérêts.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Droit des successions
Lire la suite