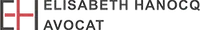Actualités

Rapport d’expertise amiable : une valeur probatoire limitée
Une décision de principe
Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile rappelle que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise amiable, même réalisée contradictoirement. Cette solution, rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile, confirme la ligne jurisprudentielle ouverte par la chambre mixte (28 sept. 2012).
Les faits
Un véhicule d’occasion vendu en 2016 s’était révélé défectueux. Le garagiste, assigné en résolution de la vente, appela en garantie son propre fournisseur. Pour écarter cette demande, la cour d’appel de Grenoble s’était fondée exclusivement sur un rapport d’expertise diligenté par l’assureur de l’acquéreur. La Cour de cassation a censuré cette décision.
Une jurisprudence consolidée
La Haute juridiction souligne que, si l’expertise amiable peut être discutée contradictoirement, elle ne peut suffire à elle seule à emporter conviction. Elle doit être corroborée par d’autres éléments (constats d’huissier, devis, pièces techniques, voire expertise judiciaire).
Portée pratique
En matière de vices cachés comme dans tout litige technique, les praticiens doivent systématiquement produire des preuves complémentaires. À défaut, la décision encourt la cassation.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 23-19668
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES
Lire la suite

Garantie des vices cachés : quand débute la prescription de l’action ?
Dans un arrêt du 28 mai 2025 (Cass. 3e civ., n° 23-18.781), la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés ne court pas à compter de la découverte du vice, mais à partir de l’assignation en responsabilité du constructeur ou, à défaut, de l’exécution par ce dernier de son obligation de réparation.
Les faits
À la suite de travaux de réhabilitation, des désordres sont constatés sur un bardage. L’assureur dommages-ouvrage indemnise le maître d’ouvrage. L’entreprise responsable et son assureur se retournent contre le fournisseur des matériaux et son assureur, en invoquant la garantie des vices cachés.
La Cour d’appel de Rouen (24 mai 2023) juge l’action prescrite, considérant que le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du Code civil a débuté dès la découverte du vice, soit le 25 juillet 2017.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et adopte une approche différente : dans une action récursoire, le délai de prescription commence au moment où le constructeur est lui-même assigné ou a exécuté sa dette de réparation.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729 ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305) et repose sur la finalité de l’action récursoire : transférer la charge de la réparation au fournisseur réellement responsable.
En pratique
Pour les constructeurs et leurs assureurs : ils disposent de plus de temps pour agir contre un fournisseur, même si la découverte du vice est ancienne.
Pour les fournisseurs : le risque d’être assigné subsiste longtemps après la découverte du désordre, d’où l’importance d’une gestion rigoureuse des dossiers.
Le point de départ du délai de prescription d’une action récursoire en matière de garantie des vices cachés ne coïncide pas avec la découverte du vice, mais avec l’assignation ou la condamnation du constructeur.
Cette décision sécurise les recours dans la chaîne contractuelle et assure une répartition équitable des responsabilités.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Assurance-vie : revirement sur la substitution du bénéficiaire
Par un arrêt du 3 avril 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-13.803, FS-B), la Cour de cassation modifie sa jurisprudence concernant la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
Désormais, aucune formalité particulière n’est exigée pour valider une telle modification. Il suffit que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière claire et non équivoque, cette volonté étant appréciée souverainement par les juges du fond.
Les faits de l’affaire
Un souscripteur avait désigné initialement Mme X comme bénéficiaire unique de ses contrats d’assurance-vie.Par la suite, il avait modifié la clause bénéficiaire afin de répartir les capitaux entre Mme X et d’autres personnes.
Après son décès, l’assureur a néanmoins versé l’intégralité des capitaux à Mme X, estimant que la dernière modification n’avait pas été portée à sa connaissance avant le décès.L’assureur a alors saisi la justice pour obtenir le remboursement des sommes versées.
La cour d’appel de Bastia a rejeté sa demande, en s’appuyant sur la jurisprudence antérieure, qui exigeait que l’assureur ait connaissance de la modification avant le décès pour qu’elle soit valable.
Le revirement de la Cour de cassation
La Cour de cassation abandonne cette position et juge désormais que :
la notification préalable à l’assureur n’est plus une condition de validité de la substitution du bénéficiaire ;
seule importe la volonté certaine et non équivoque du souscripteur, sans qu’un formalisme particulier soit requis.
Cette décision apporte une plus grande souplesse et sécurité juridique pour les souscripteurs et leurs héritiers.Elle permet d’éviter qu’une modification clairement exprimée devienne inopérante en raison d’un simple défaut d’information de l’assureur.
Références
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803, FS-B
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655
Lire la suite

Incendie et responsabilité du locataire – Avocat Avignon
La responsabilité en matière d'incendie et de communication d'incendie
L’article 1242 du Code civil dispose :
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Confirmation du principe par la Cour de cassation
La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 novembre 2024 (n° 23-15.674), a rappelé que la responsabilité pour un incendie causé par un court-circuit électrique relève de l'article 1242, al. 2, du Code civil. En l'espèce, un incendie déclenché par l'échauffement anormal d'un câble électrique dans une chaufferie communale s'était propagé au bardage en bois du bâtiment. La commune a cherché à engager la responsabilité du distributeur d'énergie, Enedis, en tant que gardien du câble.
Toutefois, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité de la société sans caractériser une faute de sa part, confirmant ainsi que la responsabilité pour incendie selon l'article 1242, al. 2, n'est engagée qu'en présence d'une faute du gardien de la chose. Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence constante qui applique strictement ce régime spécial de responsabilité en cas de communication d'incendie, indépendamment de la cause première de l'incendie.
Pour les avocats, cette jurisprudence rappelle l'importance de démontrer la faute dans ce type de litiges, même lorsque l'origine de l'incendie est clairement identifiée. Elle souligne également la nécessité d'une analyse minutieuse des faits et des règles applicables pour défendre au mieux les intérêts de leurs clients.
Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, n° 23-15.674, F-D : JurisData n° 2024-022584
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Divorce par consentement mutuel : L’E-DCM est le nouvel outil pour la dématérialisation – Avocat AVIGNON
L’e-DCM pour le divorce par consentement mutuel
Le CNB et le CSN ont signé le 15 juin 2022 la convention officialisant le divorce par consentement mutuel électronique.
Sa création permettra aux avocats, aux notaires et aux couples de disposer dorénavant d’une solution numérique fluide et efficace les conventions de divorce par consentement mutuel.
Dès à présent, les avocats et les notaires ont la possibilité de proposer à leurs clients la signature électronique de leur convention de divorce par consentement mutuel.
Il s’agit d’un outil simple et rapide. La convention de divorce sera ainsi signée électroniquement par les époux en présence de leurs avocats.
Les notaires pourront de leur côté procéder au dépôt électronique de cette convention au rang de leurs minutes, rendant le divorce effectif.
Cet outil, facturé 25 € HT, est disponible sur la plateforme e-Actes d’avocat.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce par consentement mutuel
Lire la suite

Cas de rupture de prothèse mammaire : la responsabilité médicale – Avocat AVIGNON
Lorsqu'une prothèse mammaire se rompt, le fabricant est tenu responsable de plein droit des dommages subis par la victime, sauf s'il peut démontrer que cette rupture résulte d'un acte imputable à la victime elle-même ou à un tiers. En conséquence, il doit indemniser l'intégralité des préjudices causés par ce défaut.
Le fait que la prothèse respecte les normes en vigueur lors de sa mise sur le marché ne dispense pas le fabricant de sa responsabilité. En effet, la conformité aux normes n'exclut pas la possibilité d'un défaut de fabrication ponctuel, passé inaperçu lors des contrôles qualité.
De plus, l'existence d'une notice précisant la durée de vie limitée des implants et recommandant leur remplacement n'est pas suffisante pour exonérer le fabricant. Il en va de même si la victime confirme avoir été correctement informée par son médecin des risques liés à la pose de l'implant.
Dans le cas examiné, la rupture de la prothèse mammaire gauche est survenue dans un délai anormalement court. Ce dysfonctionnement a privé la patiente de la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s'attendre. La situation répond ainsi aux critères définissant la défectuosité d’un produit, engageant la responsabilité du fabricant.
CA Riom, ch. com., 4 sept. 2024, n° 23/01071 : JurisData n° 2024-015356
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Responsabilité médicale
Lire la suite

Bail d’habitation et clause résolutoire : le nouveau délai de 6 semaines 'applique uniquement aux nouveaux baux – Avocat AVIGNON
Clause résolutoire des baux d'habitation : le nouveau délai de 6 semaines ne s'applique pas aux baux en cours
Cass. avis, 3e civ., 13 juin 2024, n° 24-70.002, P + B : JurisData n° 2024-008999
Le délai réduit de 6 semaines dont dispose un locataire pour régler sa dette après la délivrance d’un commandement de payer, avant que la clause résolutoire ne prenne effet, s'applique uniquement aux baux signés après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Les contrats en cours continuent de relever de l’ancien délai de 2 mois.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans le cadre d’une demande d’avis.
Avant la réforme introduite par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyait un délai de 2 mois pour le locataire afin de régulariser sa situation après réception d’un commandement de payer. Désormais, ce délai a été réduit à 6 semaines.
Toutefois, conformément au principe de non-rétroactivité des lois prévu par l’article 2 du Code civil, cette nouvelle disposition ne modifie pas les règles applicables aux baux déjà en cours. Les locataires dont les contrats ont été signés avant l’entrée en vigueur de la loi restent soumis à l’ancien délai de 2 mois, tel que stipulé dans leur bail.
La Cour de cassation a confirmé que l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifie les délais applicables, n’a pas vocation à s’appliquer rétroactivement. Ainsi, les contrats en cours conservent les délais prévus dans leurs clauses contractuelles et encadrés par la législation en vigueur au moment de leur conclusion.
En conséquence, la réduction du délai à 6 semaines, introduite par l’article 10 de la loi n° 2023-668, s’applique uniquement aux nouveaux baux conclus après l’entrée en vigueur de la réforme, sans incidence sur les contrats en cours.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite

Bail d’habitation : Relogement des locataires âgés aux ressources modestes – Avocat AVIGNON
Dans le cadre d’un bail d’habitation, les locataires âgés disposant de faibles ressources bénéficient d’une protection spécifique. L’obligation du bailleur de leur proposer une solution de relogement peut être remplie pendant la période de préavis du congé. Toutefois, si le locataire communique tardivement les informations relatives à sa situation, le bailleur ne peut être tenu responsable de l’absence d’offre de relogement.
Cadre légal : l'article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989
La loi du 6 juillet 1989 offre une protection supplémentaire aux locataires âgés de plus de 65 ans dont les ressources sont inférieures au plafond fixé pour l’attribution des logements locatifs conventionnés (plafond « PLUS », prêt locatif à usage social). Quelle que soit la raison du congé donné par le bailleur – y compris pour motif légitime ou sérieux comme des impayés ou des troubles de voisinage –, ce dernier est tenu de proposer une alternative de relogement au locataire concerné.
Une question essentielle concerne le moment à partir duquel le bailleur doit proposer cette offre. Pour ce faire, le bailleur doit disposer des informations nécessaires concernant la situation personnelle et financière de son locataire, ce qui n’est pas toujours automatique. En effet, le bailleur n’est pas obligé de connaître d’office l’âge ou les revenus de son locataire.
La jurisprudence (Cass. 3e civ., 2 juin 2010, n° 09-66.698 ; Cass. 3e civ., 4 mai 2011, n° 10-15.097) précise qu’il suffit que l’offre de relogement soit faite au cours de la durée du préavis. Cela signifie que l’obligation du bailleur reste valable tant que le délai de préavis n’est pas écoulé.
Conséquences d'une notification tardive par le locataire
Dans certains cas, le locataire peut informer tardivement le bailleur de sa situation. Si cette notification intervient à une date proche de l’expiration du congé, le bailleur peut être dans l’impossibilité matérielle de proposer un relogement dans les délais impartis.
Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Pau (CA Pau, 2e ch., 1re sect., 31 juillet 2024, n° 23/03320), un locataire n’a informé son bailleur de son âge et de ses ressources que à un mois de la fin du bail. Le congé avait pourtant été notifié huit mois auparavant, en janvier 2022, pour une prise d’effet en septembre 2022.
La cour a estimé que ce délai tardif ne permettait pas au bailleur de remplir son obligation de relogement. Elle a donc jugé que le locataire était tenu de fournir ces informations en temps utile pour permettre au bailleur de proposer une solution avant l’expiration du préavis. Le congé a été jugé régulier dans cette situation.
Pour que l’offre de relogement soit effective, il est indispensable que le locataire communique rapidement son statut éligible au bailleur. Si cette démarche est effectuée tardivement, le bailleur ne pourra être tenu responsable de l’absence d’offre. Cette jurisprudence souligne l’importance d’une communication claire et précoce entre les parties pour garantir le respect des droits prévus par la loi du 6 juillet 1989.
Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Droit immobilier
Lire la suite
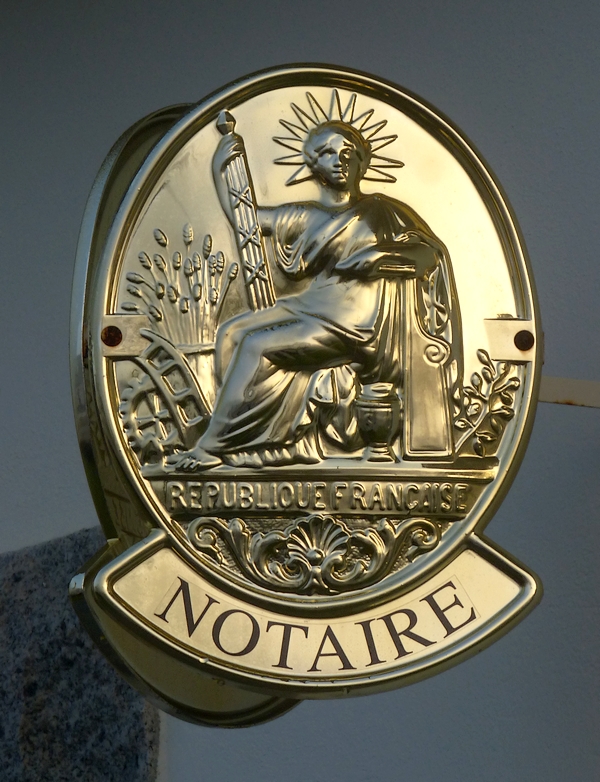
Responsabilité du Notaire concernant une promesse unilatérale de vente – Avocat AVIGNON
La Responsabilité du Notaire face à un manquement à son devoir de conseil concernant une promesse unilatérale de vente
Un notaire peut être tenu responsable lorsqu'il manque à son obligation d’éclairer ses clients sur les risques associés aux actes qu’il supervise. C’est ce qu’illustre une récente décision de la Cour de cassation concernant une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier.
Dans cette affaire, la promesse stipulait une indemnité d'immobilisation à la charge du bénéficiaire. Cependant, l’option d’achat n’ayant pas été levée dans les délais prévus, le promettant a poursuivi le bénéficiaire initial ainsi que son cessionnaire pour obtenir le paiement de cette indemnité.
La cour d’appel a estimé que le notaire avait commis une faute en omettant d’informer précisément la cliente sur les risques encourus. En particulier, il n’a pas attiré son attention sur les conséquences d’un engagement au paiement de l’indemnité d’immobilisation, en l’absence d’une clause suspensive relative au rapatriement des fonds. Or, la cliente avait explicitement indiqué au notaire qu’elle souhaitait inclure une telle condition pour garantir le transfert des fonds qu’elle détenait en Chine.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024 (n° 23-15.327, F-D), a confirmé la déclaration de responsabilité civile du notaire. Elle rappelle que selon l’article 1240 du Code civil, un notaire a l’obligation d’éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. En l’espèce, le notaire n’a pas rempli ce devoir, ce qui justifie sa mise en cause.
Cet arrêt souligne l’importance du rôle du notaire dans la sécurisation des transactions immobilières et son devoir de conseil renforcé, particulièrement lorsque des conditions spécifiques sont nécessaires pour protéger les parties d’éventuels obstacles financiers ou juridiques.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
Lire la suite